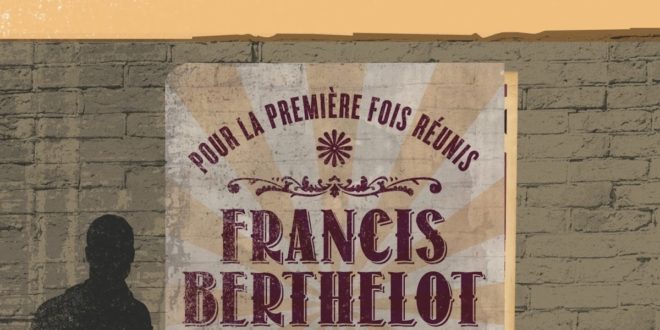Les éditions Dystopia éditent pour la première fois, dans son intégralité, Le Rêve du Démiurge de Francis Berthelot : ce cycle de neuf romans, étalé sur plus de 20 ans de publication et pas moins de cinq maisons d’édition différentes, a trouvé pour la première fois sa forme complète, en trois volumes publiés respectivement en 2015, 2016 et 2017. Une occasion rêvée – c’est le cas de le dire – de découvrir ou redécouvrir l’auteur du magnifique Rivage des Intouchables (1994).
Ce premier tome, à travers trois récits (L’ombre d’un soldat, Le jongleur interrompu et Mélusath), balaye une grosse vingtaine d’années – des années 50 à 1970. D’abord ancré dans un certain réalisme, dépeignant les mœurs d’un petit village rural aux lendemains de l’Occupation, il incline petit à petit vers le fantastique : si les deux premières histoires restent prudemment à son seuil, la troisième lui laisse toute sa place. Une véritable continuité s’installe donc entre des romans situés pourtant à des époques et dans des lieux différents : ainsi, certains personnages, mais aussi des thèmes, des obsessions, réapparaîtront de l’un à l’autre à travers l’ensemble du cycle. Dans le premier volume en particulier, les deux premières histoires, qui sont indépendantes l’une de l’autre tout en démontrant des similitudes troublantes, se rejoignent dans la troisième.
L’Ombre d’un soldat raconte la sortie de l’enfance, puis l’entrée dans l’âge adulte d’Olivier, un garçon qui s’interroge sur les non-dits couvant au sein de son village, sous les disputes nocturnes de ses parents. Un soir, il a ainsi découvert avec horreur que sa mère, dont on comprendra assez vite qu’elle a été tondue à la Libération, portait une perruque sur son crâne rasé. Non sans noirceur, le roman décrit comment Olivier va perdre non seulement son innocence, mais aussi, petit à petit, sa raison. Comment la haine se transmet d’une génération à l’autre, attisée sous des faux-semblants et laissée telle quelle en héritage à des enfants qui n’auront d’autre possibilité que de la laisser les dévorer de l’intérieur.
« Que la neige tombe sur le passé ou le présent, elle a la classe des grandes mystificatrices. La semaine avant Noël, les nuages qui s’amoncelaient sur Montaiguière (1250 habitants) sont passés insensiblement du blanc à l’ocre sale. Puis, d’un coup, ils ont viré à une espèce de vert-de-gris, rappelant moins la feuille de l’olivier que la crasse des convois militaires. Dans ses profondeurs, on a vu se profiler le spectre des bombardiers et des chars. Mais au moment où leur ombre allait recouvrir la garrigue, le ciel a crevé en flocons diaphanes, comme pour tout lénifier, l’inquiétude des bêtes, la mémoire des hommes, et renvoyer dans les limbes les secrets malséants. »
Malgré son enveloppe de naturalisme, L’Ombre d’un soldat laisse déjà se déployer une forme de fantastique diffus, qui a moins à voir avec le surnaturel à proprement parler qu’avec le psychisme torturé des personnages, d’où il semble tirer sa source primitive. Ce sont les traumatismes, les hontes inavouées, les secrets de famille, qui créent des monstres. Ainsi, le jeune Olivier dialogue avec un pantin de hussard, un jouet lucide et cruel dont on ne sait s’il est une matérialisation de la conscience schizophrène du petit garçon, ou un phénomène extraordinaire. Dans Mélusath, le personnage éponyme lui ressemble de manière confondante : sorte de korrigan tout droit sorti d’un décor de théâtre, il révèle les personnages à eux-mêmes, à leurs désirs enfouis, et finalement à leur destin.
Quant aux crises d’épilepsie de Pétrel, l’un des personnages principaux du Jongleur interrompu, elles semblent presque relever de l’hystérie (au sens psychiatrique du terme), tant elles sont liées au secret qui pèse sur sa conception et sur l’identité de son père. Ce trou béant, dont le jeune homme pressent l’horreur, le pousse aux marges de sa communauté pour en faire l’idiot du village. Mais le passage d’une troupe de forains dans ce petit bourg de Bretagne va tout bouleverser, et surtout l’admiration puis l’amitié que Pétrel va porter à Constantin, un jongleur malade du sida cherchant pour son dernier voyage à se rendre sur la mystérieuse île d’Anon, qui, dit-on, abrite l’âme des morts. Le lien inattendu et la solidarité entre les deux hommes leur permettront, à l’un d’affronter l’angoisse de sa mort annoncée, à l’autre de mettre au jour l’origine de ses troubles et de s’affranchir enfin de son passé.
« Pauvres statues… Le petit Jésus a les orteils qui brûlent. Un, deux, trois, quatre, cinq, il n’en reste rien. Le voile de Véronique s’embrase, et avec lui, la face du grand Jésus. La paille du berceau, les épines de la couronne, tout cela flambe gaillardement. L’épée de saint Pierre se consume en pure perte. Et les mains de la Vierge se tordent, les doigts incandescents…
De vagues sarcasmes lui viennent. N’est-ce pas son propre bûcher funèbre qu’il contemple ? Funambule, jongleur de torches, il connaît tellement les règles… Si le fils de Dieu part en mouches d’or, c’est que les légendes n’ont qu’un temps. Si le Saint-Esprit s’envole en volutes noires, c’est que la conscience est mortelle. Il pourrait croire à la chair, encore, face à ce désastre. Mais les cuisses des soldats ne sont plus que braises. Et Satan l’incombustible est dévoré par les flammes. Jusqu’à l’os… Aucun d’eux ne peut plus rien pour lui. »
Sans gager de la pertinence de ce parallèle, je n’ai pu m’empêcher de penser à la bande dessinée de Comès, Silence, à son personnage mutique et innocent, qui apprend à haïr en même temps qu’il découvre le langage, et qu’est levé le voile sur son identité et ses origines. Comme dans Silence, l’univers du spectacle, du cirque et de la voyance, le mélange d’hostilité et de fascination qu’ils font naître chez les habitants d’une bourgade, occupent une place essentielle dans l’histoire.
Le théâtre lui aussi prend toute sa dimension dans le troisième roman, Mélusath, où la troupe d’une salle menacée par la faillite met en scène un épisode de l’Orestie : l’occasion pour Francis Berthelot de mettre en œuvre une dialectique entre la représentation et la réalité, les comédien-ne-s et leur rôle, jusqu’à la Première du spectacle ; la représentation scénique semble alors devenir l’espace-temps de la révélation et de la sublimation des désirs.
« Il n’a brandi aucune baguette magique. Lancé aucun abracadabra. Rien… Juste accepté que – si le sort le veut – l’impossible se produise. Et pourtant, sous son regard, l’ombre commence à respirer. L’air de rien, la voilà qui palpite, prend vie, se déploie comme les figures mystérieuses qui naissent des nuages. A croire qu’elle puise sa substance dans ce fatras d’objets assoupis ; et son énergie, dans ces esquisses qui n’intéressent que la poussière.
Ce qui émerge – il n’en est pas vraiment surpris -, c’est Mélusath en personne, lequel embrasse la pièce d’un coup d’œil aigu avant de se jucher sur le dossier de la deuxième chaise, une vieillerie en orme dont la paille est renforcée avec de la ficelle.
– Bonsoir, mon peintre… dit-il en adoptant la posture du lotus. Tu es donc prêt à tremper ton pinceau dans les ténèbres ? »
On est parfois troublé par l’écriture de Francis Berthelot, qui, de par la densité de ce qu’elle explicite (psychologie, atmosphère, décors…), peut donner un sentiment de pesanteur. En même temps, son rythme travaillé, sa précision, la subtilité de ses images, sont d’une beauté saisissante, et servent à merveille un propos qui flirte volontiers avec la psychanalyse. Ce premier volume constitue donc une très bonne entrée dans l’univers littéraire de Francis Berthelot, un univers impossible à cantonner dans un genre ou un autre, qui se coltine avec la maladie et la folie, et fait sourdre le drame dans le langage.
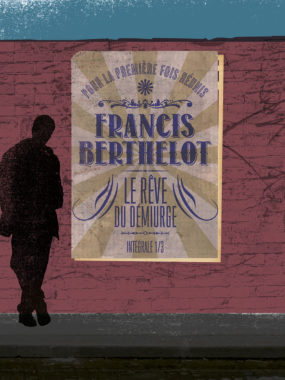
Le Rêve du démiurge 1/3, Francis Berthelot.
Editions Dystopia, 2015.
Anne.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire