“La mort d’un homme est parfois une déclaration de guerre faite à un pays. Parfois.
La mort d’un enfant est toujours une déclaration de barbarie adressée à l’humanité. Toujours. Mais ça, on le verra plus tard.”
La trilogie « Benlazar » de Frédéric Paulin, initiée avec La guerre est une ruse (Agullo, 2018) et poursuivie avec Prémices de la chute (Agullo, 2019), s’achève avec La fabrique de la terreur, paru le 5 mars 2020 dernier aux mêmes éditions Agullo.
Aborder la fin d’un cycle romanesque qui nous a accompagné et tenu en haleine depuis son commencement procure un sentiment mêlé d’impatience, d’excitation et d’appréhension : la destination vers laquelle nous emmène l’auteur sera-t-elle à la hauteur du chemin parcouru ?
A la question de savoir comment l’histoire allait se terminer, ou plutôt sur quoi elle allait se terminer, nous avions déjà la réponse : Frédéric Paulin s’est donné pour objet de faire une généalogie du terrorisme islamiste, de son émergence dans l’Algérie des années 1990 jusqu’à l’avènement de Daesh et aux attentats du 16 novembre 2015 à Paris. Il était prévu, dès le début, que le dernier roman se conclurait sur la tuerie du Bataclan.
Mais loin de détruire toute forme de suspense, cette donnée aurait plutôt tendance à décupler la curiosité : le potentiel des romans de F. Paulin ne réside pas tant dans la connaissance des événements qui s’y produisent, inévitable en l’occurrence, que dans la manière dont on s’y achemine… et ce qu’on y apprend.
Tout l’art du romancier, ici, consiste à instiller une tension narrative dans un scénario dont nous ne connaissons que trop bien l’issue. C’est déjà ce qui nous avait bluffés dans La guerre est une ruse, puis dans Prémices de la chute, c’est peut-être encore plus vrai ici. La question de savoir comment l’auteur parviendrait à traiter d’événements aussi proches de nous d’un point de vue temporel, géographique et affectif, constitue d’ailleurs une attente de lecture à part entière.
“Dans les rues de Menzel Bouzayane, les gens hurlent. A Tunis et partout dans le pays, les gens hurlent leur haine contre le président Ben Ali.
Le jeune homme qui s’est immolé à Sidi Bouzid est entre la vie et la mort. Les journaux n’ont pas parlé de son sacrifice – les journaux ne répètent que les mots du pouvoir. Mais tout se sait dans la rue. Le geste de Mohamed Bouazizi ne doit pas rester le geste d’un désespéré, un simple suicide comme on voudrait le faire croire. Wassim et ses amis sont persuadés que l’allumette dont il s’est servi pourrait mettre le feu aux poudres. Wassim n’y connaît rien en politique, mais il voit bien que les gens autour de lui en ont assez de leur existence misérable. Voilà pourquoi il hurle : « Ben Ali, dégage ! »
La haine est immense parce qu’elle a été trop longtemps muselée. Elle a grandi dans leur coeur, dans celui de leurs parents et de leurs grands-parents. Wassim espère que les choses vont changer. Il a dix-neuf ans, la vie devant lui, il est amoureux. Même si cet amour n’est pas toujours facile à vivre. Aujourd’hui, il veut croire à des lendemains meilleurs.”
L’intrigue de la Fabrique de la terreur s’étale de 2011 à 2015, et s’ouvre sur les soulèvements qui mirent fin au régime du président Ben Ali en Tunisie. Vanessa Benlazar, journaliste, partie enquêter sur les révoltes du Printemps arabe et inquiète quant à leur possible récupération par les islamistes, va bientôt s’intéresser au cas de Wassim, un jeune Tunisien converti au djihadisme.
Sur leurs traces, et celles de bien d’autres protagonistes, le roman nous emmène de Tunis en Libye, puis en Syrie, théâtre de l’ascension de l’État Islamique de Daesh. Au gré d’allers-retours entre cette région du Levant et la France, mais aussi Bruxelles, il met constamment en relation ce qui se produit sur chacun des territoires ; car, bien sûr, tout est lié.
Une grande partie du livre se déroule ainsi en France, notamment Toulouse où, au début du roman, la cheffe de la section locale de la DCRI, Laureline Fell, enquête sur un dénommé Mohammed Merah, et tente en vain d’alerter la direction centrale sur la dangerosité de cet individu.
Si les attentats et les événements qui ont marqué ces années 2011 à 2015 jalonnent la progression de l’histoire, le roman s’attache moins à les mettre en scène qu’à dépeindre les processus longs et complexes qui y amènent ou qui en découlent, à travers les yeux et les actions des différents personnages : les investigations périlleuses de Vanessa Benlazar ; le destin d’un groupe de jeunes habitants de Lunel, dont nous suivrons le parcours jusqu’à leur départ en Syrie, les uns après les autres ; les tentatives infructueuses d’un professeur de cette même ville, Réif Arnotovic, pour les approcher et les comprendre ; les missions d’un agent de la cellule Alpha de la DGSE, en zone de guerre ; les réflexions d’un Tedj Benlazar mis à la retraite… et bien sûr, les enquêtes de Laureline Fell.
Contexte géopolitique, évolution du terrorisme islamiste depuis ses modes d’action et de recrutement jusqu’à ses réseaux de financement, évolution aussi de la lutte anti-terroriste sur fond de restructuration des services de renseignement français… Les sujets abordés par le roman sont, plus que jamais, nombreux et denses : l’une des principales gageures pour le romancier, on le devine, était d’en clarifier la trame pour la rendre intelligible au lecteur, sans sacrifier la complexité de ses éléments.
– Je pense à ce que je fais toute la journée, à ce que mes collègues font toute la journée. On suit à la trace des gens dangereux, des bombes à retardement. Personne n’en parle ou personne ne veut voir. Il ne faut pourtant pas être devin pour savoir qu’un jour ou l’autre, des Français vont porter leur djihad en France.
– Comme Khaled Kelkal, tu veux dire ?
Fell éteint l’écran avec la télécommande.
– Kelkal, c’est fini. Kelkal, c’était la première mouture. Comprends ça, Vanesse : le mal mue, il se transforme, il s’accroît sans arrêt. Kelkal, c’était le GIA, une histoire franco-algérienne, comme dirait Tedj. Après il y a eu Al-Qaïda, le 11 septembre 2001. Qu’est-ce qu’il y aura ensuite ?”
Frédéric Paulin a déjà prouvé dans les deux précédents romans qu’il maîtrisait à merveille ce type de récit, se servant des nombreux personnages qu’il met en scène pour multiplier les perspectives sur une même réalité, sans jamais nous égarer. Le roman avance de manière tout à la fois linéaire – les événements se succédant de manière implacable, une année après l’autre – et comme kaléidoscopique, puisque les points de vue des personnages, émanant de différents lieux et instances, se juxtaposent et se répondent, sans qu’il y ait jamais besoin de surligner par l’artifice d’un commentaire omniscient la composition du tableau d’ensemble.
Et si ce dernier ne paraît jamais opaque ou indigeste, c’est que le romancier sait parfaitement faire la part de ce qu’il y a à raconter, et de ce qu’il vaut mieux suggérer, voire laisser hors-champ. La tenue de la narration repose ainsi presque autant sur les ellipses que sur ce qui est écrit noir sur blanc : plutôt que de saturer le lecteur d’informations, on laisse à son intelligence, comme par une sorte de fonction synaptique, le soin de lier les éléments les uns aux autres et de ressentir la continuité qui les sous-tend.
Une narration concise et rythmée, donc, mais aussi à même d’exprimer le caractère diffus, insaisissable, de la menace qui monte en puissance, tout comme l’incapacité à y faire face.
“Les négociateurs restent en communication avec Merah, mais c’est Chaoui qui est à la manœuvre. Merah continue de s’adresser à la brigadier comme s’ils discutaient entre amis.
– Tu crois que je vais faire du tourisme au Pakistan et en Afghanistan ? Qui t’as vu faire du tourisme là-bas ? Al harb khoudaa, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire : « la guerre est une ruse ». Quand tu m’as convoqué, quand j’étais dans vos bureaux, j’étais en contact avec eux, je les avais trouvés. Je crois que c’est une des plus grandes erreurs de ta carrière.”
Un autre défi relevé par le livre est de parvenir à trouver le juste équilibre entre réalité et fiction.
Il y a des romans où l’Histoire est une toile de fond, pour des intrigues qui, même si elles y sont ancrées et lui sont connectées de manière organique, ont une relative autonomie. Dans le cas de la trilogie de Frédéric Paulin, ce sont les événements eux-mêmes qui sont au premier plan : il lui faut donc évaluer le jeu, la marge de manœuvre qu’ils lui laissent pour y entremêler le destin de ses personnages. Cette question semble s’exacerber avec La Fabrique de la terreur, à mesure que ce qui est relaté se rapproche de notre présent. Là encore, Frédéric Paulin a déjà prouvé qu’il était capable de s’insinuer dans les replis de l’histoire, les zones d’ombres, pour insérer des éléments de son invention, sans en rabattre ni sur la vraisemblance, ni sur la cohérence historique.
Aussi, les principaux personnages de cette histoire, Laureline et Vanessa en tête (à l’instar de Tedj Benlazar dans les deux romans précédents), sont-ils toujours judicieusement postés, de manière à nous faire voir au plus près les forces en présences, mais paradoxalement limités dans leur pouvoir effectif sur le cours des événements, qui semble se dérouler inéluctablement et bien malgré eux. Bien sûr, leur impuissance dans la fiction est un revers de la réalité : l’auteur ne peut donner trop de marge de manœuvre à ses personnages, ce qui les condamnerait à des rôles tragiques de Cassandre qui voient tout arriver sans réussir à donner l’alerte, si l’intérêt de l’intrigue les résumait à cela.
Bien sûr, ce n’est pas le cas. L’équilibre entre le versant historique et la fiction, dans ses romans, s’exprime aussi à travers une juste balance des registres, entre pur récit et développements proprement romanesques.
“Pantani ne fait pas de politique, mais il sait que l’Histoire retiendra que les rebelles libyens se sont débarrassés d’un dictateur qui opprimait son peuple depuis plus de quarante années. L’Histoire se souviendra que les Égyptiens ont fait de même avec Moubarak, les Tunisiens, avec Ben Ali, les Syriens, bientôt, avec El-Assad. Pantani et ses hommes ont fait le job ; une nouvelle fois, ils disparaissent des livres d’histoire.
Au volant de leur Defender, ils roulent à tombeau ouvert dans les rues de Syrte en proie à la dévastation. Çà et là, des miliciens tirent encore sur des immeubles dans lesquels des loyalistes sont retranchés. Des loyalistes ou des civils innocents, ceux qui trinquent toujours ? Des femmes et des gosses courent pour sauver leur vie ; un vieillard, assis sur un trottoir, lève les mains au ciel, implorant quelque dieu d’empêcher le monde de s’écrouler autour de lui.”
Nous parlions plus haut de suspense et de tension dramatique : il est évident qu’une part essentielle de ce qui nous tient en haleine, dans La Fabrique de la terreur, réside dans la caractérisation de personnages profonds et humains, constamment tiraillés entre le poids du déterminisme historique et leur propre détermination à y faire face. Des personnages avec lesquels nous avons noué un attachement tout particulier, pour certains depuis le premier tome. Et le plaisir de retrouver ces personnages désormais familiers est d’autant plus grand qu’une fois de plus, ils seront mêlés à des événements de premier plan, chacun, en des proportions diverses, ayant sa partition à jouer dans l’intrigue.
Dans le clan Benlazar, nous avons d’abord le père, ou plutôt le grand-père : Tedj, « super espion » et parfait en anti-héros de roman noir dans La guerre est une ruse, s’est retiré pour de bon, cédant la place, sur le terrain, à un duo constitué de Laureline, sa compagne, et de sa fille Vanessa. Cette dernière, que nous avons vu passer à l’âge adulte dans Prémices de la chute, devenir mère et s’accomplir en tant que reporter internationale, a hérité en partie du caractère de son paternel, de ses intuitions et de sa tête brûlée. De sa propension à privilégier sa vocation sur sa vie de famille, aussi. Quant à son ex-compagnon et père de leurs deux enfants, Réif Arnotovic, il est également en retrait par rapport à Prémices de la chute dont il était l’un des personnages principaux. Devenu prof à Lunel, son rôle d’observateur inquiet témoigne bien de la détresse du corps enseignant face à des élèves sur lesquels il n’a plus aucune prise, dans une situation où la violence sociale et la marginalisation conduit des jeunes à embrasser l’Islam radical et le djihadisme.
A ces personnages fictifs vont s’en ajouter une myriade, réels ou fictifs, comme Sébastien Pantani, l’agent de l’ombre de la DGSE, brutal et légèrement fêlé, ou Simon, Maram, Wassim et d’autres jeunes recrues que l’on verra quitter leur pays pour aller grossir les rangs de Daesh en Syrie. Indispensables au développement de l’intrigue, ces nouveaux personnages sont tout aussi bien campés, jusque dans leurs faiblesses et leurs ambiguïtés : là encore, la complexité des personnages et le refus de choisir un point de vue univoque contribuent à produire un roman irréductible à toute forme de manichéisme.
– Non, même pas lui, coupe sèchement Simon. Il y a quelques jours, je lui ai proposé de créer un groupe de parole à la MJC et il a refusé. Même lui ne comprend pas.
Hani et Safi soupirent.
A Lunel, les fêtes de Noël ne sont pas une période plus intéressante que le reste de l’année. Simon vit à Montpellier toute la semaine. Comme ici, il n’a pas l’impression de s’accomplir. Il y a un vide au milieu de sa poitrine. Il n’en parle pas à ses parents, ils ne comprendraient pas ; lui, le bon élève qui a trouvé sa voie spirituelle, il ne serait pas heureux ? A quoi servirait de suivre les préceptes d’Allah ? Il en discute souvent avec Huseyin, Safi ou Hani. Ils n’ont pas de réponse. Ils reconnaissent qu’ils ne se sentent pas sereins non plus. A demi-mots, parce que pour eux, ne pas être serein pourrait vouloir dire être un mauvais croyant.”
On pourra toutefois remarquer que ces personnages n’ont pas toujours le loisir d’être aussi développés que ceux de La guerre est une ruse, ou même Prémices de la chute : cela tient sans doute à une évolution d’ensemble, qui caractérise l’écriture toute entière de ce troisième volet.
Bien que fidèle à lui-même, à ses personnages comme à la continuité du récit de grande ampleur qu’il a entrepris, Frédéric Paulin semble avoir fait évoluer son écriture en fonction des nécessités du récit. Avec La Fabrique de la terreur, nous plongeons plus que jamais tête la première dans le cours des événements. Le récit chronologique, décomptant les années, nous précipite dans une fébrilité, une urgence auquel le style de l’écrivain s’est adapté. Tout est plus factuel, plus tendu.
Du premier au dernier tome, l’écriture semble donc s’être notablement resserrée. Pourtant, les qualités d’écriture et de style sont toujours présentes, et peut-être d’autant plus essentielles : en quelques détails, une scène prend vie ; en quelques lignes de dialogue ou bribes pensées, un personnage prend du relief et du sens. Le style de Frédéric Paulin fait dans l’économie et la justesse ; ce qui n’empêche pas quelques passages plus lyriques, voire oniriques, en particulier ceux qui mettent en scène Tedj Benlazar, et la matérialisation de ses angoisses sous la figure d’un loup qui le traque. Assez saisissantes, ces scènes nous permettent de retrouver ce personnage, toujours aux prises avec ses démons – on aurait presque aimé en avoir un peu plus !
“Et maintenant, tu as peur du loup ?
Tedj Benlazar a cru voir bouger les basses branches d’un sapin en contrebas de la terrasse. Sa bouche exhale de petits nuages de vapeur, son souffle s’emballe. Il y a un animal qui l’observe, il en est persuadé.
Il se racle la gorge et rentre lentement dans la maison. Il ne referme pas la porte coulissante. Comme pour se prouver qu’il n’y croit pas, qu’il n’y a pas de loup, qu’il ne devient pas fou. Ou pire encore : peureux.
Les branches ne bougent plus. Ce n’est pas un loup. Ici, il y a des blaireaux de près d’un mètre de long. Des sangliers aussi, qui osent s’approcher des habitations. Les loups, personne n’est certain qu’il y en ait dans le coin.”
En conclusion…
« Aucune explication », nous avait-on dit. « Aucune explication qui vaille ; car expliquer c’est déjà vouloir un peu excuser », pour reprendre les mots de Manuel Valls, alors premier ministre de François Hollande, au sujet des attaques terroristes du 16 novembre 2015 et de l’attentat à l’Hyper Cacher du 9 janvier 2015.
Ils sont nombreux, les chercheurs en sciences sociales à lui avoir répondu, pour – puisqu’il en était vraisemblablement besoin – expliciter l’objet et les méthodes de leurs disciplines, les dégager de tout le substrat moral qu’on avait voulu y adosser… Ou pointer, bien sûr, les enjeux politiques implicites d’une telle déclaration.
Avec La Fabrique de la Terreur, Frédéric Paulin ajoute pour ainsi dire une pierre à la démonstration, dans le champ romanesque cette fois (on ne s’empêcher de relever, tout de même, que le titre choisi s’appliquerait parfaitement à un essai de sociologie politique !). Non, apporter une continuité et des explications à des faits ne revient pas à absoudre quoi ou qui que ce soit : ce n’est le rôle ni du sociologue, ni de l’Historien, et non plus ici celui de l’auteur de polars, que de condamner ou pardonner.
Si l’analogie a ses limites, puisqu’il faut bien faire la différence entre le travail du scientifique et celui du romancier, elle me semble représentative de quelques aspects de l’œuvre de F. Paulin : sans jamais condamner ou pointer du doigt un responsable, celle-ci restitue les rouages de l’histoire dans toute leur complexité.
Ce n’est donc pas dans ses romans que vous trouverez une explication métaphysique au Mal. Par contre, il peuvent tenter de replacer dans son contexte d’émergence une violence apparemment inexplicable, la situer dans la chaîne de causalité qui en a conditionné l’irruption : et cela n’ôtera rien à son caractère subit, effroyable (voire impardonnable, si vraiment on tient à ce registre).
Seules les dernières lignes laissent d’ailleurs entrevoir une clé d’interprétation plus générale, qui prend comme à revers la question du fanatisme ou du « choc des cultures », concluant la lecture de la trilogie toute entière sur un registre qui pourrait être celui de la philosophie matérialiste ; en tout cas, un registre bien plus économique et politique que civilisationnel ou religieux. Mais encore une fois, c’est dans la bouche d’un personnage… et cette question, comme tant d’autres, restera en suspens. A nous de méditer là-dessus.
Avec ces trois romans qui servent chacun d’antichambre à des attentats qui marqueront l’Histoire, l’oeuvre de Frédéric Paulin semble assez emblématique du sens qu’on peut donner au mot « événement », et au paradoxe qu’ils recouvrent en tant que tels. En effet, elle exhibe tout ce qu’ils cristallisent, le caractère toujours brutal de leur irruption qui semble les arracher à la succession de causes et d’effets dont ils sont pourtant le produit. Tout en s’attachant à montrer qu’ils ne viennent pas de nulle part, à les replacer dans cette généalogie de la terreur, l’auteur prend également toujours la mesure de l’effroi et de la stupeur qu’ils suscitent, ce qu’il transmet par la réaction et l’émotion de ses personnages qui, pourtant avertis et conscients de cette menace, se trouvent comme pris au dépourvu quand elle se concrétise.
Aussi en va-t-il, dans La Fabrique de la terreur, de ces figures de terroristes dépeints parfois comme des « loups solitaires », surgissant de nulle part, et qu’on peut pourtant suivre à la trace, le roman reconstituant en partie leurs réseaux et leur parcours (et il ne s’agit là ni d’une invention, ni d’un scoop).
“Fell est de la vieille école, elle croit encore au terrain, au maillage serré du territoire, qui seul permet, selon elle, d’attraper la proie. Et même si les loups solitaires existent, ils sortent d’une meute et c’est dans le cyberespace qu’il faut les stopper.
Le terrain, elle se le garde. Lependu et ses geeks feront ce qu’ils pourront sur la Toile. Elle, elle grattera, elle amassera des informations, les recoupera, comme toujours.
Tracfin lui permet d’avancer plus vite. L’agence est devenue un acteur clé du combat contre le terrorisme : ses membres ont récolté des dizaines de milliers d’informations précieuses auprès d’établissements bancaires et d’assureurs, mais aussi chez des notaires ou dans des cercles de jeu. Parmi ces informations, certaines prouvent le financement du terrorisme par les monarchies du Golfe.”
La Fabrique de la Terreur, comme les tomes précédents, mais dans une mesure accrue par la proximité temporelle et traumatique des événements qu’il relate, se trouve donc au croisement de deux dynamiques : d’un côté, il est l’aboutissement d’un cycle romanesque qui suit avec minutie l’évolution, les étapes d’un processus historique. En cela, il est presque détonant de le lire, alors que les témoignages directs de la tuerie de Charlie Hebdo ou du Bataclan sont encore sur les tables des libraires. En même temps, il ne prétend jamais s’en abstraire pour proposer une analyse prétendument dépassionnée, ne se départit jamais de l’empathie et de l’humilité nécessaires, propres à interdire toute posture de surplomb.
Cette justesse, qui semble procéder tout à la fois d’une rigueur intellectuelle et d’une conscience aiguë de la part de l’auteur, fait qu’on a la sensation que ce dernier ne joue pas la carte de l’écrivain de polars cynique et revenu de tout : pessimiste, sans doute (réaliste, en fait)… mais revenu de tout, étant donné l’engagement et l’humanité qui émanent de ce roman, c’est fort peu probable.
Ajoutons à cela que la réception de l’ouvrage au moment même de sa publication, n’est pas la seule perspective qui tienne en littérature. Or, il semble qu’un livre qui prétend parler d’un passé encore si récent qu’on ose à peine parler d’ « Histoire » est, peut-être plus que tout autre, menacé de caducité à moyen terme. Et ce, même s’il résonne avec une force évidente pour ses contemporains immédiats. Mais s’il le fait avec justesse et talent, qu’il parvient à capter quelque chose de son époque, alors on peut lui souhaiter un bel avenir : et c’est cette intuition qui domine à l’issue de la lecture des trois romans de Frédéric Paulin. On ne peut se départir de cette impression : celle d’avoir lu une œuvre déterminante, qui a su comprendre quelque chose de notre présent et nous le transmettre ; qu’elle est par là-même vouée à continuer, dans les années à venir, à trouver de nombreux nouveaux lecteurs. C’est ce qu’on lui souhaite, c’est ce qu’on leur souhaite.
**A écouter : l’interview de l’auteur dans l’émission Mauvais Genres sur France Culture.
**Une dernière question, jamais anodine quand on prodigue un conseil de lecture, serait de savoir s’il est possible de commencer la lecture par ce troisième volet. Techniquement, oui. Les adeptes d’une lecture dite « à l’écrevisse » (en commençant par la fin et en rétrogradant jusqu’au début… je ne sais même pas si ces lecteurs existent !) pourront s’en donner à cœur joie. Aux autres, on ne saurait que trop conseiller de débuter avec La guerre est une ruse, pour prendre le sujet des romans à la racine, le destin des personnages à son commencement dans la fiction. Et aucun doute, ce dernier tome, vous y viendrez très vite !
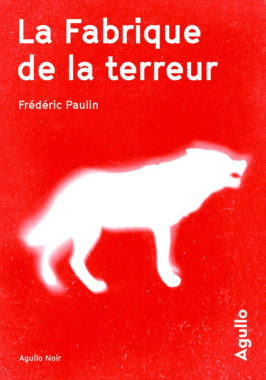
La Fabrique de la terreur, Frédéric Paulin
Editions Agullo, 2020 (343 p.)
Anne.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire


Merci pour cette excellente analyse, et l’acuité de votre traitement, étant donné (de plus) la difficulté de traiter des sujets de ce type de roman. Excellent article !