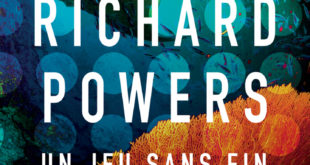Après un premier roman audacieux, parlant de l’auteur en filigrane, et montrant une construction de l’identité littéraire au travers de la déconstruction de la vie de son personnage, nous retrouvons Don Delillo avec son troisième roman. Troisième, car il existe une second, End Zone, inédit en France. Great Jones Street fut publié en 1973 en Amérique du nord, mais ne sortit qu’en 2011 chez nous.Venant conclure sa trilogie de «jeunesse», de l’aveu de l’auteur, il aurait aimé le faire différemment avec le recul, plus court et plus drôle.
« La célébrité nécessite toutes sortes d’excès. Je parle de la célébrité véritable, de la dévoration des néons, pas du crépusculaire renom d’hommes d’Etat sur le déclin ou de rois sans couronne. Je parle de longs voyages dans un espace gris. Je parle de danger, du bord qui cerne un néant après l’autre, de la situation où un seul homme confère aux rêves de la république une dimension de terreur érotique. Comprenez l’homme contraint d’habiter ces régions extrêmes, monstrueuses et vulvaires, moites de souvenirs de profanations. Si demi-fou qu’il soit, il se trouve absorbé dans la folie absolue du public ; même entièrement rationnel, bureaucrate en enfer, génie secret de la survie, il ne peut qu’être détruit par le mépris du public pour les survivants. La célébrité, cette espèce particulière, se nourrit de scandale, de ce que les conseillers d’hommes inférieurs considéreraient comme de la mauvaise publicité – hystérie en limousines, bagarres au couteau dans l’assistance, litiges bizarres, trahisons, fracas et drogues. Peut-être l’unique loi naturelle régissant la célébrité véritable, est-elle l’homme célèbre se voit, à la fin, contraint de se suicider. »
Peut-on échapper à son destin ?
Choix audacieux de la part de Bucky Wunderlick, une rock star / messie, en plantant son groupe au milieu d’une tournée et en partant se réfugier dans un miteux appartement dans « Great Jones Street ». Son isolement ne va pas être de longue durée, car très vite son manager, sa petite amie, des personnages plus ou moins proches et plus ou moins mal intentionnés vont commencer à graviter autour de lui, tirant partie de sa notoriété, de sa faiblesse temporaire, de sa résignation. Pendant que les rumeurs folles et incohérentes courent dans les rues de tout le pays sur le sort de Bucky, celui-ci abandonne toute ambition et se laisse porter par les situations. Mais à trop se laisser faire ne forçons nous pas les gens à faire de nous ce qu’ils leurs plait ?
Don Delillo écrit comme Steve Reich compose de la musique, c’est minutieux mais bancal. Chaque mot, chaque phrase a son importance chez Don Delillo, au risque de perdre le lecteur – Et encore sur Great Jones Street c’est du très abordable – son roman crée un tout compact qui n‘offre pas à un œil distrait le loisir d’être lu simplement. Tout comme la musique de Steve Reich il faut de l’investissement de la part du lecteur, accepter la logique de l’auteur, tolérer l’irréalisme des dialogues et les préoccupations des personnages. Car les personnages de Don Delillo évoluent dans une sphère toute autre. Certains servent même seulement à incarner une idée et n’existent que pour ça.
Bancal, oui mais foutrement bien bancal, la progression est logique mais toujours avec un léger décalage, comme si Delillo souhaitait mettre l’accent sur l’aspect superficiel que peut représenter le temps et marquer encore plus le fait que Bucky a décidé d’arrêter d’avancer.
Pour comprendre mon idée de comparaison avec Steve Reich je me dois de vous expliquer une invention du compositeur. Un jour, par accident et à cause d’un magnétophone défaillant qui lisait légèrement plus vite que la normale, Steve Reich découvrit le « Dephasing ». Cette technique consiste à prendre, par exemple, deux pianos qui vont jouer la même partition mais un des deux va la jouer légèrement plus vite. Les deux mélodies, qui sont à la base similaires, vont se « desynchroniser » progressivement, créant une autre mélodie et surtout une sensation d’irréalité, de motif onirique qui ne devrait pas exister. Ces « déphasages » sont plus ou moins long mais les deux instruments finissent à un moment ou un autre par se reconnecter, se resynchroniser.
Avec « Great Jones Street » nous assistons au même processus entre la réalité et Bucky qui jouent la même partition, mais Bucky décide de la ralentir, et c’est là toute l’intelligence de Don Delillo, car mis à part une technique d’écriture et un style déjà grandiose, il arrive à nous entraîner dans une sorte de rêve éveillé sans autre artifice, rêve qui sera fatalement resynchronisé avec la réalité. Une merveille à prendre le temps de découvrir.
Pour le petit coté «fun fact», il est question du Running Dog, un magazine parodique du Rolling Stones. C’est ce même Running Dog qui reviendra de manière beaucoup plus centrale en 1978 dans son roman « Chien Galeux».
Actes Sud,
Babel,
Trad. Marianne Veron,
300 pages,
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire