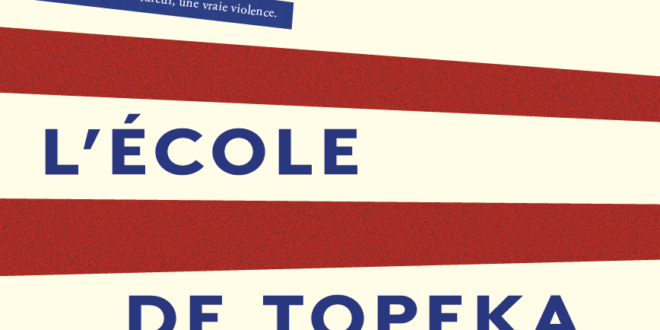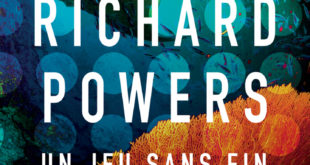Ben Lerner est un nom à retenir. Ayant souvent été second couteau des sorties d’auteurs américains jusqu’à ce jour – quelques fulgurances dans ses poésies et ses précédents romans – n’auront pas permis de faire reconnaître son talent à sa juste valeur. Un talent indéniable qui prend tout son envol dans ce magistral nouveau roman publié par les éditions Bourgois, avec la traduction virtuose de Jakuta Alikavazovic. Mais de quoi « Ben Lerner » est-il le nom ?
Ce fils de psychiatres, enseignant de littérature au Brooklyn college, n’en est pas à son coup d’essai, et n’est pas inconnu des lecteurs français les plus assidus. Ainsi, nous avions pu le découvrir avec « Au départ d’Atocha » ( l’Olivier, 2014), puis 10 :04 ( l’Olivier, 2016), ainsi qu’un recueil de poésie, à savoir « Angle de lacet » ( éditons Joca Seria, 2019). Un auteur quasi-confidentiel, comme un Stephen Markley, ou encore John Wray, impressionnant par sa virtuosité, mais ne rencontrant jamais le succès d’un Jonathan Franzen ou Philip Roth, car oui, son talent impose la comparaison.
« Lécole de Topeka » raconte la vie et les atermoiements de la famille Gordon, dignes citoyens américains issus de la classe moyenne. Nous suivons Adam le fils, champion de joutes oratoires, le père Jonathan et la mère Jane, tous les deux psychiatres travaillant à la Fondation, dans la ville de Topeka dans le Kansas. Cette famille en apparence soudée, mais au parcours aussi singulier que tout à chacun, se retrouvant confrontée à une époque changeante, à un entourage inconstant et aux questionnements existentielles qui peuvent s’imposer au cours du cheminement de vie. Enfin, nous suivons Darren, son témoignage, par petite bribe, venant compléter ainsi un tableau d’un milieu et d’une époque.
Ben Lerner, ne propose pas moins que d’ausculter avec minutie, et maniérisme, l’Amérique des années 90, mais plus globalement les sociétés occidentales capitalistes de cette époque à l’heure des dérèglements. Qu’il s’agit-ce de la confrontation d’idéaux, de changement de dogme sociétal, notamment les confrontations entre patriarcat et émancipation de la femme, mais aussi l’aliénation du succès ou encore le délitement du couple face à une routine consumériste, et la perte de sens dans un monde de plus en plus rapide et superficiel. Chacun incarnant à tour de rôle, symboliquement une problématique et son questionnement inhérent, tout en construisant un lien, même ténu avec les autres membres de la famille, donnant ainsi une cohérence d’ensemble vertigineuse.
“puis nous sommes arrivés devant La Vierge À L’Enfant de Duccio, y sommes restés plusieurs minutes; mes mâchoires se serraient et se desserraient involontairement tandis que nous le regardions. Les vieux tableaux m’ennuyaient habituellement, mais celui-ci me stupéfia. L’expression de la femme, comme si elle savait les choses d’avance, comme si elle était à même d’anticiper une récurrence distante. Le parapet étrange sous les silhouettes, sa façon de lier le monde sacré et celui des spectateurs. Un instant, le fond doré me semblait plat; le suivant, il n’était que profondeur. Mais ce qui m’a réellement fasciné, ce qui m’a réellement ému, n’était pas dans le tableau : c’était le fait que le bord inférieur du cadre portait des brûlures de bougie. Des traces d’un vieux procédé d’éclairage, l’ombre de la dévotion. Le cartel affirmait que le tableau avait contribué à inaugurer la Renaissance parce que Duccio avait réimaginé la Madone et le Christ en des termes issus du quotidien. En ce sens, c’était une façon de se détourner du sacré, les tableaux devenant progressivement des objets de contemplation esthétique, détachés de la religion, détachés des autels, libres ou condamnés à circuler dans l’espace du musée et celui du marché. Mais les brûlures étaient comme l’empreinte digitale d’une époque révolue – avant que Ziegler et ses camarades ne décrètent que les sources traditionnelles de valeur n’étaient que superstition. Ces ” milliers de générations de progrès technique” ont oblitéré tout rituel, vidé les choses de tout sens, une glossolalie sans divinité. J’ ai décidé, moi, que c’est cela qu’elle voyait, cette mère peinte, qu’elle faisait ses adieux aux chandelles, qu’elle se savait prisonnière d’un tableau adressé à l’avenir, où il ne pourrait être, en dépit de sa grandeur, qu’une instance de savoir-faire, de maîtrise technique. De nouvelles fissures apparaissaient à la surface, sous mes yeux. Dans mon souvenir, les larmes me sont montés.“
Mais le plus impressionnant, à la lecture de « Lécole de Topeka », c’est le style de l’auteur, nous sommes face à un écrivain possédant une écriture, un style, un regard propre à lui-même une signature donnant une grandeur au tout. Les pensées et les digressions des personnages se font d’une intensité rare. On en vient presque à ressentir une mélancolie et une urgence du constat. Et cette stylistique fonctionne à chaque fois. Que l’on parle d’un tableau, de la perception de la célébrité, du rapport à ses confrères, ou encore de la perte d’une amitié, tout devient à la fois métaphysique et intime, comme une collision entre le sublime et le banal.
On pourra relever les similitudes entre Adam et sa famille avec l’auteur et ses parents, il y a une base commune, mais ceci ne justifie nullement le talent derrière cet œuvre. « L’école de Topeka » est un grand roman, pas un grand roman américain, il est au-delà, s’inscrivant comme témoin d’une névrose universelle, dans une vérité du sublime et du crasseux, il est ce grand roman que l’on aime ouvrir et se prendre en pleine face page après page. Une sacrée claque !

Christian Bourgois,
Trad. Jakuta Alikavazovic,
416 pages,
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire