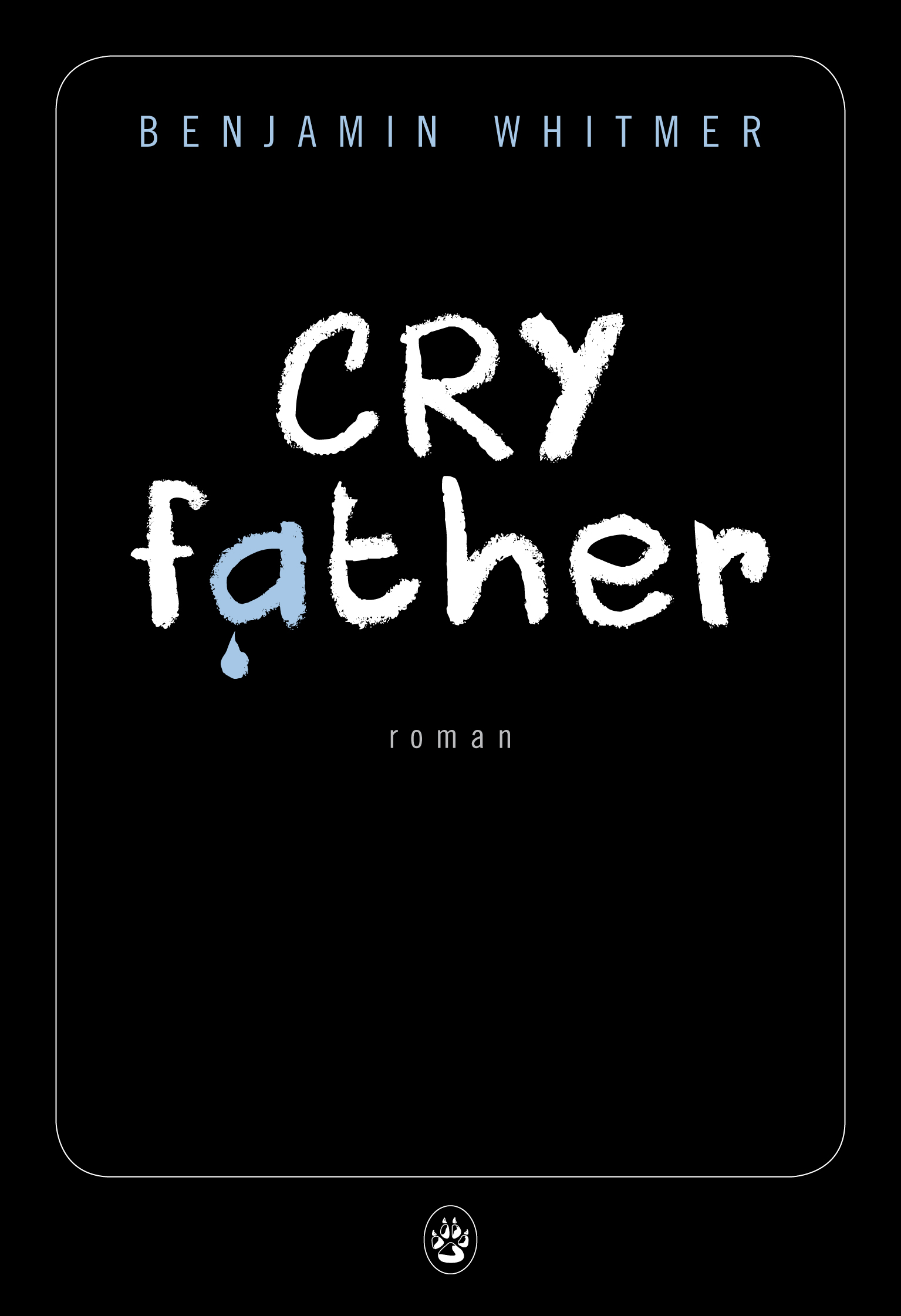La foire aux serpents – Harry Crews : C’est l’un des romans les plus sombres et drôles que je n’ai jamais lu. J’ai par ailleurs été renvoyé du seul club de lecture dans lequel j’étais parce que je l’avais choisi. Mais c’était de leur faute, pas de la mienne. La foire aux serpents est l’analyse la plus sordide jamais écrite sur l’homme blanc américain et ses imperfections. C’est fou, drôle, lyrique, brutal et distillé avec de véritables instants de beauté et de compassion. Comme Flannery O’Connor disait à propos de son travail, « Quand vous pourrez supposer que votre public possède les mêmes croyances que vous, vous pourrez vous détendre un peu et employer des moyens plus normaux pour lui parler. Quand vous pourrez supposer que ce n’est pas le cas, alors vous devrez rendre votre idée visible par le choc – pour les malentendants vous criez et pour ceux qui sont presque aveugles vous dessinez de grands dessins. » C’est Harry Crews, et il n’y a rien de mieux.
La foire aux serpents – Harry Crews : C’est l’un des romans les plus sombres et drôles que je n’ai jamais lu. J’ai par ailleurs été renvoyé du seul club de lecture dans lequel j’étais parce que je l’avais choisi. Mais c’était de leur faute, pas de la mienne. La foire aux serpents est l’analyse la plus sordide jamais écrite sur l’homme blanc américain et ses imperfections. C’est fou, drôle, lyrique, brutal et distillé avec de véritables instants de beauté et de compassion. Comme Flannery O’Connor disait à propos de son travail, « Quand vous pourrez supposer que votre public possède les mêmes croyances que vous, vous pourrez vous détendre un peu et employer des moyens plus normaux pour lui parler. Quand vous pourrez supposer que ce n’est pas le cas, alors vous devrez rendre votre idée visible par le choc – pour les malentendants vous criez et pour ceux qui sont presque aveugles vous dessinez de grands dessins. » C’est Harry Crews, et il n’y a rien de mieux.
Collected Stories – Flannery O’Connor : En parlant de Flannery O’Connor, elle a aussi écrit : « il y a quelque chose en nous, en tant que conteurs et en tant qu’auditeurs, qui exige l’acte rédempteur, qui exige que ce qui tombe se voit offrir la chance d’être restauré. Le lecteur d’aujourd’hui cherche ce mouvement, à juste titre, mais ce qu’il a oublié, c’est ce que cela coûte. Son sens du mal est dilué ou totalement absent, et il a oublié le prix de la restauration. Quand il lit un roman, il veut soit que tous ses sens soient écorchés, soit que son esprit s’élève. Il veut être transporté, instantanément, soit pour se moquer de la damnation soit se moquer de l’innocence. » Selon moi, c’est la meilleure chose écrite sur la littérature contemporaine, et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui que quand elle l’a écrit. C’est également une définition précise de son travail : il n’y a rien de simulé dans ses histoires ; elles sont vraies du début à la fin. C’est le premier auteur qui m’a vraiment touché et m’a donné envie de devenir écrivain à mon tour.
Méridien de sang – Cormac McCarthy : J’ai passé dix ans de ma vie à traquer les références et allusions qui peuplaient Méridien de Sang. Tout ce qui pouvait s’inspirer du 19ème siècle, de ses romans emplis de haine envers les indiens, ou bien de Wordsworth, Flaubert et Waylon Jennings. Le professeur d’histoire littéraire Richard Slotkin a écrit dans « Regeneration Through Violence » : “Dans la mythologie américaine, les pères fondateurs n’étaient pas ces « gentlemen » du 18ème siècle qui ont écrit la convention de Philadelphie. En vérité, ils étaient ceux (pour paraphraser Faulkner dans Absalom, Absalom !) qui, à partir d’une nature sauvage implacable et opulente, en ont arraché une nation – Les voleurs, les aventuriers, les chercheurs d’or, les guerriers indiens, les commerçants, les explorateurs et les chasseurs qui tuaient et étaient tués jusqu’à ce qu’ils aient maitrisé le monde sauvage. Les colons qui sont venus après, souffrant de difficultés et des guerres indiennes pour le bien d’une mission sacrée ou d’un simple désir pour la terre. Et les indiens eux-mêmes, tels qu’ils sont apparus aux colons, pour ce qu’ils étaient alors ; la personnification démoniaque de l’Amérique sauvage. Leurs préoccupations, leurs espoirs, leurs terreurs, leurs violences et les justifications de ces dernières – tels qu’ils sont exprimés dans la littérature – sont les pierres angulaires de la mythologie qui façonne notre Histoire.” C’est ce qu’est ce livre. Et il est juste aussi majeur, sanglant et sauvage que notre Histoire.
Des anges – Dennis Johnson : J’ai choisi « Des anges » seulement parce que c’est le premier livre de Johnson que j’ai lu. J’ai fait ce choix parce qu’il était le premier, mais on aurait pu mettre la moitié de ses romans dans ce classement. Personne n’écrit mieux que lui à propos des marginaux : les dépossédés et les égarés ; les drogués, les alcooliques, et les passagers des bus « Greyhound ». Mais sous tout cela, il y a une tendresse bouleversante et une sinuosité métaphysique et personnelle qui vous plongent dans son monde comme peu d’autres auteurs savent le faire. Prenez ce passage : « Quand il était sobre, il croyait que c’était l’alcool dont il avait besoin, mais quand il but quelques verres, il sut que c’était autre chose, peut-être une femme ; et quand il eut tout – le cash, la gnôle et la femme – il ne put détourner le regard de l’immense vide qui l’emplissait toujours sans qu’il puisse y faire quoi que ce soit. » Si vous n’éprouvez rien lorsque vous lisez ceci, alors il n’y a rien que je puisse faire pour vous.
Moby Dick – Herman Melville : Les gens me regardent de travers quand je dis que Moby Dick est mon livre préféré, mais je maintiens. Je ne crois pas qu’il soit possible de l’égaler un jour : une très grande histoire d’aventure fondée sur l’intrigue la plus simple – l’homme versus la baleine – qui se transforme en une méditation sur le génocide, la métaphysique et l’éthique, mais ne perd jamais de vue l’intrigue ou ses personnages. Pour moi, c’est le meilleur roman jamais écrit. Il y a également le discours le plus grandiose jamais écrit dans un roman :
« -Laissez là, mais laissez donc, assistants adjoints ! Quelque peine que vous vous donniez pour plaire au monde, il n’en sera que plus, envers vous, sans merci ! Ah ! vider les Tuileries et Hampton Court pour vous !… Mais ravalez vos larmes et haut les cœurs, hissez-les au plus haut du mât ! Car les amis partis devant vous sont en train, jusqu’au septième et dernier ciel, de faire vider les lieux à tous les Gabriel, Michaël et Raphaël qui s’y prélassaient depuis trop longtemps, afin de vous y aménager vos appartements. Ici- bas, vous ne faites qu’entrechoquer vos cœurs déjà brisés ; mais là-haut, c’est un cristal inviolable et sans brisure que vous allez faire retentir ! »
C’est ce roman qui m’a mené à Faulkner, O’Connor, McCarthy et Johnson et c’est la seule langue qui me plait autant.
Trad. Lucie & Ted
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire