« Hanumân vomissait la province danoise.» C’est sur cette abrupte constatation que s’ouvre Le voyage de Hanumân, roman de Andreï Ivanov, qui raconte l’errance de deux clandestins sans papiers sur les terres danoises. Il y a tant à dire sur ce roman à la beauté furieuse, sur ce monument littéraire qu’on quitte hagard, sonné et finalement ébranlé, qu’une simple chronique ne fera qu’en effleurer la surface. Qu’importe, lançons-nous.
Hanumân et Eugène sont de vrais compagnons de route, au sens étymologique du terme «celui avec qui on partage le pain ». Mais en l’occurrence ces deux-là ne partagent pas que la nourriture. Ils partagent également l’argent, quand ils arrivent à en avoir, l’alcool et la drogue, qu’ils consomment à foison et surtout les galères, les petites et les grandes.
Ils se rencontrent au Danemark, où ils ont tous les deux échoués après avoir quitté leurs pays respectifs. On dit que les opposés s’attirent et Hanumân, l’indien qui rêve d’Amérique, l’habité au charme magnétique et à la personnalité volubile, a effectivement, en apparence, peu de choses en commun avec Eugène (ou Dgène, ou encore Johann), le narrateur, estonien sceptique et pessimiste qui semble n’avoir aucun projet précis.
Pourtant leur amitié se noue sur des bases communes. L’envie de bouger, d’aller voir l’ailleurs, l’énergie (parfois, souvent, l’énergie du désespoir), le caractère bien trempé et provocateur. Mais surtout leur volonté d’essayer de se (re)construire à l’ouest, en Occident où ils se heurtent aux mêmes regards :
Un regard si particulier… Tu le sens glisser sur la foule, sur la rue, les vitrines, et puis il tombe sur toi et s’y attarde, les yeux se rétrécissent, ils t’étudient, ils te déchiffrent comme on lit une pancarte, ils essaient de te mettre dans une case… Un regard qui classifie… Mais cela ne marchait pas. Il n’y avait pas de place pour nous dans la liste.
Le roman raconte donc les années qu’ils passent clandestinement dans un camp de demandeurs d’asiles, dans ville de Farstrup (au nord du Danemark) à la toute fin des années 90. Ils végètent entre petits trafics et grosses arnaques, dans l’attente de pouvoir se rendre à Låland, une destination fantasmée qu’Hanumân croit être « L’Ibiza du nord » et où, selon lui, ils pourront prendre un maximum de bon temps, consommer tout leur saoul drogues et femmes. Eugène, fidèle à lui-même reste dubitatif, mais, comme c’est souvent le cas dans le récit, il accepte les élucubrations de son ami.
En attendant, ils sont hébergés dans la chambre d’un jeune demandeur d’asile népalais qui a jeté son dévolu sur Hanumân et qui joue, bien malgré lui, le rôle d’un souffre-douleur. Ils errent dans une région qu’ils ont de plus en plus de mal à supporter, trop lisse, trop propre, trop factice, au point qu’ils posent sur le Danemark un regard absolument dégoûté. Entre les clandestins et le pays se mêlent incompréhension et rejet mutuel :
Dans ce monde soigneusement peigné tout était planifié ; pour deux misérables poux comme Hanny et moi, espérer trouver un recoin où se cacher, c’était pratiquement impossible. Partout des yeux, partout des caméras. Chacun avait son téléphone. Même les arbres avaient l’air d’avoir été plantés exprès pour nous surveiller, et faire passer des signaux à quelqu’un qui, forcément, surveillait les arbres.
Ce Danemark sera d’ailleurs toujours vu d’un à-côté, dans l’îlot qu’est le camp de réfugié, avec ceux qui vivent dans l’attente d’obtenir un statut de réfugié et de vivre cette fois avec les danois et non plus en marge. Les deux compères, eux, ne voient le pays que comme une zone transitoire et consacrent une grande partie de leur énergie à explorer des pistes pour se rendre dans d’autres pays. Enfin, c’est ce que souhaite Hanumân. Eugène, lui, n’a d’autre souhait que de rester quelques années loin de son pays.
Mais les mois passent et la vie au camp suit son cours avec son lot de promiscuité, de violence, de problèmes d’hygiène et d’anxiété. La communauté du camp est décrite grâce à une galerie de portraits des personnages qui côtoient les deux héros et qu’ils entrainent pour la plupart dans leur sillage, dans leurs petites magouilles et leurs grandes aventures.
Cette communauté cosmopolite, polyglotte, multiculturelle, réunie par la force des choses dans des locaux trop petits, insalubres, vivant dans une angoisse permanente, dans l’attente terrible de voir son sort scellé, souffrant de problèmes de communication, d’hygiène et des odeurs nauséabondes des engrais dispersés dans les champs alentours, peut imploser à tout moment. Une situation qui rend fou.
Et de fait, folie, dépression, dépendances à l’alcool et drogue, paranoïa, anxiété, désespoir, sont des maux qui vont toucher plusieurs personnages et plus particulièrement le narrateur et son compagnon de voyage :
Tout ici écrasait, torturait, mordait, poussait à la fuite, mettait en péril l’équilibre, rendait fou. Comme si on me chuchotait : « Aha ! Tu t’es laissé prendre ! Bon, puisque tu te déclares migrant, fais-nous le plaisir d’éprouver jusqu’au bout toute la gamme des affects de l’exilé ! » Il y aura la terreur archaïque qui persécute le genre humain depuis son apparition sur terre ; les sentiments envahissants d’indignation, d’offense, d’envie ; la peur biblique d’être poursuivi jusqu’à la fin de ses jours ; et la nostalgie, sentiment à la mode, mais tellement cruel ! La solitude, légendaire ; le fardeau des souvenirs, plus pesant de jour en jour ; la haine du monde qui avance comme une muraille ; la compassion envers soi-même ; l’humiliation et l’humiliation acceptée ; le dégoût de soi et encore plus de tout le reste […]
La narration erre parfois comme le font les personnages, elle dérive dans le temps, dans les lieux. Elle devient ce mouvement qui gravite autour du camp et elle porte admirablement cette mise en branle des énergies des deux personnages, qui reste vaine puisque, pendant plusieurs mois, ils ne font que tourner en rond, d’illusions en illusions, et l’on comprend ce que leur dérive a de terriblement angoissante, on comprend la folie, le désespoir et le dégoût.
Nous, capables d’action et de travail, employions cependant toutes nos forces à nous éloigner toujours plus de la possibilité d’occuper dans la société cette place que nous n’avions jamais eue, étant partout des étrangers. Et dans cette dérive sur un glaçon, Hanumân avait besoin d’être accompagné.
Entre les lignes se dessine peu à peu et avec une grande finesse l’ambivalence des sentiments, la complexité des rapports qui se nouent entre les gens du camp, entre amitié et rejet. On aide puis on arnaque, on trahit mais on pardonne. On est dans la même galère mais on a son propre objectif. On est témoin des bassesses des autres, de leur vice et de leur violence, mais on doit s’en accommoder. On se croise, on picole, on se défonce, on fait du trafic ensemble, mais se lie-t-on ? Peut-on réellement se lier quand on finit par être déconnecté de tout, y compris de soi-même ?
Le narrateur, observateur et introverti, fait l’amer constat de sa défaite morale face à deux jeunes Serbes et à l’ersatz de relation amoureuse qu’il vit avec l’une d’entre elles, Violetta. Mais, malgré l’angoisse, malgré l’instabilité, la dépression, certaines digues ne cèdent pas.
Tout au long du récit Andreï Ivanov trace des lignes troubles, qui balaient furieusement toute notion de manichéisme. Son narrateur navigue entre le mensonge et l’imagination, la fuite et la créativité. L’écriture cultive le flou. Sa véritable histoire est à peine esquissée, devinée à travers les mensonges qu’il sert aux autres, parfois avec délice, mais le délice d’un drogué qui ne se contrôle pas.
Le rêve, en définitive, est un danger, et ce qui se rapproche le plus de lui, c’est l’art. Mais quand l’art est purifié de toutes les rêveries, qu’il parvient à un poli de miroir dans son imitation de la vraie vie, alors le rêve, sous les espèces de l’art, le rêve n’est pas nocif, non, et l’on prend conscience que le meilleur substitut de la drogue, c’est l’art !
Dans une langue crue, brutale, argotique, mais qui n’est pas dénuée d’un humour corrosif, Andreï Ivanov s’inspire de ce qu’il a lui-même vécu pour décrire ce camp de réfugié, cette vie à la fois abrutissante et terrifiante. Il donne à voir le miroir d’une vérité, sans angélisme ni compromis, dans ce quel a d’absurde et de brutal, d’émouvant et dérangeant.
Il y a dans son écriture une force renversante, quelque chose de la prose de Céline, faite de révolte et de marginalité. Une fureur à la fois fait rire et qui serre la gorge et qui ouvre bien grands les yeux sur cet à-côté qu’on ne peut plus ignorer.
Pour finir, sachez que ce roman, qui paraît en septembre aux éditions Le Tripode, est le premier d’une trilogie scandinave dont l’auteur parle en détail au cours d’un long entretien accordé à Diacritik.
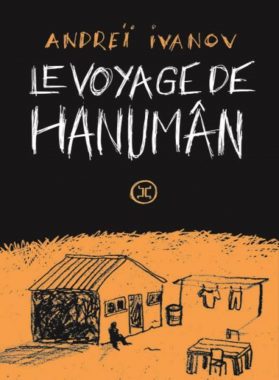
Éditions le Tripode
Roman traduit du russe (Estonie) par Hélène Henry
440 pages.
Hédia
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

