
Milkman avance comme un nuage. Sa silhouette apparait au fond des premières lignes et gagne le récit avec rapidité, par une journée qu’il faut avouer couverte, chargée, dépressionnaire. Au-dessus des villes d’Irlande du Nord évolue un ciel plein de plomb et cette journée, ça fait longtemps qu’elle dure.
Années 70 : les Troubles. Des fils, des frères, s’engagent et meurent, et les soeurs et les épouses n’ont pas que ça à faire de les pleurer, et les mères non plus. Ce n’est pas parce qu’il y a des morts qu’on acquiert des passe-droits, pas plus qu’on ne se soustrait au quartier. Il n’y a encore que les parents de Machin McMachin pour s’arroger ça, brillant à la télé loin de leurs enfants.
Pas que ça à faire de les pleurer, mais malgré tout, ça arrive : de temps en temps on s’y dédie, aux pleurs, au passé, à leur transmission. On ménage un temps et un espace. C’est là que s’élabore un certain type de récit, musculeux, cathédral, proche de la tragédie dans l’épuisement de la voix qui le porte, proche de l’hagiographie dans les portraits auxquels il s’assigne. (À une glycine de là, c’était Absalon, Absalon ! de Faulkner.) M’ma s’attable, vraiment, c’est peut-être à la cuisine et c’est ça qu’elle fait, comme dans le jargon policier : elle se met à table : elle raconte. L’histoire de vrai laitier, figure quasi christique. D’autres histoires s’échappent selon le même procédé, comme celle de la fille aux cachetons et de Machin McMachin.
Machin McMachin est nommé très tôt. Avec d’autres personnages (peut-être-petit-ami, beau-frère, et les frères et soeurs numérotés), il monte un décor. La narratrice colle autour d’elles ces désignations, ces unités de sens que constituent les noms, quoiqu’elle n’ait pas l’air d’y croire — noms qui n’en sont pas, zones indéterminées, pointées du doigt comme on circonscrit des pâtés de maisons. Les gens se font nommer comme des lotissements. Pour rentrer du travail, elle doit franchir un faubourg interlope dont on vient à bout en dix minutes. D’où le nom qu’elle lui donne : la “zone des dix minutes”. Voilà comment elle désigne. Est-ce sous l’effet d’une très puissante lassitude ? ou pour éviter d’avoir à utiliser des termes plus coupants ?
Est-ce que c’est ça, la raison : l’évitement de la violence ? Trop de violence dans les familles, dans chaque coin des arbres généalogiques : la mort, la taule. Pas de passe-droits pourtant, alors pour se constituer un semblant de vie étale on polit, on érode ? On masque, on cherche à pas voir, pas voir, mais tout entre de biais, c’est juste frontalement que ça se nomme à l’aide de bouts de mots inoffensifs.
Monte une sorte de brume tout autour d’elle, dans les quartiers sans nom, villes sans nom…
Je ne suis pas sûr que le pays soit une seule fois nommé. Nébuleuse, chape sous laquelle on voit mal, mal, mal, à rien y comprendre, silhouettes qu’on reconnait par habitude et dont on a renoncé (parce qu’il y a de bout en bout ce thème du renoncement, qui draine le texte, et la narratrice, et le lecteur à mesure) à établir la netteté.
Parce que si c’est net, ça coupe.
Une brume. Une langue de brumes. Une brume.
Avec une telle opacité, cette purée de pois, ces lignes grises qui brouillent la ligne des façades, la trajectoire des voitures et les rives du canal, forcément qu’on plisse les yeux.
On veut discerner malgré tout.
La violence nous vrille dans un sens puis dans l’autre. On veut pas voir / on veut voir.
On veut nommer.
Et on nomme, ça a beau être flou, être mal vu. Mal vu mal dit, intitulait Beckett.
On veut continuer à dire. Dans la purée de pois on plisse donc les yeux, on dit ce qu’on peut, comme on croit, et quand l’image est perturbée de lignes grises on les remplace par ce qui nous semble bon, vraisemblable, juste, etcétéra jusqu’à la belle, pleine, inéluctable accession de notre mal-vu-mal-dit au titre d’histoire.
Et la rumeur devient l’histoire.
Deux-points ouvrez les guillemets,
soeur du milieu, dix-huit ans et narratrice, rentre chez elle. Un homme l’aborde.
Elle est revue une autre fois, cafouillée d’une autre bardée de lignes grises, en même compagnie.
C’est qu’ils se connaissent, maintenant. Qu’ils se fréquentent.
L’homme n’en finit pas de l’aborder, c’est ce que nous dit la narratrice, chapitre après chapitre (un chapitre pour chaque alerte).
La seule histoire possible est celle-ci, que mettent en place les bouches des proches, voisins, passants. La narratrice, c’est pour elle-même qu’elle résiste. Je veux dire que son récit n’a aucun pouvoir. Elle nous le tricote patiemment, elle s’attache à tout détailler, mais qu’est-ce qu’on y pourra, nous ? Nous, lecteurs fantômes ? L’histoire est élaborée par la communauté. Entre les bombes (rares, dit-elle) et les deuils (plus de passés que de présents, bien sûr), la rumeur agit, maligne, comme lien social. Milkman apparait, une fois, puis deux, trois et davantage. Il y a sept chapitres.
Alors, ce Milkman, ce nuage. Parce qu’il avance comme ça. Le texte s’ouvre sur ce qu’il me semble terriblement injuste d’appeler leur première rencontre, comment dire alors, la première irruption de Milkman. Un gros nuage sombre qui vient sur nous très vite. Il nous couvre de toute sa longueur. Le texte entier s’assombrit de sa présence. C’est une chape considérable, et une prise de pouvoir.
Dans l’histoire des États, des indépendances et des sécessions, existe cette formule : de facto. À l’heure où le pays se scinde, s’éructe, se distord, la vie de la narratrice elle-même devient le théâtre d’une expérience inédite : elle fréquente un homme de facto. À l’inverse de sa relation avec peut-être-petit-ami, il n’y a rien à accepter. On ne lui demandera pas de se prononcer. L’homme la rencontre. Il est là, se matérialise. Au fil des apparitions, les gens se mettent à croire à la liaison. Loin d’eux, pourtant, l’idée de l’approuver. Les reproches pleuvent, absurdes, la rincent.
Milkman et l’histoire qu’il impose, ce nuage et le gigantesque récit de pénombre au-dessous, laissent de moins en moins de place pour la narratrice, pour son corps, pour son individualité. De toute part l’histoire la compresse.
C’est un récit d’asphyxie.
L’évanouissement intervient à l’avant-dernier chapitre.
Récit, quartier, société au sein desquels on navigue à vue. C’est la brume et la guerre, c’est latent, rien de quotidien mais une bombe de temps en temps, voiture piégée, poison dans les clubs et convalescences prolongées. Chaque foyer remâche ses deuils, tout ce qu’on peut faire c’est louvoyer, et dans les récits c’est pareil. On pare au plus pressé. La narratrice, c’est l’inverse, elle détaille tout. Elle se tue à pister le vrai. Mais c’est la brume, la lourde brume épaisse de la guerre, soeur du milieu. Elle enterre les têtes de chats, traverse les zones dangereuses le nez dans ses bouquins, n’en fait qu’à sa tête. Et tous, ils sont bien décidés à lui faire comprendre que dans cette brume-là, on ne peut pas se permettre d’en faire qu’à sa tête, et qu’il n’y a pas de raison qu’on lui passe ça, cette indépendance-là.
S’ils l’étaient, indépendants, les gens auraient des prénoms. Machin McMachin, passe encore : il s’agit de le dénigrer un peu, en dépit du lourd tribut familial. Mais ceux qui mériteraient un nom n’en ont pas : meilleure-amie, peut-être-petit-ami, beau-frère, les frères et soeurs numérotés. Soeur du milieu, la narratrice, ne déroge pas à la règle. Elle devrait à la rigueur s’appeler narratrice. Raconteuse d’histoire. Surement qu’on lui en ferait le reproche : raconteuse d’histoire, toi qui mens comme tu respires. Alors quoi, l’asphyxie ?
Pas d’indépendance qui tienne.
Cette lecture-en-marchant, et l’inaccessible entêtement qui en est le fond, plus les dangers inhérents, voilà les raisons de notre rendez-vous ici ce soir. Mais tu sais” — et elle a marqué un temps, car elle semblait frappée par l’une de ces intuitions, une illumination transcendante, contemplative — “c’est peut-être aussi bien, je veux dire, curatif — et même si c’est d’une façon peu agréable, pluie et beau temps, souffrance et leçon — que cette prédation de Laitier ait lieu. Tu refusais d’être présente et maintenant la circonstance de Laitier te force à l’être, c’est l’un de ces rappels à la réalité que t’offre la vie — pour te ressaisir, pour te faire grandir, pour te mettre sur la voie de la prochaine étape de ton cheminement personnel. Et de ce que j’en vois, amie, la seule chose qui y soit jamais parvenue dans ton cas, c’est l’apparition de Laitier dans ton petit monde.” Là je me suis dit tiens, quelle connasse satisfaite, et je l’ai dit, mais elle a répondu que non et qu’il n’y avait aucune raison d’en faire une affaire personnelle, pourtant qu’est-ce qu’elle en faisait au juste, elle, sinon une affaire personnelle ? Elle a dit qu’il nous fallait rester concentrées sur le vrai sujet. Qui était : je décontenançais la communauté avec ma lecture-en-marchant ; certaines personnes ne se laissaient pas terriblement analyser, mais ça n’empêchait pas les autres de le faire quoi qu’il en soit ; nul ne devait déambuler dans un théâtre politique la tête ailleurs ; j’étais anormalement perturbée par les questions sociales, les interrogations banales, même d’anodines demandes d’information, même si j’objectais, même si je disais que si, j’accueillais les questions, en fait, non — elle a secoué la tête — tout ce que j’accueillais, c’était les questions de littérature, et encore, uniquement relatives au dix-neuvième siècle ou auparavant. Le sujet, et aussi, dit-elle, mon refus de me départir de ma torpitude faciale et physique, en dépit du fait que tous savaient que la torpitude est une protection inefficace par chez nous. Sans compter que la fille qui marche — “La fille qui marche ? — Oui. Tu es la fille qui marche. Parfois celle qui rit et d’autres fois, la fille pâle, adamantine, inflexible, qui déambule avec ses idées arrêtées, confinées.”
(p. 185-186)
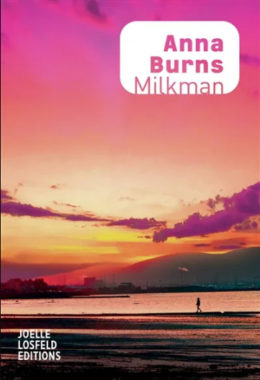
Milkman,
Anna Burns.
Traduit de l’anglais (Irlande du Nord) par Jakuta Alikavazovic.
Editions Joelle Losfeld,
février 2021.
Olivier
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

