– Alors, libraire, chroniqueur, c’est une bonne situation, ça ?
– Mais, vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation… Moi, si je devais résumer mon expérience de lectrice aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, des livres ou des auteurs qui m’ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seule chez moi. Et c’est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée littéraire… Parce que quand on a le goût de la littérature, quand on a le goût de la littérature bien faite, le beau style…
– Oui bon ça va, je crois qu’on a compris l’idée. Présente-nous plutôt tes coups de coeur, si tu veux bien…
-
ANATÈM – Neal Stephenson (Albin Michel Imaginaire)
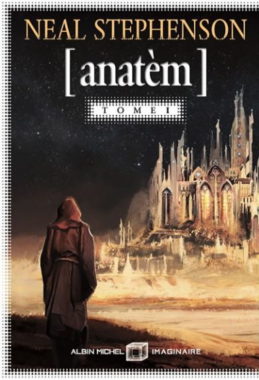 Imaginez quel rapport à la connaissance nous aurions, si nous vivions coupés de la société pendant de longues périodes de temps déterminé ; si nous n’avions accès à ce qui s’est produit dans le monde qu’une fois tous les 10 ans. Ou 100 ans. Ou un millier d’années. Étendez maintenant ce principe à la communauté de scientifiques de toute une planète, habitant de gigantesques monastères conçus pour abriter un savoir encyclopédique accumulé depuis des siècles, et consacrant toute leur existence à l’étude. Vous aurez alors un petite idée de l’univers d’Arbre, la planète où se déroule Anatèm, différent du nôtre par bien des aspects – et pourtant étrangement semblable.
Imaginez quel rapport à la connaissance nous aurions, si nous vivions coupés de la société pendant de longues périodes de temps déterminé ; si nous n’avions accès à ce qui s’est produit dans le monde qu’une fois tous les 10 ans. Ou 100 ans. Ou un millier d’années. Étendez maintenant ce principe à la communauté de scientifiques de toute une planète, habitant de gigantesques monastères conçus pour abriter un savoir encyclopédique accumulé depuis des siècles, et consacrant toute leur existence à l’étude. Vous aurez alors un petite idée de l’univers d’Arbre, la planète où se déroule Anatèm, différent du nôtre par bien des aspects – et pourtant étrangement semblable.
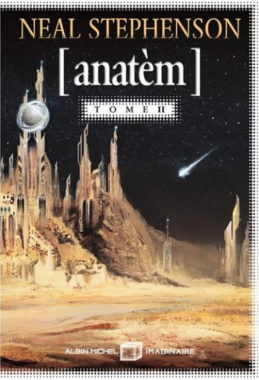
Par son indéniable complexité, le roman demande au lecteur de s’accrocher sur les premières pages, mais ce n’est que pour mieux se régaler sur la longueur, avec une intrigue qui ne cesse de monter en puissance : le vertige métaphysique et le frisson de l’aventure n’ont peut-être jamais fait aussi bon ménage que sous la plume de Neal Stephenson.
Anatèm a donc tout ce qu’un amateur de SF philosophique et scientifique peut espérer ; par dessus le marché, il est parfois très drôle – ce dès les toutes premières pages. Il est rare d’avoir des lectures aussi réjouissantes, qui donnent l’impression de renouer avec l’exaltation du jeune lecteur qu’on a pu être enfant. Anatèm est probablement le livre qui, depuis Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, est parvenu le mieux à susciter chez moi ce type si particulier d’enthousiasme.
Avertissement : Il y a un risque pour qu’à l’issue de votre lecture, vous ne vous exprimiez plus qu’avec les néologismes et concepts arbriens, suscitant incompréhension et désarroi dans votre entourage. Enfin, après tout, ils n’ont qu’à lire le livre eux aussi…
Anatèm, tomes I et II, Neal Stephenson, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jacques Collin, Albin Michel Imaginaire, 2018 (656 p. et 560 p.)
-
BARA YOGOÏ – Léo Henry & Jacques Mucchielli (Dystopia)

Inventée par Jacques Mucchielli et Léo Henry comme terrain de leurs expérimentations littéraires communes, alors qu’ils vivaient à plusieurs milliers de km de distance, la ville de Yirminadingrad a pris consistance au fur et à mesure de leurs nouvelles pour donner lieu en 2008 à un premier recueil, Yama Loka Terminus. C’est aussi le début d’une complicité avec le dessinateur Stéphane Perger, dont les illustrations font partie intégrante de l’univers Yirminite.
Yirminadingrad est une cité post-industrielle, située quelque part au bord de la Mer Noire, rongée par la guerre et les lendemains qui déchantent. Mais ce sont encore ses habitants qui la décrivent le mieux : leurs voix, leurs rêves et leurs luttes, sont la matière essentielle d’un imaginaire dystopique dont les inspirations vont chercher du côté de Volodine, Ballard et tant d’autres.
Chez Léo Henry et Jacques Mucchielli, les récits confinent au mythe, l’écriture toujours ciselée, évocatrice voire onirique, est propre à convoquer des réalités glauquissimes comme les plus beaux accents d’humanité. Si tous les recueils sont à lire (Adar, qui réunit des nouvelles de nombreux auteurs de l’imaginaire, ou encore Tadjélé et ses magnifiques récits d’exil), on retiendra pour cette sélection Bara Yogoï : deuxième volume, peut-être le plus expérimental et énigmatique de tous, tout simplement le premier que j’aie eu entre les mains. Ça ne s’oublie pas.
A lire également, la chronique de Marcelline sur Yama Loka Terminus et son ITW de Léo Henry.
Bara Yogoï. Sept autres lieux, Léo Henry, Jacques Mucchielli et Stéphane Perger, éditions Dystopia, 2010 (150 p.)
-
BASSE SAISON – Guillermo Saccomanno (Asphalte)
 L’immense et sinueuse première phrase de Basse Saison, que Guillermo Saccomanno reprenant Baudelaire adresse à son « hypocrite lecteur, [son] semblable », donne le ton. On dirait presque une version en modèle réduit du roman dont elle est l’amorce : tableau vivant, elle détaille tout ce qui pourrait être en train de se produire, à ce moment T de la nuit, dans la vie de dizaines d’anonymes dont l’existence est ainsi capturée sur le vif, comme un instantané.
L’immense et sinueuse première phrase de Basse Saison, que Guillermo Saccomanno reprenant Baudelaire adresse à son « hypocrite lecteur, [son] semblable », donne le ton. On dirait presque une version en modèle réduit du roman dont elle est l’amorce : tableau vivant, elle détaille tout ce qui pourrait être en train de se produire, à ce moment T de la nuit, dans la vie de dizaines d’anonymes dont l’existence est ainsi capturée sur le vif, comme un instantané.
De la fin d’un été à la veille d’un autre, Basse saison dresse le glaçant portrait d’une station balnéaire qui se languit de sa gloire estivale : c’est l’envers du décor d’une destination « paradisiaque », pétrie par la violence sociale, le crime et l’exclusion, où les fantômes du fascisme n’ont absolument rien d’éthéré.
On y suit le quotidien de ses habitants à la manière d’une chronique de moeurs, scandée par les articles d’un journal local. La prose de Guillermo Saccomanno est toujours remarquable, dense d’une érudition littéraire bien assimilée, saisissante par l’intransigeance de son réalisme. Pas d’héroïsme et somme toute assez peu d’espérance ici.
Il semble souvent y avoir quelque chose de convenu à dire d’un roman – surtout un roman noir – qu’on n’en « ressort pas indemne » ; on aurait pourtant du mal à décrire autrement l’effet produit par celui-ci.
A lire également : la chronique de Ted sur Basse Saison.
Basse Saison, Guillermo Saccomanno, traduit de l’espagnol (Argentine) par Michèle Guillemot, éditions Asphalte, 2015 (592 p.)
-
BAGDAD, LA GRANDE ÉVASION ! – Saad Z. Hossain (Agullo)
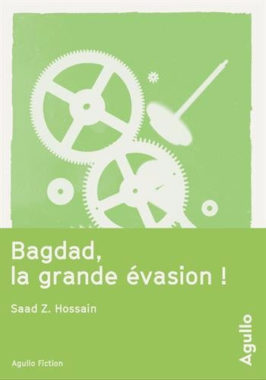 Le roman du Bangladais Saad Z. Hossain nous propulse in medias res, à Bagdad, peu après l’invasion américaine qui initia la guerre d’Irak. On y assiste à une scène d’interrogatoire pour le moins insolite : Dagr, ancien professeur d’économie mu par le besoin urgent de fuir le chaos de cette ville, et Kinza, un revendeur d’armes qui en veut à la terre entière, s’interrogent sur le sort à réserver à leur prisonnier, colonel du parti de Saddam Hussein et ancien tortionnaire lui-même. Passant marché pour sa vie, il leur propose de les guider vers un trésor caché en plein désert, et c’est une étonnante équipée qui va se mettre en place, composée de Dagr, Kinza, leur prisonnier, et l’inénarrable soldat Hoffmann. Avec un impressionnant sens du rythme et du rebondissement, l’auteur nous entraînera sur les traces d’un mystérieux assassin surnommé le Lion d’Akkad, et des secrets de la civilisation druze.
Le roman du Bangladais Saad Z. Hossain nous propulse in medias res, à Bagdad, peu après l’invasion américaine qui initia la guerre d’Irak. On y assiste à une scène d’interrogatoire pour le moins insolite : Dagr, ancien professeur d’économie mu par le besoin urgent de fuir le chaos de cette ville, et Kinza, un revendeur d’armes qui en veut à la terre entière, s’interrogent sur le sort à réserver à leur prisonnier, colonel du parti de Saddam Hussein et ancien tortionnaire lui-même. Passant marché pour sa vie, il leur propose de les guider vers un trésor caché en plein désert, et c’est une étonnante équipée qui va se mettre en place, composée de Dagr, Kinza, leur prisonnier, et l’inénarrable soldat Hoffmann. Avec un impressionnant sens du rythme et du rebondissement, l’auteur nous entraînera sur les traces d’un mystérieux assassin surnommé le Lion d’Akkad, et des secrets de la civilisation druze.
Dans la famille des livres aussi complets et savoureux qu’une galette bretonne à la chandeleur, je voudrais : un roman de guerre qui sache distiller dans son récit les informations nécessaires à la compréhension des forces en présence, capable d’éclairer un contexte géopolitique au demeurant complexe. Je demande : le récit rocambolesque d’une fuite en avant, dont les péripéties improbables semblent pourtant s’enchaîner le plus logiquement du monde. Je demande encore : des dialogues d’une vivacité et d’une répartie confondantes, noirs mais surtout extrêmement drôles. Et puis, l’érudition de développements consacrés à l’Histoire et la civilisation d’un territoire qui ne se réduit pas aux conflits armés dont il est le théâtre. Ajoutons à tout cela des personnages – et quels personnages ! – si vivants et bien caractérisés qu’il serait vraiment difficile de les oublier.
Bagdad, la grande évasion ! Est un roman qui mélange les styles, les registres et les genres, pour obtenir un cocktail explosif dont, semble-t-il, l’auteur est le seul à détenir la recette. Parmi les meilleures découvertes que nous devons aux éditions Agullo, celle-ci n’est pas des moindres, et c’est peu dire que j’attends avec impatience de pouvoir lire un autre roman de Saad Z. Hossain…
Bagdad, la grande évasion !, Saad Z. Hossain, traduit de l’anglais (Bangladesh) par Jean-François Le Ruyet, éditions Agullo, 2017 (380 p.)
-
L’ÂME DES HORLOGES – David Mitchell (L’Olivier)
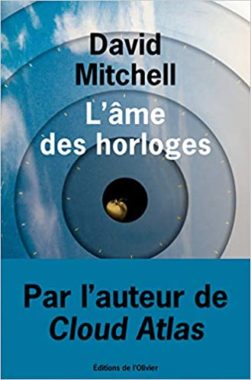 Holly Sykes, 15 ans, serait une jeune Anglaise tout à fait banale si elle n’entendait, depuis son enfance, des voix qui lui parlent : « les gens de la radio », comme elle les appelle. Mais c’est lors d’une fugue, suite à une dispute avec sa mère, que son univers va basculer et le nôtre avec : la rencontre de personnages étranges, qui semblent la connaître, des visions de cauchemar, et surtout, la disparition subite de son petit frère. Une tragédie familiale qui marquera du même coup la fin de sa rébellion d’adolescente, et l’enclenchement d’événements extraordinaires, qui la dépassent aussi bien qu’ils semblent toujours, étrangement, la concerner.
Holly Sykes, 15 ans, serait une jeune Anglaise tout à fait banale si elle n’entendait, depuis son enfance, des voix qui lui parlent : « les gens de la radio », comme elle les appelle. Mais c’est lors d’une fugue, suite à une dispute avec sa mère, que son univers va basculer et le nôtre avec : la rencontre de personnages étranges, qui semblent la connaître, des visions de cauchemar, et surtout, la disparition subite de son petit frère. Une tragédie familiale qui marquera du même coup la fin de sa rébellion d’adolescente, et l’enclenchement d’événements extraordinaires, qui la dépassent aussi bien qu’ils semblent toujours, étrangement, la concerner.
Auteur du magnifique Cloud Atlas, David Mitchell s’était déjà illustré par sa virtuosité à orchestrer des intrigues d’ampleur monumentale, tout restant à hauteur de vue de ses personnages extrêmement attachants. C’est le cas de L’âme des horloges, immense fresque romanesque courant de l’année 1984 à 2043.
A l’échelle de la vie de son personnage se superpose celle, démesurée, des forces surnaturelles et immortelles qui s’affrontent aux dépens des humains.
Ce qui caractérise aussi David Mitchell, c’est l’aisance confondante avec laquelle il passe d’un genre à l’autre : chacune des parties de l’histoire embrassant le point de vue d’un personnage lié, de près ou de loin, à Holly Sykes, le lecteur verra ainsi alterner des épisodes fantastiques avec, par exemple, une plongée psychologique dans les traumatismes d’un journaliste de guerre, ou encore une satire acide du milieu littéraire britannique… Pour, finalement, être transporté dans une fiction d’anticipation apocalyptique, parmi les plus convaincantes et saisissantes qu’il nous ait été donné de lire ces dernières années.
L’âme des horloges fait partie de ces romans qui peuvent nous tenir en haleine sur près de 800 pages, non seulement pour son intrigue passionnante, mais aussi parce que l’auteur parvient à provoquer une telle empathie pour ses personnages qu’il devient hors de question de les quitter. La base de tout bon roman, me direz-vous : oui, mais qui y arrive aussi bien ?
L’âme des horloges, David Mitchell, traduit de l’anglais par Manuel Berri, éditions de l’Olivier, 2017 (780 p.)
-
SOLÉNOÏDE – Mircea Cărtărescu (Noir sur Blanc)
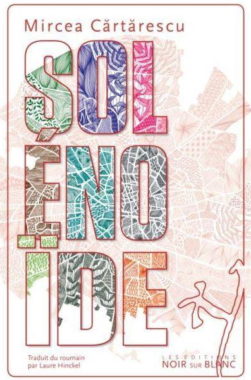 Pour le narrateur de Solénoïde, nous sommes tous piégés dans notre propre crâne : le langage est une prison, la littérature, rien d’autre qu’un art de peindre des portes en trompe-l’œil sur les murs de ce labyrinthe, échouant à percer des brèches vers le réel. Corrélat de son solipsisme, le seul acte d’écriture qui vaille à ses yeux est le journal intime. Il y fera l’inventaire de ses rêves, obsessions, souffrances physiques, s’égarera dans le dédale de ses réminiscences et visions hallucinées pour mieux trouver la sortie.
Pour le narrateur de Solénoïde, nous sommes tous piégés dans notre propre crâne : le langage est une prison, la littérature, rien d’autre qu’un art de peindre des portes en trompe-l’œil sur les murs de ce labyrinthe, échouant à percer des brèches vers le réel. Corrélat de son solipsisme, le seul acte d’écriture qui vaille à ses yeux est le journal intime. Il y fera l’inventaire de ses rêves, obsessions, souffrances physiques, s’égarera dans le dédale de ses réminiscences et visions hallucinées pour mieux trouver la sortie.
Mircea Cărtărescu signe un édifice hors-normes dont la clé de voûte est Bucarest. Les enchaînements de descriptions dynamiques y dressent la cartographie mentale d’une ville qui s’éprouve comme un cauchemar éveillé. Il trouve ses fondations dans un tableau au réalisme grinçant de la vie sous Ceausescu pour se déployer en un chef-d’œuvre de fantastique, onirique et métaphysique, où le vertige nous guette à chaque page.
Mircea Cărtărescu n’est pas très connu en France, et franchement c’est dommage ! Il s’agit sans doute de l’un des écrivains les plus fascinants des dernières décennies ; son très baroque et métaphysique Solénoïde n’est pas une obscure curiosité venue de l’Est : c’est une oeuvre absolument brillante, qui malgré des allures de pavé imbitable, est un roman qu’on a réellement du mal à lâcher une fois commencé, du genre à vous valoir de belles nuits de lecture insomniaque !
Solénoïde, Mircea Cartarescu, traduit du roumain par Laura Hinckel, éditions Noir sur Blanc, 2019 (800 p.)
-
RÊVES DE GLOIRE – Roland C. Wagner (L’Atalante)
 Voici sans doute le roman le plus abouti de Roland C. Wagner, à qui l’on doit une œuvre de science-fiction extrêmement originale, offrant des variations déjantées sur des thèmes aussi ardus que l’instabilité du réel : Rêves de gloire, lui, nous fait quitter le space opera pour l’Histoire de l’Algérie des années 60 à nos jours.
Voici sans doute le roman le plus abouti de Roland C. Wagner, à qui l’on doit une œuvre de science-fiction extrêmement originale, offrant des variations déjantées sur des thèmes aussi ardus que l’instabilité du réel : Rêves de gloire, lui, nous fait quitter le space opera pour l’Histoire de l’Algérie des années 60 à nos jours.
Le nœud de cette uchronie pour le moins audacieuse, c’est le succès de la tentative d’assassinat du le Général De Gaulle au Petit Clamart en 1962. Roland C. Wagner en explore les conséquences, à commencer qu’une partie de l’Algérie, la région d’Alger, demeure une enclave française.
C’est à travers un roman polyphonique, dont les voix restent en majorité anonymes, et suivant comme un fil rouge les recherches d’un collectionneur de vinyles en quête d’un disque apparemment maudit, que Roland C. Wagner nous dépeint cette version alternative de l’Histoire contemporaine, où Alger devient également le berceau de la scène rock psychédélique et d’une communauté hippie… Et en fait, c’est comme si on y était. Au colossal travail de documentation en amont du livre, répond le talent de l’écrivain pour nous immerger dans l’esprit d’une époque, quand bien même celle-ci n’aurait pas existé !
Rêves de gloire, Roland C. Wagner, L’Atalante, 2011 (704 p.)
-
ÉPÉPÉ – Ferenc Karinthy (Zulma)
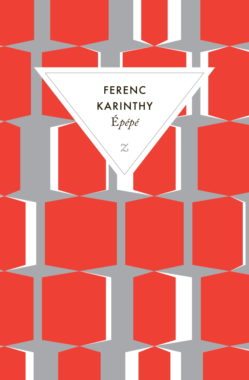 « Epépé », ou « ébébé », ou « étyétyé », en fait on ne sait pas très bien. Il faut dire que ce qui donne au roman son titre est la transcription de ce que son personnage principal croit entendre dans la bouche des habitants du pays de fous où il a atterri par erreur. Mais rembobinons : Budaï, un linguiste hongrois, homme de bon sens à l’esprit d’analyse, s’endort dans l’avion censé le mener à Helsinki pour le congrès où il se rendait, et se réveille… dans une sorte de cauchemar pour linguiste.
« Epépé », ou « ébébé », ou « étyétyé », en fait on ne sait pas très bien. Il faut dire que ce qui donne au roman son titre est la transcription de ce que son personnage principal croit entendre dans la bouche des habitants du pays de fous où il a atterri par erreur. Mais rembobinons : Budaï, un linguiste hongrois, homme de bon sens à l’esprit d’analyse, s’endort dans l’avion censé le mener à Helsinki pour le congrès où il se rendait, et se réveille… dans une sorte de cauchemar pour linguiste.
Il débarque ainsi dans une cité inconnue, immense, où les gens parlent un langage qui lui est absolument inintelligible, à lui qui a pourtant l’expérience de dizaines de langues. Tandis qu’il s’obstine à essayer d’extraire un sens du chaos des phonèmes, nous nous rendrons compte qu’il est non seulement incapable d’atteindre la moindre signification, mais même d’identifier quelque signe que ce soit derrière les sonorités de cette langue obscure. Ce sont même les comportements des habitants, leurs manières, qui lui sont imperméables, interdisant toute interaction satisfaisante avec eux. Sans aucun moyen de quitter cette société aussi étrange qu’oppressante, il devra trouver les moyens d’y survivre.
De ce postulat étonnant, Ferenc Karinthy fait une histoire inquiétante, dont l’intérêt ne se résume pas à ces enjeux linguistiques, déjà proprement fascinants. Outre la communication à travers un langage articulé et signifiant, c’est tout un ensemble de signaux empathiques et manifestations de reconnaissance basiques qui semblent faire défaut dans le récit. L’absence de ces conditions, indispensables pour faire société, plongeront le personnage de Budaï dans une solitude aliénante et déshumanisante.
S’insinue alors une inquiétude bien familière aux lecteurs de Kafka, celle qui surgit quand l’autre, dans son impénétrable extériorité, nous devient non seulement étranger mais hostile…
Épépé, Ferenc Karinthy, traduit du hongrois par Judith et Pierre Karinthy, éditions Zulma, 2013 (285 p.)
-
KALPA IMPERIAL – Angelica Gorodischer (La Volte)
 La chroniqueuse dit : les onze récits qui composent le recueil d’Angelica Gorodischer dessinent le portrait d’un empire imaginaire, “le plus vaste qui ait jamais existé”, qu’un mystérieux narrateur nous présente sous ses multiples facettes ; il nous conte ses chutes et ses renaissances, évoque les figures marquantes des Empereurs et Impératrices se succédant à sa tête, jusqu’à celles de ses habitants les plus humbles.
La chroniqueuse dit : les onze récits qui composent le recueil d’Angelica Gorodischer dessinent le portrait d’un empire imaginaire, “le plus vaste qui ait jamais existé”, qu’un mystérieux narrateur nous présente sous ses multiples facettes ; il nous conte ses chutes et ses renaissances, évoque les figures marquantes des Empereurs et Impératrices se succédant à sa tête, jusqu’à celles de ses habitants les plus humbles.
Kalpa Imperial relève de tant de genres, évoque tant de références littéraires, que l’on serait bien en peine de le ranger dans une catégorie : on pense aux Villes Invisibles d’Italo Calvino et ses utopies dialoguées, aux exacerbations hyperboliques de Borgès, au conte philosophique ou à des paraboles, propices à une méditation sur la nature du pouvoir et la pérennité des corps politiques. S’il emprunte sans aucun doute à la fantasy, l’univers de Kalpa Imperial ne présente pas la cohérence de fond que l’on peut trouver dans ce genre : on serait bien en peine d’en dresser un background pour y développer des scénarios de jeu de rôle, car ses contours sont aussi flous dans l’espace que dans le temps.
C’est que la cohésion du recueil est bien plus à chercher du côté de la narration, des idées et du style. Il s’en dégage une impression de totalité et de foisonnement infini ; l’écriture-fleuve de l’autrice, impétueuse et colorée de mille nuances, jouant aux limites de l’oralité, nous déstabilise et nous émerveille tour à tour. Conteuse des conteuses, il nous faut avant tout la suivre et lui faire confiance, comme si l’on écoutait un récit au coin du feu.
Kalpa Impérial, Angelica Gorodischer, traduit de l’espagnol (Argentine) par Mathias de Breyne, éditions La Volte, 2017 (246 p.)
-
LA GUERRE EST UNE RUSE – Frédéric Paulin (Agullo)
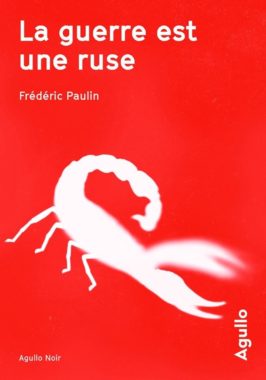 Premier volet d’une trilogie dont le dernier volet est sorti tout récemment, La Guerre est une ruse est un roman noir d’une exceptionnelle maîtrise, qui nous plonge au coeur de la période sombre des années 90 en Algérie.
Premier volet d’une trilogie dont le dernier volet est sorti tout récemment, La Guerre est une ruse est un roman noir d’une exceptionnelle maîtrise, qui nous plonge au coeur de la période sombre des années 90 en Algérie.
Suite à la victoire électorale du parti Islamique, en janvier 1992, une poignée de généraux s’empare du pouvoir par un coup d’Etat. Le bras de fer engagé entre ce gouvernement des « janviéristes » et les groupes islamiques armés des maquis, plonge le pays dans une véritable guerre civile. S’interrogeant sur le rôle obscur que semblent jouer les Services de renseignement militaire, Tedj Benlazar, un agent des services secrets français, mène une enquête périlleuse qui nous entraînera, à sa suite, dans les rouages des années de plomb algériennes.
Passionnant par son sujet, le livre de Frédéric Paulin parvient à nous rendre accessible cette période complexe et méconnue de l’Histoire récente, par la seule force du récit romanesque. Sur le fil d’une narration implacable, elle s’incarne dans des personnages extrêmement humains. On passe un moment de lecture intense, fort en émotion et en suspense, et très éclairant. Les fils tirés par l’intrigue nous amènent ainsi à saisir plus en profondeur des enjeux contemporains : les ressorts du terrorisme islamiste et de la lutte anti-terroriste, le rôle des services secrets, mais aussi les rapports post-coloniaux entre la France et l’Algérie.
A lire également : la chronique de La Fabrique de la terreur, dernier volet de la trilogie.
La guerre est une ruse, Frédéric Paulin, éditions Agullo, 2018 (384 p.)
-
LA FRACTURE – Nina Allan (Tristram)
 Nous sommes à Manchester, en Angleterre. L’été de ses 17 ans, Julie Rouane quitte le domicile pour se rendre chez une copine de classe. Elle disparaît pendant 20 ans. Sa sœur Selena se construit, tant bien que mal, une vie à elle, fondée sur une absence et des mystères à jamais irrésolus. Jusqu’au jour où elle reçoit un coup de téléphone de sa sœur disparue.
Nous sommes à Manchester, en Angleterre. L’été de ses 17 ans, Julie Rouane quitte le domicile pour se rendre chez une copine de classe. Elle disparaît pendant 20 ans. Sa sœur Selena se construit, tant bien que mal, une vie à elle, fondée sur une absence et des mystères à jamais irrésolus. Jusqu’au jour où elle reçoit un coup de téléphone de sa sœur disparue.
« Mais qu’est-il arrivé à Julie Rouane ? » est la question autour laquelle tout gravite : mais les implications qu’appellerait son traitement sous forme d’une enquête classique seront très vite débordées par celles d’un roman qui fusionne plusieurs genres et les outrepasse tout à la fois.
L’écriture de Nina Allan ne parle pas qu’à notre compréhension rationnelle des choses, elle parle aussi à nos affects, produisant ses effets à des niveaux très inconscients. Conditionnant le lecteur par la finesse des impressions décrites, la profondeur de ses personnages ou les multiples genres fictionnels qu’elle convoque, elle l’imprègne en profondeur d’un imaginaire singulier qui le contamine presque à son insu.
Dans l’univers de l’autrice, tout est saturé de sens, les clefs de l’énigme sont à traquer dans le moindre détail. La réalité n’est jamais quelque chose de continu ni d’uniforme. Comme les personnages qui l’habitent, elle est constituée de ruptures, d’événements qui laissent des traces indélébiles. Elle est aussi multiple : d’imbrications, de possibles. Pourquoi faudrait-il choisir entre différentes ces bifurcations du réel, quand la fiction peut faire tenir ensemble toutes ces versions et les rendre compossibles ? C’est sur cet étrange sentiment que l’on achève la lecture de cet obsédant et magnifique roman : celui de n’avoir aucune réponse, ou peut-être de les avoir toutes.
La Fracture, Nina Allan, traduit de l’anglais par Bernard Sigaud, éditions Tristram, 2019 (403 p.)
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire


Merci Anne, nous ne nous connaissons mais en matière de littérature, c’est assez incroyable, tous vos coups de coeur m’ont aussi transportés. Nous sommes fait pour nous entendre. Continuez comme ça et je vais devenir un amoureux transi.
Un lecteur séduit