« Ils l’ont encore chopé aujourd’hui le connard et il a pris la branlée du siècle. Des flics en civils sans doute, catogan et anneau dans l’oreille—deux le tenaient quatre cognaient. A Pèrama aux chantiers navals. Les ouvriers manifestaient après la mort de deux types sur un pétrolier et il y est allé aussi crier des slogans et bomber les murs. Crier bomber quelle idée. Comme si c’était son truc les marteaux burineurs et les sableuses. Connard. Si seulement il était encarté—ceux-là ils volent en escadrille et font gaffe, ils connaissent la musique. Mais notre jobard, lui, se pointe en solitaire aux rassemblements aux manifs et après qui c’est qui court à l’hosto et chez les bourres pour le tirer de là ? Il s’est fait virer de son boulot en plus et n’a pas mis les pieds à la maison depuis un mois. Qu’est-ce qu’il mange où il dort ? Avec quel argent ? Connard. Il nous rend cardiaques. Voyou. Connard. »
« Tàkis se souvient de ce qui s’est passé ici ce soir-là rit de nouveau rit aux éclats et à la lumière menteuse de la lampe je vois sa bouche prendre une forme bizarre et les rides au coin de ses yeux ressemblent aux traces de pas que laissent les petits oiseaux sur la terre humide, plein de petites rides, fines crevasses, traces d’oiseaux effrayés envolés.
Je remplis les verres, on boit. […]
Et le boulot mon vieux. Jour et nuits je vois des hommes brisés par le boulot. Des hommes fatigués effrayés. On dirait qu’on ne peut plus travailler sans peur. On dirait qu’on n’est plus payé pour vivre mais pour avoir peur. Et je me dis. Je me dis faut pas que ça m’arrive à moi aussi faut que je résiste et pas me laisser bouffer. Mais comment tenir le coup ? Plus le temps passe moi j’avance tandis que mon cœur et mon cerveau se tournent vers le passé. Et je me dis t va voir qu’un jour on va se perdre nus trois moi mon cœur et mon cerveau. Tu vas voir qu’un jour je perdrai mon cœur et mon cerveau et alors il se passera quoi ? Je ne sais pas quoi. Un jour. Voilà.
Dehors il fait plus noir encore, les rues sont désertes, les vitres gémissent dans le vent. »
Port du Pirée. Grandeur antique, façade neuve, yachts, ferries pour les îles, rêve de développement économique. Tout de suite à l’ouest, il y a Pèrama, Keratsìni, Korydallos, Nikea qu’on appelle Kokkinia – la rouge : les quartiers populaires, les chantiers navals, le port de commerce, le fret, les porte-conteneurs, les supertankers, les silos à engrais, les hangars. Les dockers, les métallos, les syndicats. Partout, le déclin et le chômage apposent leurs marques, s’immiscent dans les familles, dans les rues, dans les bistrots où on les efface à petits verres de tsípouro ou de tsikoudia. Il faudrait avoir vécu dans un port de commerce dont l’activité s’effondre, pour savoir. Peut-être avoir regardé la saison 2 de The Wire, pour imaginer la crise. Lire d’une traite le livre de Chrìstos Ikonòmou, pour connaître ces vies parcellaires, pour ressentir, pour intérioriser, cette peur au ventre, ces mois et ces années divisés en tranches de 15 jours au rythme des paies qui tombent et qui parfois ne tombent pas, quand il n’y a plus assez pour tout le monde.
Ca va aller, tu vas voir se découpe en seize chapitres, presque des nouvelles, autant de fragments isolés, recoupés, en un assemblage de vies minuscules qui donne un aperçu de l’ensemble. Planant au-dessus des trajectoires personnelles, des douleurs intimes, des drames ou des nuits qui s’étirent, la peur rassemble les histoires et les personnages. Peur d’un quotidien qui noie, qui brise, sépare, rend fou. Un quotidien où les factures s’empilent sur le coin de la table – et l’on évite de les regarder, parce que l’on n’y peut plus rien. Où des enfants souffrent de la faim, parce que les pères sont impuissants à les nourrir. Où les vieux passent la nuit dehors autour d’un feu de palettes, devant l’immeuble de la Sécu où ils ne sont pas certains d’être reçus le lendemain. Où les jeunes qui se font virer en veulent aux vieux qui touchent – et l’on ne sait pas pour combien de temps encore – les allocations retraite. Entre les phrases, presque tu, affleurant à peine à la surface des mots, vibre pourtant avec pudeur la force de l’amour, dans les couples, les familles, entre les frères, les amis.
Cela se passe souvent à Pâques ou à Noël, il fait toujours un temps exécrable, le climat se détraque autant que les hommes. Au café, les discours des hommes sont ponctués de silences. Dans l’absence de virgules, les mots se bousculent pour sortir. Puis l’ellipse, le blanc. Les mots jaillis ne suffisent pas. Restent les regards appuyés ou fuyants, les mains qui triturent le verre ou la cigarette, les bouches qui s’ouvrent, se referment, se taisent. Les mains des femmes à bout de souffle, usées. Qui voient rentrer le mari du travail, se coucher sans un mot. Qui le voit fuir parfois. Les hommes qui voudraient offrir mieux, aimer plus. Les couples qui s’aiment, qui se parlent toute la nuit par ne pas dormir, pour ne pas laisser de place aux cauchemars. Les mêmes phrases, qui reviennent. Qui ponctue, qui ancrent ici et maintenant. Qui entérinent. Pour conjurer peut-être. En litanie parfois. Qui se souviennent du jour où ça a dérapé, du jour meilleur d’avant.
Chrìstos Ikonòmou immerge le lecteur dans un réel très visuel, proche à la fois de la photographie et de la sociologie, sans atermoiements ni interventions, et le livre est porté par cette écriture très belle, à vif, ces longues phrases hachées, ces successions de verbe sans ponctuation, ces répétitions qui tournent en rond, ces longs monologues intérieurs, et ce mot qui revient sans cesse, une grande consolation. Portrait de la crise grecque et des quartiers populaires du Pirée, Ca va aller, tu vas voir est un livre profondément humain et touche bien au-delà de la réalité locale qu’il dépeint.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

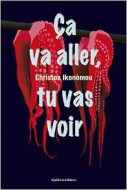

2 Commentaires
Pingback: Sombre aux abords — Julien d'Abrigeon -
Pingback: Note de lecture : « Ça va aller, tu vas voir (Chrìstos Ikonòmou) | «Charybde 27 : le Blog