En pilotage automatique, il quitta son lit et, sans ouvrir les yeux pour rester en contact avec son rêve, il se rendit dans sa salle de bains à laquelle l’éclairage nocturne donnait une teinte légèrement verdâtre. Les deux pieds devant la cuvette, il abaissa son pantalon de pyjama et sa main s’aventura vers son bas-ventre. Rien. Elle ne parvenait pas à trouver l’objet de sa quête, l’appendice que l’organisme utilise en général pour se séparer d’un excès de liquide. Il lui fallut se réveiller afin de restaurer sa coordination. Ouvrant les yeux, il plaqua une main sur le mur, tandis que la seconde partait à la recherche de l’organe le plus important du corps masculin. Aucune trace… Tel un vieil ordinateur qui aurait planté, le cerveau d’Iratov analysait avec difficulté l’information transmise par voie tactile. Il dut se pencher pour activer sa vision. Et à ce moment-là, un cri d’agonie monta de sa conscience, comme si on venait de la perforer à l’aide d’un couteau électrique.
Il n’y avait rien!!! Que dalle !!!
Arséni Andréiévitch Iratov, brillant architecte ayant bâti sa fortune comme trafiquant de devises sous le régime soviétique, est un homme bien en vue de la haute société moscovite. Séducteur invétéré dont la beauté n’a guère faibli avec l’embonpoint et la cinquantaine, il vit en concubinage avec la sublime Véra, qu’il met un point d’honneur à satisfaire sexuellement autant qu’à la couvrir de cadeaux.
Son seul petit problème, ce sont ses crises d’angoisse, et les hontes qui ressurgissent du passé pour le hanter de plus en plus. Et puis qu’une nuit, se réveillant d’un cauchemar, il se rend compte que son sexe a tout bonnement disparu.
En parallèle, dans un village à plusieurs centaines de kilomètres de Moscou, nous ferons la connaissance d’un tout petit gnome, découvert et recueilli par une adolescente qui le baptiste Eugène. Nourri et choyé, cette espèce d’homuncule grandit à toute vitesse pour se transformer en un magnifique et ténébreux jeune homme. Il ressemble de manière troublante à Iratov, comme un double rajeuni, ou plutôt, comme il se présentera lui-même quand il arrivera à Moscou pour rencontrer pour ce dernier : son propre pénis.
L’Outil et les Papillons est le deuxième roman de Dmitri Lipskerov à être publié par les éditions Agullo, après Le dernier rêve de la raison, en 2018.
Il débute donc comme une sorte de variation phallique du Nez de Gogol : un appendice disparu comme par magie (ou plutôt, par un tour d’absurdité littéraire) acquiert une existence indépendante, poussant l’audace jusqu’à se présenter face à son légitime propriétaire – aux yeux de qui il n’est, bien évidemment, qu’un usurpateur.
Le point de départ fantastique, dans la nouvelle de Gogol, donnait lieu à une histoire brève et loufoque, s’achevant sur une pirouette malicieuse qui interrogeait le bien-fondé même d’un tel choix littéraire. Il était aussi prétexte à croquer Saint-Pétersbourg et ses habitants, et la vie d’un fonctionnaire dont la petite routine se trouvait chamboulée par cet événement incongru.
Le fantastique se déploie ici en un copieux roman de 400 pages, où il s’élonge et se ramifie à partir du personnage d’Iratov. On revient sur son passé : sa jeunesse comme étudiant et tombeur de toutes les filles du Komsomol, son passé de trafiquant et ses déboires avec le KGB, son ascension comme architecte… et la progéniture indénombrable issue de ses conquêtes féminines. Des enfants qu’il a abandonnés les uns après les autres et dont il ignore parfois jusqu’à l’existence. Comme Eugène, certains et certaines de ces descendants vont prendre part à l’intrigue.
A présent, il n’y avait plus aucun doute sur sa vocation. Si avec dix dollars, on pouvait nourrir et abreuver une foule entière, alors pour peu qu’il ait en poche une liasse de coupures de cent dollars, il serait en mesure de noyer toute Moscou sous la bibine et de la ravitailler en un seul coup. Rien à voir avec le parc Gorki ou le Stade nautique. Un business net et sans bavure, qui lui épargnerait tous ces gogos à la tronche d’ivrogne et le romantisme de la truanderie, un business certes à risque, mais qui les valait bien, pour lui comme pour son ego. Iratov se représentait déjà sa convertibilité totale dans l’espace mondial, son importance sur les marchés financiers, sa rencontre avec les puissants de ce monde. Son humeur s’améliora pour atteindre des hauteurs célestes et son génie emplit tout l’univers.
Étendu dans son lit sans parvenir à trouver le sommeil, il murmurait sans relâche, un sourire méphistophélique aux lèvres : « Bonjour, ma vocation ! »
L’Outil et les Papillons semble construit comme un organisme dont les parties iraient proliférant à l’infini : on va parfois d’une scène à une autre sans logique visible, selon une temporalité faite de sauts incessants entre passé, présent et futur. Et si l’on a parfois l’impression d’entrevoir les pièces du puzzle s’assembler derrière le chaos apparent, ce sont en fait de nouvelles pièces, de nouveaux personnages, qui s’agrègent et prolongent le récit en tous sens.
Un peu comme le sexe d’Iratov, des appendices de l’histoire se génèrent de partout, prenant leur autonomie au sein du roman, décomposant et recomposant sans cesse une vision insensée du monde. Le narrateur lui-même commence dès les premiers chapitres à avoir son existence propre, se mêlant de la vie d’Iratov au point de devenir une clef de l’énigme. Ce pullulement semble toujours lié d’une manière ou d’une autre à Iratov, à son membre phallique disparu puis réapparu, comme une image mouvante et ironique de la descendance et de la filiation.
Vers la fin du roman, alors que tous éléments semblent se mettre en place : Eugène, Iossif, le petit fils illégitime d’Iratov, génie des échecs et lecteur de la Torah, le narrateur et un mystérieux coiffeur grec… Dans une abondance de références à l’eschatologie juive, on entrevoit peut-être qu’un dessein cosmique est en train de se jouer. A moins qu’il ne s’agisse d’une conspiration diabolique ?
En même temps, Lipskerov semble s’amuser avec les genres, puisqu’en s’amplifiant, le récit approche également l’anticipation, poussant dans ses derniers retranchements les effets d’une émasculation collective sur l’ordre mondial, sur l’économie et les rapports politiques.
Mais le roman ne délivre pas une thèse ou une représentation du monde qui serait à dénicher derrière une ou plusieurs métaphores, il met au jour un véritable foisonnement polyphonique : dans sa forme et sa structure, il joue avec la multiplicité de ses personnages, des couches de narration et de sens, irréductibles à une seule interprétation.
Si la narration de L’Outil et les Papillons peut ainsi procurer une sorte de vertige, il n’a pourtant rien de formaliste ou d’immatériel. Le corps y est au contraire prégnant, qu’il soit objet de sensualité, de souffrance, ou d’étrangeté. Avec, au centre, le désir, et la sexualité comme lieu névralgique de toutes les pulsions.
Eugène se tourna vers la jeune fille et l’embrassa sur les lèvres. Il n’y avait pas la moindre passion dans ce baiser, ni à plus forte raison d’amour : c’était ainsi que l’on embrassait ceux qui vous étaient devenus indifférents, ou la personne qu’on ne reverrait plus jamais.
– Adieu.
Alors qu’il s’en allait, elle lui lança que Chourik le rouquin devait justement partir pour Soudogda et qu’il l’y emmènerait.
– Dis-lui que tu es un parent d’Alissa…
Il se hâta de quitter l’isba, faisant crisser la neige sous ses pas. Sa démarche empressée en disait beaucoup sur sa détermination, ses longs cheveux noirs voletaient au vent.
– Démon ! lui lança Alissa dans un chuchotement. Démon !
L’entrelacement constant de grotesque et d’images poétiques, le rythme tourbillonnant du récit, rappellent une autre œuvre de la littérature russe, Le Maître et Marguerite de Boulgakov, où l’irruption de personnages dans la société moscovite venaient la mettre sens dessus dessous, subvertir l’ordre social et provoquer le chaos.
La comparaison avec Boulgakov est, certes, si souvent utilisée pour qualifier la production littéraire russe qu’elle en serait presque galvaudée… mais elle se justifie pleinement chez Lipskerov (on devine par ailleurs que le texte est riche en intertextualité et que bon nombre de références nous font défaut). De la même façon, le fantastique y est le medium parfait d’une peinture des mœurs de son temps.
Le roman fourmille ainsi d’apartés, de détails et d’anecdotes qui nous immergent dans une vision satirique de la vie à Moscou, donnant lieu à une critique sociale et politique de la Russie contemporaine.
Et si, comme chez Gogol ou Boulgakov, un dysfonctionnement d’ordre surnaturel semble venir chambouler toute l’organisation sociale, ce n’est que pour mieux en révéler les dysfonctionnements profonds, déjà présents. L’exemple premier en est le parcours d’Iratov lui-même, qui s’est enrichi par des magouilles et profitant de la corruption de cadres du Parti et du KGB. Le portrait n’épargne ni le régime soviétique, ni la Russie postsoviétique, où les contradictions larvées ont comme explosé, et dans laquelle un homme comme Arséni Andréiévitch Iratov incarne un parfait modèle de réussite sociale.
L’écriture de Lipskerov fait ressentir comment la société écrase de tout son poids sur des individus névrosés, tout en les atomisant. On trouve les réminiscences du système bureaucratique soviétique, qu’il s’agisse de l’armée, de l’université ou de n’importe quel corps de métier, tous les personnages sont identifiés par leurs statuts professionnels ou leurs rapports hiérarchiques, comme par leur fonction dans une vaste horlogerie. Et en même temps, on a affaire à une société hyper individualiste qui produit à tour de bras des exclus et des déshérités. C’est particulièrement prégnant dans les passages mettant en scène le narrateur, qui contrastent avec le microcosme gentrifié où évolue Iratov.
Tout à coup, Iratov s’est retourné et nos regards se sont croisés. Deux personnes qui ne se connaissent pas, comme il y en a tant. Mais qui se sont regardées un peu plus longtemps que la normale, ce qui a contraint Iratov à maugréer un « Bonsoir » poli, et moi à répondre « Bonsoir ».
Iratov s’est détourné, s’est dit qu’il avait déjà vu ce visage quelque part, puis il a passé un bras autour de la taille de Veruschka pour la pousser vers le vestiaire. Le vieux Fédorytch, qui était la confiance et la vérité de ce théâtre depuis les années 1960, a prestement apporté le manteau d’hermine. Dès qu’il a eu la fourrure en main, Iratov l’a jetée sur les épaules de sa compagne, avant de recevoir du même Fédorytch un lourd manteau à la Chaliapine, avec un col en castor. Il a glissé un billet dans la paume du préposé au vestiaire.
Pour ma part, j’ai un manteau pourvu d’une doublure amovible. Un truc universel. Je le porte au printemps comme en automne et je fixe la doublure en hiver. Ce vêtement ne vieillit pas et me protège efficacement des intempéries. Une gabardine yougoslave.
Le luxe le plus tapageur y côtoie la misère, la criminalité, l’alcoolisme et la corruption. Le racisme s’y exprime ouvertement. L’insécurité y prend des formes extrêmement violentes, et notamment pour les femmes, dont le statut social est fréquemment dépeint comme précaire, dépendant des hommes, à l’image de toutes ces anciennes amantes que Iratov a laissé sur le carreau avec un enfant illégitime.
Lipskerov rend ainsi compte, avec un humour féroce, de ce monde brutal, déshumanisant, où les individus sont largués sans aucun repère moral, ni sens, ni valeurs, manifestant une indifférence cynique à la mort de leurs voisins de palier.
Et le registre du grotesque prend ici tout son sens. La Russie contemporaine ne semble pouvoir être dépeinte que par l’exagération, l’absurde et l’ironie : comme s’il s’agissait des seuls instruments de vue à même d’en capturer quelque chose d’essentiel. Le caractère humoristique n’ôte rien de la noirceur et la brutalité qu’il laisse transparaître – et permet même de mieux les percevoir à travers le verre grossissant de la farce.
De manière générale, il faut rendre pleine justice à la traductrice du russe, Raphaëlle Pache, pour son magnifique travail sur l’ensemble du roman : mais dans ce cas, particulièrement, la manière dont elle transpose la vivacité de la langue de l’auteur, le choix de termes détonants, notamment dans le prosaïsme et la vulgarité, fait mouche. Certaines scènes, et particulièrement certains dialogues, sont extrêmement drôles.
– Je suis encore à la retraite. Mais mon oncle, en effet, est mort pile à cinquante-neuf ans.
– De quelle maladie, si je peux me permettre ? Pas d’une maladie. Il a été tué sur son lieu de travail. Une énorme machine s’est arrachée du sol dans son usine et la montagne de ferraille a glissé sur des tuyaux jetés là en pagaille. Mon oncle a soutenu trois tonnes pendant dix bonnes minutes avant qu’on vienne lui prêter main-forte.
– Mais enfin, pourquoi ?
– Il voulait épargner le matériel.
– Quoi ?
– C’est ce que je lui ai demandé avant sa mort : « Mais enfin, tonton Vitia, pourquoi, bordel ? C’est même pas une entreprise d’Etat, elle appartient à un bandit d’oligarque ! Tu as voulu ménager le bien capitaliste ? » Et lui, il m’a sorti : « Je sais pas, merde, ça s’est fait tout seul… » Et là-dessus, il est mort.
Cela dit, il y a un élément qui, comme les autres, fait l’objet de la dérision et du grotesque omniprésents, mais que l’on pourra trouver discutable malgré tout : il s’agit du rapport aux personnages féminins. La violence avec laquelle elles sont traitées, brutalisées, infériorisées, violées, si elle participe sans doute à montrer la réalité de leur condition sociale, met mal à l’aise.
Si les personnages masculins en prennent eux aussi pour leur grade, et si le roman interroge indéniablement la domination masculine et la composante phallocrate du pouvoir, les représentations sexistes, voire misogynes, y sont peut-être trop systématiques, essentialisantes, pour ne pas être tenté d’émettre un bémol. Bien qu’il excède toujours les cadres où l’on voudrait le figer, la représentation des femmes reste ambivalente dans ce roman – cela n’ôte rien à sa réussite littéraire, mais on ne peut pas ne pas le relever.
En bref, L’Outil et les Papillons est un roman dense, vivant, organique, dont la brutalité et la noirceur sont sans cesse contrebalancés par un humour génial, et surtout, par le décalage de l’univers dans lequel il nous entraîne. Le fantastique et le grotesque y sont décidément d’excellents outils : d’une part, pour dépeindre une réalité crue, qui ne semble pouvoir être représentée qu’en exhibant à quel point elle est insensée. Et d’autre part pour nous sauver, par le rire et l’imagination, du désespoir qu’elle induit. C’est quand même formidable que les deux puissent si bien s’accommoder !
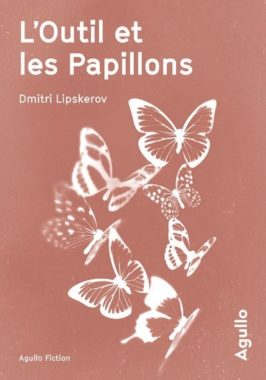
L’Outil et les Papillons, Dmitri Lipskerov
Traduit du russe par Raphaëlle Pache
Editions Agullo, 2019
Anne.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

