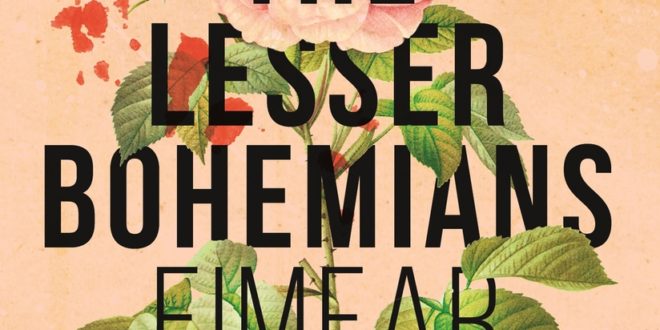Londres, 1994. La jeune Eily, 18 ans, débarque de son Irlande natale pour étudier dans une école de théâtre. Impatiente de se débarrasser de son étiquette d’Irlandaise candide et virginale, meurtrie par un abus qu’elle a subi dans son enfance, elle s’immerge dans une vie rythmée par les soirées, l’alcool, et les premières fois.
Les saltimbanques ordinaires (The Lesser Bohemians) est un roman d’initiation, celle de la première année d’indépendance loin du foyer familial, et celle du premier amour : Eily rencontre un homme, un comédien de 20 ans son aînée, qui l’initie à la sexualité, et avec lequel elle va vivre une histoire passionnelle.
L’écrivaine irlandaise Eimear McBride s’est fait connaitre avec son premier roman, Une fille est une chose à demi (A Girl is a Half-Formed Thing), paru en 2013. Il s’agissait du monologue intimiste et cru d’une adolescente irlandaise, grandissant dans un milieu familial brisé, écrasée par la rigidité des normes d’une société rurale traditionaliste. On a volontiers comparé l’auteure à James Joyce, Beckett ou Virginia Woolf, pour le caractère expérimental et poétique de son écriture en « flux de conscience ».
« Mon Dieu, tu es si jeune. La plus jeune. La plus jeune de notre promo. La vierge de Babylone malgré la rapide érosion de ma Naïveté. Libre de me brûler les ailes contre les histoires des autres – la seule chose que je sais faire, c’est me tenir à l’écart – pourtant j’apprends peu à peu. Soirées déchaînées du vendredi soir. Sors qui que tu sois sors. Mêle-toi aux groupes, si tu n’en as pas déjà un, à l’Enterprise, au Crown, au Fiddler’s Elbow. Je me façonne sur leurs discours abondants envahissants, moi petite souris, meurtrie par ces ragots potaches que je ne connais pas ne maîtrise pas. Toi timide nous gros malins toi tu n’es que toi. Tant pis. J’y vais quand même. Me donne des airs avec une cigarette. Me barbouille l’esprit avec quelques pintes jusqu’à ce que les bêtises se déversent de ma bouche. Je ris beaucoup aussi, comme si c’était sincère. Je m’ouvre au monde, peut-être, je crois. J’espère. Je gagne en fierté de façon à tout affronter. »
Bien que ce second roman soit moins expérimental de forme, donc indéniablement plus accessible, on y retrouve ce style caractéristique, où la langue paraît faire corps avec les sensations vécues par la narratrice. Durant la majeure partie du livre, les scènes nous sont données à travers les yeux d’Eily, ou plutôt, même, depuis sa chair et son intériorité. En découle une écriture fusionnelle, qui se fait comme ressentir depuis l’intérieur de soi. La syntaxe est brisée, le rythme saccadé par la ponctuation ou par des blancs typographiques, les phrases interrompues avant les compléments d’objet. Les perceptions et sensations du personnage dictent à la narration l’enchaînement des scènes, interdisant toute forme d’exposition extérieure ou surplombante des événements – au point que, par exemple, les noms des personnages sont éludés la majeure partie du roman. Pour autant, l’auteure ne bascule pas dans l’hermétisme : c’est au contraire une expérience de lecture intense, immersive, où corps et langage semblent se confondre comme s’ils étaient de même nature. Ainsi en va-t-il des scènes de sexe qui émaillent le roman, où l’immanence du point de vue et la force expressive des mots se déploient avec un naturel remarquable. Même justesse lorsqu’il s’agit d’explorer le sentiment amoureux, la puissance avec laquelle il s’affirme dans chacune de ses manifestations : le manque de l’autre, la certitude d’avoir trouvé en lui son salut.
Une écriture à vif, donc, capable de traduire l’exultation du désir tout comme le désespoir le plus profond, de les faire tenir ensemble comme les deux faces d’une même pièce.
Londres, ses bars, ses théâtres et ses clubs, sont à la fois un décor idéal aux mœurs des personnages, et un sujet à part entière du livre. Pour Eily, c’est la première coloc et les premières virées nocturnes, les soirées de beuverie terminées au whisky et à la dope, dont on se réveille sans trop savoir où l’on a atterri. Elle s’enivre de cette existence, à un point vertigineux dont l’auteure ne nous épargne rien. Le matin, qu’il soit synonyme de séparation des amants ou de lendemain de cuite salée, charriant son lot de conséquences et la lumière crue portée sur les actes commis, est toujours redoutable pour les Saltimbanques ordinaires.
« Alors j’ouvre les cuisses en disant Faites ce que vous voulez. Plus rien n’a d’importance. Rien ne compte. Des vaisseaux vides qui se chargent de tous les bruits. Baise-la. Elle le mérite. Cette bouche a l’habitude. Piétine-la là où elle se piétine elle-même. Sous ces corps sales. C’est elle qui a choisi. Cette fois, elle décide de ce qu’elle est. Elle va au-delà de la peur, et même du dégoût, elle offre son corps à leur désir et ce n’est que lorsqu’ils l’ont assez baisée qu’elle plonge dans un sommeil qu’aucun rêve ne pénètre.
Je me réveille. La vie renaît. Il fait jour. Ils n’ont pas de pantalon. Moi, je n’ai que ma peau. Je récupère mes vêtements. Ils dorment encore. Il faut que je parte. Les monstres sont de retour, et le matin sait ce que tu as fait. »
Comme dans A girl is a half-formed thing, les thèmes de l’inceste et de la pédophilie sont prégnants, puisque les deux personnages principaux ont subi des viols dans leur enfance. Là encore, l’écriture de McBride, quand elle retranscrit la manière dont des crimes commis par des adultes s’impriment à vie dans le corps des victimes, se trouve en adéquation totale son sujet : la douleur et le désir, leurs frontières troubles ; la honte, le dégoût de soi et la tentation de l’autodestruction vécue comme nécessité. L’expérience traumatique imprègne d’abord le roman de manière latente, comme quelque chose qui voudrait s’exprimer sans pouvoir être dit. Mais, contrairement à ce qui se produisait dans son précédent roman, la narratrice ne reste pas enfermée dans son for intérieur, amputée d’un autre auquel se fier. L’expérience amoureuse, dans Les saltimbanques ordinaires, redouble la communion sensuelle des corps d’une communication possible.
Ainsi, l’évolution de la relation des deux amants s’accompagne de changements dans le système d‘énonciation. Le flux de pensées de la narratrice va se commuer en dialogue – et laisser la parole, pour une longue partie du récit, au discours rapporté du personnage masculin, qui raconte son enfance et ce qu’il a subi.
Cette rupture avec le point de vue interne d’Eily pourra sans doute déplaire. Mais il induit aussi quelque chose d’intéressant, une autre forme d’exploration du subjectif. D’un point de vue narratif, il s’agit aussi d’un moment précieux du roman, qui va laisser le personnage masculin, jusque-là engoncé dans la panoplie du mâle inaccessible et taciturne, s’ouvrir à la parole et dévoiler sa vulnérabilité. S’instaure alors une forme réciprocité entre les deux amants qui, malgré le contenu douloureux du témoignage, se reçoit comme une bouffée d‘air. Le récit qui, jusqu’alors, semblait soumis à l’imprévisibilité des situations et de personnages aux humeurs chaotiques, paraît alors se stabiliser, dans une grande respiration, offrant, face à l’insoutenable, une issue possible dans le dialogue et l’apaisement.
« La nuit dérive en moi. Nécessaire au sommeil. On est allongés entre les racines d’un arbre dans le parc de Hampstead Heath, comme on l’a été tous les deux au soleil. J’essuie une trace de beurre sur tes lèvres. Ce sourire que tu me fais. Tu embrasses mes doigts. L’intérieur de mes poignets en riant. Je vais jusqu’au rêve de nous. Qui monte, monte, juste au-delà de l’œil, que je souffle jusque dans ton corps. Je te caresse le flanc. Et l’odeur de ton cou qui non ça ne va pas. Merde ce n’est pas toi. »
Alors que toutes les prémisses laisseraient présager d’une chronique étape-par-étape de la désillusion amoureuse, Eimaar McBride signe avec Les saltimbanques ordinaires un roman étonnamment lumineux – qui ménage néanmoins tout du long une part d’opacité et d’ambivalence irréductibles, que le dénouement n’arrivera pas à éclaircir.
Raconter une histoire d’amour, au premier degré et sans verser dans la mièvrerie, réussir à y faire adhérer le lecteur, est une gageure. Il fallait toute l’ingéniosité et la générosité littéraires d’Eimar McBride pour y parvenir.

Les saltimbanques ordinaires, Eimear McBride
Traduit par Laetitia Devaux
Editions Buchet/Chastel, 2018.
Anne.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire