Créées en 2010, les éditions Aux forges de Vulcain présentent déjà un catalogue fourni et on ne peut plus diversifié. Fiction, essais, arts, numérique, tout domaine littéraire est bon à investir, creuser, explorer, pour mettre en place une ligne éditoriale vaste et cohérente. Chez Un dernier livre, on a découvert les Forges en septembre avec le sublime Prométhée vagabond (qui a fini l’année dans un Top 5) et on aime bien l’idée renvoyée par ce catalogue. On a voulu en savoir plus sur ces forgerons de la littérature. David Meulemans, président et fondateur des Forges a bien voulu répondre à nos questions !
Qu’est-ce qui vous a décidé à sauter le pas et créer votre maison d’édition ?
Je pense qu’il y avait une part d’arrogance, qui s’est mué, avec le temps, j’espère, en quelque chose de plus positif. Je suis un gros lecteur, et je lis de tout : des essais, de la littérature classique, des littératures de l’imaginaire. J’avais cependant atteint un certain degré de lassitude : les livres commençaient à me tomber des mains. Je les trouvais moins ambitieux, moins beaux, moins grands, moins intelligents que ce qu’ils pouvaient ou devraient être. C’était bien sûr de l’arrogance : il y a de très bons livres à toute époque, il suffit de bien chercher. Mais j’avais fini par me convaincre que la proportion de bons livres était devenue trop faible et que le monde intellectuel s’était lui-même rendu incapable de produire les textes dont je commençais à rêver. Donc, je me suis dit : si personne ne fait ces livres dont j’ai besoin, je vais les faire. Je me suis donc lancé dans l’édition avec une bonne couche de malhonnêteté intellectuelle, car ce saut dans le vide s’appuyait sur la croyance en la médiocrité de la production – croyance qui est erronée, mais m’arrangeait bien !
Comment définiriez-vous votre ligne éditoriale ?
Je crois que le monde est, en général, prévisible, et que l’être humain cherche le confort, la stabilité. Je n’aime donc que les textes qui peuvent surprendre, notamment en bougeant les lignes, en ne faisant pas ce qui est attendu, mais en faisant ce qui est nécessaire, et n’est parfois pas évident. Par exemple, j’aime les essais qui ne nous disent pas, dès leur titre, ce qu’ils défendent. Ou j’aime les gens qui défendent des positions politiques radicales, mais de manière un peu fourbe, sans le dire. Trop souvent, on professe des choses banales, mais en faisant croire que l’on dit quelque chose de révolutionnaire. A l’inverse, j’aime les textes qui font quelque chose de radical, voire de révolutionnaire, mais discrètement, en attirant ainsi à eux des lecteurs qu’ils vont surprendre, piéger. En ce sens, je veille à ce que tous les livres des Forges soient à la fois accessibles et signifiants. Je résume parfois cette ligne par ces mots : populaire et pointu.
Comment choisissez-vous les textes, les auteurs avec lesquels vous travaillez ?
Notre catalogue se répartit en deux parties. Il y a les textes que nous sommes allés chercher, et les textes que l’on nous a apportés. Mais, qu’un texte soit traduit, ou qu’il soit un titre de création, je cherche des textes qui questionnent des frontières, des codes, des limites. Par exemple, un roman qui, sous l’apparence d’un roman du terroir, est un vrai grand roman sur ce qu’est le geste artistique – comme dans le cas de Nous tous sommes innocents de Cathy Jurado-Lécina. Le choix se fait d’abord sur le texte. D’abord, il doit être solide. Après, il doit s’insérer dans le projet des Forges. Enfin, j’apprécie la rencontre avec les auteurs, les traducteurs – on publie des textes, mais on publie aussi des personnes. Il nous est déjà arrivé de décliner des textes bons, mais dont l’auteur nous a inspiré une grande antipathie. Nous avons, pour l’instant, eu beaucoup de chance : des auteurs qui sont à la fois de grands artisans, et de belles personnes.
Comment sélectionnez-vous et travaillez-vous pour les livres étrangers récents ? Par exemple comment avez-vous découvert l’un de vos derniers titres, Ma chèvre s’est mangé les pattes, et quelle est la marche à suivre pour l’éditer en France?
J’ai la chance, grâce à mes études, d’avoir pu séjourner longtemps à l’étranger. J’en ai gardé l’habitude de lire des romans américains dans leur langue. Je lis des blogs américains, je suis des groupes Facebook de lecteurs, j’ai quelques amis qui résident là-bas. De ces différentes sources me parviennent toutes sortes d’idées de lecture qui, de temps à autres, deviennent des projets pour les Forges. Il n’y a rien de plus précieux, pour un éditeur, que de connaître de vrais grands lecteurs, qui sont détachés de l’actualité et ne lisent que ce que leur caprice leur impose. Ce sont eux qui m’amènent parfois certains titres. C’est le cas notamment de Ma chèvre s’est mangé les pattes d’Alex Burrett. Les Forges se concentrent sur des langues que je maîtrise, ou, assez rarement, sur des textes dont j’ai pu lire la traduction anglaise ou allemande (c’est le cas pour les textes grec et néerlandais : deux langues que je ne lis pas du tout). Sinon, une fois décidé de publier en France un texte étranger, il faut acquérir ses droits, ce qui est aisé, puis trouver quelqu’un pour traduire. Ce qui est la partie difficile. Pour Ma chèvre s’est mangé les pattes, nous connaissions le travail de Patricia Barbe-Girault, pour avoir travaillé une première fois avec elle. C’est une traductrice fantastique, fine, créative, avec une très forte éthique de la traduction. Elle a produit une superbe traduction. Au fil des ans, nous avons fini par établir une liste de cinq à six traducteurs et traductrices qui sont des vrais grands artisans.
Comment se passe le travail avec l’auteur (et le traducteur le cas échéant), depuis la sélection du texte jusqu’à la sortie (correction, mise en page, couverture?)
Comme dans toute maison d’édition, il y a un long travail de reprise du texte, aux côtés de l’auteur. Souvent, cela consiste à faire une somme de remarques à l’auteur, parfois des dizaines par page, pour l’obliger à prendre position. Nous ne sommes pas des auteurs, donc nous ne réécrivons pas. Nous interrogeons. Et, bien souvent, l’auteur ne se contente pas de revenir avec une correction, il revient avec une invention nouvelle et géniale, qui était inattendue. Cela prend trois à six semaines. Puis, nous passons à l’ortho-typographie, au maquettage et à l’impression. L’auteur repasse une dernière fois sur la maquette avant que l’impression commence. La couverture reste notre prérogative. Le titre du texte est souvent longuement discuté : nous n’avons pas publié de livre dont le titre était le titre initial, mais le titre final s’est toujours avéré être choisi par l’auteur. Peut-être qu’un jour il nous faudra décider d’un titre. Mais cela n’est jamais arrivé.
Maison encore jeune, n’était-ce pas risqué de vous lancer dans l’édition indépendante alors que partout on entend parler de crise du livre ?
Je ne pense pas qu’il y ait une crise du livre. Ou plutôt, il y a une crise du livre depuis quarante ans. Le livre reste de très loin la première industrie culturelle. Mais, comme toute industrie, la chaîne du livre évolue, dans ses modes de production, ou de communication. Et c’est souvent dans ces périodes de transition que se créent de nouvelles entreprises, car elles parviennent à mettre le doigt sur un nouveau mode d’organisation, qui devient, à terme un modèle dominant. D’ailleurs, crise ou pas crise, il ne s’est jamais créé autant de maisons d’éditions. Donc, les Forges, sur ce point, ne sont pas très originales !
Effectivement Les Forges sont de la même génération que les éditions Cambourakis, par exemple, ou encore les défuntes éditions Attila (aujourd’hui Le nouvel Attila et Le Tripode), La dernière goutte ou Quidam. Ces jeunes maisons indépendantes ont toutes cette particularité (mais en est-ce vraiment une) de vouloir présenter une nouvelle facette de la littérature. Peut-on y voir une espèce de « mouvement » éditorial commun ?
Je pense que, quand on est engagé dans l’action, on perçoit les différences qui nous distinguent, mais, peut-être que dans quelques années, la perspective nous montrera qu’il y avait un mouvement commun, que toutes ces maisons, malgré leur très nombreuses différences, n’étaient que des facettes complémentaires d’un seul phénomène. Disons qu’il y a bien une exigence littéraire nouvelle chez beaucoup d’éditeurs récents. Qui se retrouvent tous à fuir un double écueil : une littérature un peu terne, sans sel ni âme, qu’on trouve chez certains grands éditeurs, et une littérature populaire pas toujours très ambitieuse. Par exemple, beaucoup de ces éditeurs travaillent sur la transfiction, cette piste qui louvoie entre la « grande littérature » et les littératures de l’imaginaire.
Concrètement, comment fait une maison d’édition indépendante, lorsqu’elle débute, pour exister, se faire connaître et reconnaître, pour réussir à convaincre les libraires, les lecteurs, de prendre le temps de découvrir ses livres plutôt que la dernière nouveauté de la grosse maison qu’on nous impose à longueur d’affichage et de plateaux télé/radio ?
Je suppose qu’elle doit très vite identifier ce petit groupe de lecteurs passionnés qui ont un appétit pour la nouveauté, tout en demeurant des lecteurs exigeants. La grande chance de notre génération est d’avoir des outils de communication qui permettent de diffuser rapidement et très précisément des informations… et aussi de recueillir très vite des avis de lecteurs. Ainsi, un petit passage par le site Internet des Forges montre combien notre proposition, notamment en termes graphiques, a évolué, titre après titre. Notre souci a toujours été de voir chaque livre comme l’occasion d’améliorer notre proposition. Une des raisons pour lesquelles nous sommes placés sous le patronage de Vulcain, c’est pour montrer notre attachement à deux valeurs : la qualité et l’innovation. Qualité, car Vulcain, c’est le dieu des artisans. Innovation, car Vulcain fabrique les armes des dieux – or, les armes sont des outils de changement. La qualité et l’innovation (sur la communication, sur la nature de la proposition) nous ont guidés, pour l’instant.
Quel est votre avis, et votre positionnement sur le livre numérique ?
Le livre numérique est très pratique. Il permet de mettre en valeur certains types de textes, comme les formats courts. Il permet aussi des expérimentations que le papier ne permet pas. Il permet aussi de proposer des livres à bas prix, ce qui est important pour pouvoir s’adresser à tous les lecteurs. Par contre, pour l’heure, le marché du numérique, en France, reste modeste. Une bonne partie de notre catalogue existe au format numérique, mais cela reste économiquement très marginal dans notre activité. Ma seule position arrêtée sur la question est mon refus des DRM. Mais je pense que plus aucune personne sensée ne défend les DRM, si ?
Normalement non, en effet ! Pensez-vous que le marché du livre numérique va évoluer? Peut-on assister à un véritable essor en France ?
Le marché évolue, peu à peu, notamment parce que les lecteurs s’équipent de plus en plus. Cela étant, je pense que l’essor du numérique est plus lié à l’essor de l’auto-publication : un des bénéfices du numérique est de pouvoir diffuser une œuvre avec un investissement financier minimal. Je pense donc que ces deux marchés, numérique et autopublication, vont progresser de concert.
 Et sinon, Draftquest, késako ?
Et sinon, Draftquest, késako ?
DraftQuest est un projet que je mène personnellement depuis trois ans, qui est distinct des Forges, mais partage un même esprit, mêlant innovation, et esprit de jeu. DraftQuest, c’est un site Internet qui permet d’écrire aux gens qui veulent écrire. C’est une application gratuite, et un atelier d’écriture virtuel, qui, pendant huit à douze semaines, accompagne ses participants dans l’écriture d’un roman. DraftQuest pousse à l’extrême l’idée initiale des Forges : pour changer la production littéraire, il faut changer la population qui écrit et amener à l’écriture encore plus de personnes, et notamment des personnes qui sont différentes, d’un point de vue sociologique et intellectuel, de la population habituellement publiée. La troisième saison de cet atelier, qui comprend plusieurs milliers de personnes, commence le 7 mars 2015. Lors des deux premières saisons de cet atelier, nous avons repéré deux romans, qui ont ensuite été publiés par les Forges : Chronique des jours de cendre de Louise Caron et Nous tous sommes innocents de Cathy Jurado-Lécina. Ce n’est pas le but de DraftQuest de fournir des textes aux Forges… mais c’est toujours agréable quand cela se produit. DraftQuest est davantage un outil d’éducation populaire et un espace de pratique amateur.
Littérature, sciences, arts, essais… Les forges forgent de tout ! Est-ce une stratégie afin de couvrir le plus de domaines possible ou une boulimie, une envie de présenter toutes les facettes de la production littéraire ?
Oui, les Forges sont une petite maison généraliste. C’est un choix lourd à assumer, car il aurait été plus simple, pour être lisible et visible, de s’inscrire dans une niche. Mais ce choix m’a semblé naturel : un bon lecteur lit de tout, donc, pourquoi ne pas tout lui proposer : essais et littérature ?
Quand on se penche sur votre collection Littératures, on ne peut que remarquer sa diversité. Les Forges sont généralistes, mais ne se cantonnent pas uniquement à la littérature blanche classique. Vous avez d’ailleurs participé à une conférence sur les dystopies. Les Forges aiment le mélange des genres ?
En fait, les libraires et une partie des lecteurs perçoivent un mélange des genres, mais une partie des lecteurs et nous-mêmes percevons au contraire une forte unité dans la collection, même s’il est vrai que cette unité se fait autour de critères qui sont distincts des critères habituels qui permettent de classer des livres, dans une librairie, ou dans une bibliothèque personnelle. Ces critères, ce sont les critères qui ont guidé le choix de nos titres. A chaque fois, nos textes ont : une bonne histoire, une vraie voix, et quelque chose à dire sur le monde. Ces trois éléments nous permettent de proposer, à la fois, de la littérature blanche et de la littérature de genre.
 Justement, votre catalogue montre un certain attachement à cette littérature dite de genre, la présence de William Morris en est un exemple frappant, ainsi que certains textes clairement post apocalyptiques ou encore d’anticipation le soulignent. Que pensez-vous de cette fracture entre la littérature dite « blanche » (classique, la « vraie » littérature) et la littérature de genre, souvent mal vue ou considérée comme relevant d’un lectorat particulier et moins sérieux que la littérature blanche ?
Justement, votre catalogue montre un certain attachement à cette littérature dite de genre, la présence de William Morris en est un exemple frappant, ainsi que certains textes clairement post apocalyptiques ou encore d’anticipation le soulignent. Que pensez-vous de cette fracture entre la littérature dite « blanche » (classique, la « vraie » littérature) et la littérature de genre, souvent mal vue ou considérée comme relevant d’un lectorat particulier et moins sérieux que la littérature blanche ?
Je ne souscris pas du tout à cette distinction, qui est une horreur car elle n’a, en termes de production, que des résultats terrifiants. On se retrouve avec, parfois, des auteurs de genre qui ont abandonné toute ambition. Inversement, les auteurs de littérature « blanche » ne font aucun effort pour légitimer, rendre réel et vivant le monde qu’ils décrivent, car ils font comme si ce monde, puisqu’il ressemble à notre monde quotidien, allait de soi. Je veux des littératures de genre qui regagnent de l’ambition littéraire – et cela existe : ainsi, quand je lis Jean-Philippe Jaworski, je me demande si ce n’est pas, tout simplement, le plus grand écrivain français, genre ou pas genre. De même, j’aime que les auteurs de littérature « blanche » retrouvent un peu d’imagination, un peu de souffle. Quant à la question du sérieux : la plupart des bons lecteurs que je connais sont des lecteurs de littératures de genre. Snober la littérature de genre, sans voir qu’elle fournit parfois les plus belles réussites de notre littérature, c’est une pratique sociale détestable, une habitude de demi-savant, de mauvais lettré, qui ne veut pas lire, mais simplement se draper dans la dignité illusoire du bon goût.
La littérature de genre est-elle facilement soluble dans la littérature ?
Oui, bien sûr ! Jaworski, Damasio, Chambon, ou LeGuin, pour citer des auteurs très différents, ce sont les plus grands écrivains de notre époque. Cela ne signifie pas que toutes les littératures de genre sont littéraires. Souvent, les auteurs de genre finissent pas se confiner dans le rôle misérable que les mauvais critiques leurs collent, et produisent de mauvais romans. Mais, après tout, c’est comme cela dans toute littérature : les œuvres les plus belles restent rares.
Votre catalogue présente un nombre assez important de premiers romans ou de premières traductions. Est-ce un vivier ou un risque ?
Le vrai risque, c’est de publier quelque chose qui aurait pu être publié ailleurs. Il ne faut se lancer dans l’édition que pour produire des œuvres nécessaires et importantes. Bien sûr, ces œuvres nécessaires ne sont pas obligatoirement des œuvres de création. Mais, dans mon cas, je n’ai conçu les Forges que pour faire émerger des textes nouveaux. Donc, non, ce n’est pas un risque, c’est notre mission.
Vous présentez également des textes plus anciens (on a parlé de William Morris, on trouve aussi Alexander Key, Grace Lumpkin ou plus récemment Edward Bellamy). Y at-il une filiation à voir, non seulement pour les Forges mais aussi pour vos jeunes auteurs, avec ces textes ?
Mon usage des classiques est très intéressé. Je ne publie des classiques que pour montrer aux écrivains en herbe de notre temps que la voie que je crois nécessaire d’emprunter… a déjà été empruntée. Et qu’écrire des textes qui sont de bons récits, avec une vraie voix, un propos sur le monde, et aucune prévention contre l’imagination, est possible, tout simplement parce que cela a déjà été fait des milliers de fois.
Qui dit essais dit engagement. Comment résumeriez-vous celui des Forges dans ce domaine ?
Les Forges ont des opinions politiques très précises, mais elles n’affichent pas ouvertement leur couleur. En fait, les couleurs et les drapeaux sont des erreurs stratégiques. Ce sont des outils de séparation : ils permettent de rallier les déjà convertis, mais font fuir ceux qu’il reste à convertir. Je préfère les approches plus fines, qui permettent de changer les lignes. Cela ne change rien au fond de notre pensée, qui reste radical, mais nous vivons dans un monde démocratique, où le progrès ne peut s’imposer, mais doit être désiré. Cette approche de la politique se retrouve aussi dans mes espoirs pour la fiction : la fiction permet parfois, en plaçant le lecteur dans un monde différent de notre monde quotidien, de lui faire oublier sa position sociale, et de lui faire adopter une nouvelle politique.
La littérature, travail d’artisan plus que d’artiste ?
Travail d’artisan.
Vous avez publié sur Rue89 en août dernier une tribune contre la rentrée littéraire. Pourriez-vous revenir sur votre position (nous l’expliciter hein, pas la renier!), qui, si j’ai bien compris, est que cette rentrée, qui voit débouler plusieurs centaines de livres et semble attendre uniquement la remise de prix calibrés et sans originalité, est un suicide pour les éditeurs comme les auteurs ?
Je pense effectivement, mais ce n’est pas original, beaucoup de gens pensent comme moi, que la rentrée littéraire n’est pas un très bon calcul pour l’ensemble de l’édition. Cela donne aux lecteurs une mauvaise image de l’édition, comme une sorte de foire ou de course, où la littérature est la grande oubliée. Cela lance une armée de livres dans une bataille inégale, dont seuls certains sortiront vivants, et souvent, pas pour de bonnes raisons. L’an dernier, pour la première fois, nous avons participé à la rentrée littéraire. De nombreux libraires nous avaient convaincus de sortir un peu de cette posture, et de jouer le jeu. Nous l’avons joué, donc, et ne le referont sans doute pas. Les deux romans que nous avons alors sortis ont terriblement souffert du fait que nous n’étions pas taillés, en termes de taille, de puissance de communication, de réseau, pour cet événement. Finalement, ce qui a changé, c’est qu’avant je refusais la rentrée sans l’avoir expérimentée. Maintenant, je l’ai expérimentée, et je pense qu’elle est néfaste – pour les petites maisons, mais aussi pour les grosses. La rentrée a un bénéfice : amener à l’achat des lecteurs qui, habituellement, achètent peu de livres. Il faudrait conserver ce bénéfice mais se débarrasser du cirque qui l’entoure.
Pensez-vous que les récentes maisons indépendantes évoquées plus haut auront la possibilité de transformer cette tradition de rentrée littéraire ? D’amener un souffle neuf dans l’approche et la perception de la littérature autre que cette grand’ messe de septembre que tout le monde fait mine d’attendre avec impatience sans forcément en attendre beaucoup ?
Je pense que cette tradition peut perdurer très longtemps. Quant à la contrer, cela me semble assez compliqué. Disons que nous sommes sans doute dans une période d’atomisation de l’offre, qui va de pair avec le renforcement des super-bestsellers. Il y a de plus en plus de « petits » livres. Et conjointement, les bestsellers, bien que moins nombreux, semblent se vendre encore plus. C’est une situation qui est plutôt favorable à la rentrée littéraire. Fondamentalement, les maisons indépendantes dialoguent beaucoup avec les gros lecteurs, et les gros lecteurs ne s’intéressent que peu à la rentrée littéraire, et, pour certains, la fuient. Donc, la situation peut perdurer : la rentrée pour les grosses choses, pour les lecteurs occasionnels, et le reste de l’année pour les gros lecteurs. Il y a des opérations originales, comme La Voie des Indés, qui se propose de faire une exploration collective de l’édition indépendante. Cela reste de la contre-programmation, et cela suppose donc une programmation principale. Mais, pour tout dire, avec l’expérience, je me dis que chaque année, il sort beaucoup de bons livres, qui, même quand ils n’ont pas la carrière qu’ils ont mérité, ont pu exister. La situation n’est pas horrible. Il y a toujours des lecteurs, des bibliothécaires, des journalistes, des libraires qui font des efforts, pour lire et découvrir des récits inouïs, des choses folles et atypiques.
Finalement, entre votre volonté d’amener le plus de gens possible à l’écriture quelle que soit l’origine sociale, de proposer des textes populaires et pointus et de vouloir aller au-delà des clichés de genres et de catégories habituels, vous êtes un éditeur engagé tout court ! La littérature implique nécessairement un engagement, une vision politique/sociétale ?
Je crois que je suis très sensible à l’écart qu’il y a entre la promesse démocratique, qui est la promesse qu’on nous répète depuis deux siècles, et les vies que nous menons. Nous ne menons pas encore des vies démocratiques. Chaque fois qu’une distinction permet de nous séparer des autres, de nous délier des autres, nous l’adoptons. Les livres sont en cela victimes de leur succès : ce sont des objets sociaux extrêmement valorisés qui permettent de prendre position, de s’opposer, de se disputer. On ne les lit pas vraiment. Si on lisait les livres, on y trouverait les réponses à tous les maux de l’humanité. Personnellement, je n’ai jamais voulu être éditeur. Je vois simplement l’édition comme le meilleur levier pour changer le monde. C’est ce détachement qui m’a permis, à la fois, de me lancer dans l’édition, et de rester assez serein à l’idée que tout puisse s’arrêter – ce qui est toujours possible. Je continuerai à voir comment je peux, à ma très petite échelle, contribuer à ce que la promesse démocratique soit tenue. Parfois, je peux être grandiloquent, mais cette ambition est un moteur important. Le tout est de ne pas croire qu’on a réussi à changer quoi que ce soit !
Vous vous affiliez à Vulcain, dont le talent n’a d’égal que la laideur. Vos nouvelles couvertures sont, pour le moment et à mon humble avis, plutôt agréable à l’œil ! Coquetterie ?
Merci du compliment ! Je les trouve aussi agréables à l’œil. Et elles sont dignes de Vulcain car il a fallu beaucoup de tests, de tentatives, d’avis, de remarques, de discussions, pour les concevoir. C’est de l’artisanat. Et puis, je crois que Vulcain est marié à Vénus : même s’il est moche, il a l’œil pour la beauté.
Quel(s) texte(s) auriez-vous aimé publier ?
Récemment : La Bombe de Frank Harris, aux éditions La dernière goutte. Une très grande réussite – un classique superbement traduit, digne des plus grandes œuvres.
Quel(s) texte(s) êtes-vous fier d’avoir porté ?
Je suis fier de tous nos livres, mais, ces jours-ci, Nous tous sommes innocents de Cathy Jurado-Lécina, est une grande source de fierté.
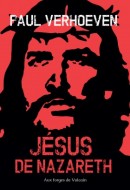 Un coup de projecteur sur une sortie plus ou moins proche ?
Un coup de projecteur sur une sortie plus ou moins proche ?
En avril, nous sortons Jésus de Nazareth de Paul Verhoeven. J’en suis fier, car c’est un essai de biographie iconoclaste, passionnant et érudit. Et c’est un texte de Paul Verhoeven, un cinéaste que je vénère entre tous depuis mon adolescence.
La question qui tue. En tant que lecteur quel est votre Top 5 littéraire ? Et en tant qu’éditeur ?
En tant que lecteurs : Les Démons de Dostoievski, Les dépossédés d’Ursula LeGuin, Martin Eden de Jack London, The Sandman de Neil Gaiman et La Mer de la fertilité de Yukio Mishima. En tant qu’éditeur, ce seraient les mêmes livres !
Un dernier mot avant la fin ?
Ce n’est pas la beauté qui sauvera le monde, ce sont les livres.
Un immense merci à David Meulemans pour sa sympathie et sa disponibilité !
Plus d’infos sur www.auxforgesdevulcain.fr
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
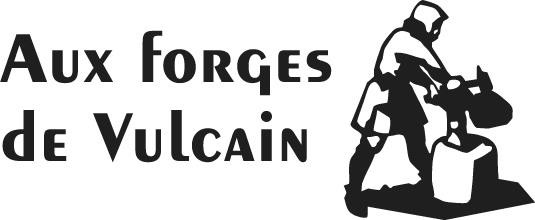

Un commentaire
Pingback: Charles Yu — Guide de survie pour le voyageur du temps amateur -