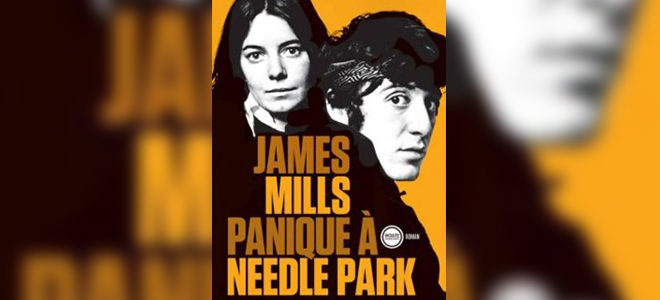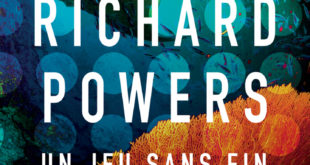En 1965 paraît dans LIFE un reportage photo signé Bill Eppridge qui documente le quotidien d’un couple d’héroïnomanes New-Yorkais : Karen et John. Le reportage, intitulé « Two lives lost to heroin » est accompagné d’un article de James Mills et sera la base d’un roman, The Panic in Needle Park, paru un an plus tard, en janvier 1966.
Il raconte la vie d’Helen et Bobby. Elle est prostituée, il tente de devenir un « grossiste », c’est-à-dire celui qui alimente les dealers du quartier. Tous deux sont accros à l’héroïne, tous deux passent le plus clair de leur temps à la recherche frénétique d’un shoot, d’une dose de plus.
En 1971 ce roman est adapté à l’écran par Jerry Schatzberg. Il choisit comme interprète de Bobby un jeunot pour qui c’est l’occasion d’un premier grand rôle au cinéma, un certain Al Pacino. Le film est un succès, il est nominé pour la Palme d’Or du Festival de Cannes et permet à Kitty Winn, qui joue le rôle d’Helen, de remporter le prix d’interprétation féminine. Quant à Pacino, il est repéré par Coppola et la suite de l’histoire est connue.
Mais c’est au roman de James Mills que l’on s’intéresse ici, puisqu’il parait pour la première fois en français, aux éditions Inculte.
Bien loin de San Francisco, du Summer of Love et de la consommation de LSD, l’histoire de Bobby et Helen se déroule la même année (1967) à l’autre bout des États-Unis, dans l’Upper West Side, au cœur de New York.
Le décor principal : Sherman Square, baptisé Needle Park par les junkies du coin et qui donne son nom au roman, quelques hôtels miteux, squattés par les personnages du roman et la rue, qu’ils arpentent en quête d’un peu de poudre. Le roman relate avec une précision documentaire la recherche quotidienne de l’argent pour payer la dose, les diverses arnaques et combines, petites rapines ou grands délits pour quelques billets. Il détaille les symptômes et les effets de l’addiction, aussi bien physiologiques que psychologiques et renseigne le vocabulaire des junkies et des dealers, les réseaux, la confection des « paquets », les procédés utilisés par les stups et les indics dans un style dépouillé, dont l’objectivité frappe d’autant plus qu’elle n’admet pas de jugement de valeur, juste des constatations simples, froides, presque médicales :
Un héroïnomane est quelqu’un de très occupé. Il n’a pas de temps ni d’intérêt à consacrer à tout activité ou à quiconque pourrait l’éloigner de la drogue. Lorsqu’il se réveille le matin, il saisit immédiatement son « kit » – compte-gouttes, seringue (« shooteuse », comme il l’appelle) et capsule de bouteille (son « réchaud »). Il dissout l’héroïne dans un peu d’eau dans la capsule, puis s’injecte la mixture.
Observée à travers les yeux interrogatifs du narrateur, un journaliste qui demande à Bobby la permission de le suivre dans son quotidien pour la réalisation d’un documentaire, la vie des junkies de Needle Park interroge et bouscule.
Comment en arrive-t-on à devenir un drogué ? Quel est le quotidien d’un héroïnomane ? Comment vivre une relation amoureuse dans ces conditions ? La parole est donnée à Bobby et Helen dans de longs monologues, dans lesquels ils s’exposent et se racontent.
Je veux avoir un vrai boulot. Redevenir un gars normal. Je traîne vers Needle Park parce que j’ai pas d’autre endroit où aller. C’est une communauté. Je connais rien d’autre. Sauf au Nord de l’État, chez mes parents. Et c’est l’enfer, mec, l’enfer.
Bobby est un personnage un peu falot. Petit délinquant sans grand talent, il vit dans l’ombre de son frère Hank, drogué lui aussi et véritable caïd. Quand il rencontre Helen, elle se prostitue déjà, mais ne connait pas la drogue. Pas encore. Elle va y goûter rapidement, au nez et à la barbe de Bobby qui se rend compte trop tard qu’elle a sombré.
Les rackets et divers vols, commis ou subis, les overdoses, la prostitution, les séjours en prison, la violence sont monnaie courante dans leur vie. Ils disent tout de leurs faiblesses, de leurs failles, tentent de comprendre, entre deux shoots, ce qui les a mené là ou les raisons qui les poussent à se droguer, ce besoin d’oubli, cette nécessité de ne plus rien ressentir :
Rien ne te touche. Tu peux apprendre que ta mère est en train d’atrocement mourir, et tu n’écrases même pas une larme. Tu te sens mal pour elle, mais tes émotions, elles sont complètement écrasées. Et ça dure quatre heures, parfois plus.
Durant le roman la panique s’installe. La drogue se fait rare, jusqu’à la pénurie, poussant Helen et Bobby dans leurs derniers retranchements, montrant le pire de leur dépendance, quand plus rien ne peut se mettre entre eux et leur dose :
Je te le dis, les toxicos, c’est des animaux. Et moi je suis un animal comme les autres, parce que je boufferais n’importe qui pour une dose.
Parfois happés par une aspiration quasiment délirante à la normalité, un but malheureusement difficilement inatteignable, voire totalement illusoire, Helen et Bobby, dans leurs allers-retours entre désintox et rechutes, sont le plus souvent lucides et douloureusement pragmatiques quant à leur avenir :
J’espère juste ne pas trop souffrir, rien de plus. Parce que je ne serai plus jamais cette fille que je croise dans la rue. Plus jamais, jamais. Je ne peux plus être comme elle… impossible. Parce qu’elle ne sait pas ce que je sais. Elle n’a pas vécu tout ce que j’ai vécu.
Les deux protagonistes, qui s’abîment de plus en plus dans leur addiction, sont montrés dans leur fragilité, dans leur complexité et dans la brutalité d’une maladie qui a pris totalement possession de leur corps et de leur affect. Un état tel que même l’amour se fait néfaste et les entraine vers les profondeurs. On ne peut s’empêcher d’être touché par leur détresse, eux qui vivent un véritable enfer.
On imagine bien que le reportage de LIFE, le texte de Mills (et le film) ont fait grand bruit, car c’est la mise en lumière d’une réalité aussi sordide qu’impitoyable, celle de milliers de jeunes paumés, devenus accros par la force des choses, et qui sombrent, inexorablement.
Le roman (comme d’ailleurs les photos d’Eppridge) a la grande intelligence d’éviter à la fois le jugement et le pathos, en se cantonnant, à travers l’histoire d’Helen et Bobby, à l’observation juste et objective de ce mal qui a gangréné toute une génération.
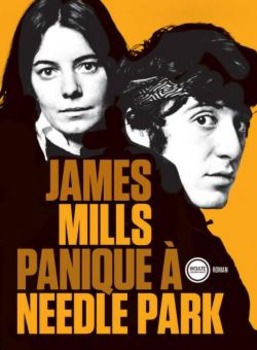
Éditions Inculte
Traduit de l’anglais par Jérôme Schmidt
196 pages.
Hédia
Pour aller plus loin :
voir les photos de Bill Eppridge ici
le trailer du film de Jerry Schatzberg
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire