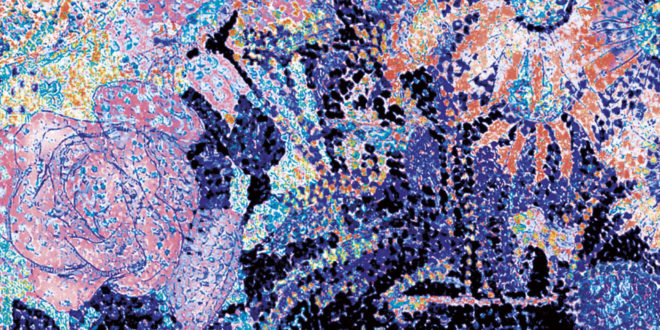« La lumière du jour, impeccable, faisait frémir les ombres des amandiers qui nous entouraient. »
Un village désert, quelque part en Palestine. Deux collines s’y toisent : sur la première, un restaurant panoramique attend de quitter le pays comme une soucoupe volante prête à décoller ; sur la plus haute, décrépit un palais, labyrinthe de salons et de chambres vides. Entre les deux collines, lovées, dorment les ruines de la maison de Joséphine, la sorcière. Tout n’est plus qu’abandon et, à quelques encablures de là, derrière le paysage d’amandiers en fleur, les villes des colons se rapprochent chaque semaine un peu plus.
Dans le palais vide, Faysal erre. Il a quitté sans préavis le pays occidental où il partage un bel appartement avec son amant pour revenir dans cette immense maison de famille, sur sa terre natale qu’il a quittée très jeune, et où ne l’attendent plus que les morts, l’absence et la mémoire. D’un salon à l’autre, de la cuisine au verger qui éclot, de la fraîcheur des pièces vides à la lumière du ciel, Faysal vacille et le récit oscille entre le présent menacé par l’arrivée des colons et la raison qui flanche et le passé alourdi par ses secrets de famille. Les grands-parents Nawal et Ibrahim, l’intransigeante tante Jeannette, l’oncle Ayoub et son amante Joséphine, les ombres détestées des ancêtres, composent un défilé de fantômes, une ronde autour du trentenaire de maintenant qui est en même temps l’enfant de jadis et le seul survivant, dans un décor suranné au faste passé, abîmé par l’ouvrage du temps, à l’image de cette famille de la grande bourgeoisie palestinienne.
« Il faut que je t’avoue, à toi. J’ai tué un homme. Un colon. Un homme mais un colon. Un colon mais un homme. Ça paraît un peu dramatique, dit comme ça, mais c’était tout l’inverse. Il faut comprendre : il s’est matérialisé devant moi, sous les amandiers. Il était déjà mort, on aurait dit un fantôme, alors ça ne changeait pas grand-chose. La lumière du jour, impeccable, faisait frémir les ombres des amandiers qui nous entouraient. »
Les réminiscences qui jaillissent, aux contours imprécis mais aux couleurs vives, ont le flou des souvenirs de l’enfance et des événements dont les détails sont gravés dans la mémoire mais dont le contexte élargi échappe en partie aux enfants. Peu à peu, la voix de Faysal est envahie par celle du fantôme de sa grand-mère Nawal qui hante le palais, avide de revanche contre les colons, furieuse de n’avoir jamais pris les armes, et qui guide, dès les premières pages, la main de son petit-fils vers le meurtre qui ouvre le livre : la mort d’un colon dans la douceur du verger et de la nuit. Dans le reflux de souvenirs, cette pensée du meurtre est diluée, on l’oublierait presque, mais la tension entre le drame du passé et celui du futur proche persiste, dans un temps qui est celui de la suspension.
« L’histoire de Palestine, quant à elle, était une histoire de famille. Chacune des ombres m’en a murmuré un bout, comme une opale qu’elles ont entreposée entre mes mains. Tant et si bien que je compris rapidement qu’elles m’avaient toutes pris simultanément pour un scribe et un psy : j’étais celui à qui elles pouvaient raconter les traumatismes qu’elles n’oseraient jamais s’avouer entre elles. Leurs peurs et leurs inquiétudes, j’en étais le récipiendaire. Leurs blessures, elles me les ont transmises avec une telle verve que j’avais l’impression, presque toute ma vie, d’être une plaie béante sur pattes. On ne m’a jamais appris la Palestine, je l’ai prise en consigne comme une malédiction. »
La Palestine que dépeint Karim Kattan est un pays qui disparaît, qui se vide, un pays presque honni par Faysal pour n’avoir pas su résister, pour s’être laissé dévorer. Le narrateur est subjugué par sa colère contre l’absurdité et la folie de l’annexion, contre ce pays et lui-même, contre sa famille et les colons, contre ce sentiment d’être démuni face à cette disparition annoncée de la Palestine, au point presque de crier son souhait que cette disparition soit enfin entérinée, qu’il n’y ait plus rien, enfin plus rien, pour pouvoir enfin être libéré de cet héritage d’être palestinien. En écrivant en funambule sur le fil qui sépare le désespoir de Faysal et la volonté guerrière de Nawal, c’est la position de chacun face aux questions de l’engagement politique et de la transmission des terres, de la langue, de la culture qu’interroge l’auteur.
La narration de ce Palais des deux collines est soutenue par l’écriture exigeante, juste et précise de Karim Kattan, non dénuée d’un humour et d’une autodérision pleins de finesse, et parcourue par une tension poétique où la sensibilité à la lumière, aux ciels et aux couleurs est exacerbée par la présence englobante d’un paysage de collines vertes et de vergers en fleur. Quelque chose de lancinant, d’onirique, dans le rythme fascinera le lecteur jusqu’à la dernière page et au si pertinent mot ultime.
Si Le Palais des deux collines est le premier roman de Karim Kattan, je vous conseille vivement de lire aussi son très beau recueil Préliminaires pour un verger futur qui regroupe trois nouvelles interrogeant l’attachement à la terre natale et la langue maternelle, et leur absence. Paru en 2017 aux éditions Elyzad, il présageait déjà le talent de ce jeune auteur franco-palestinien né à Jérusalem en 1989.
Pour prolonger le plaisir, vous trouverez ici une longue interview de Karim Kattan sur RFI.
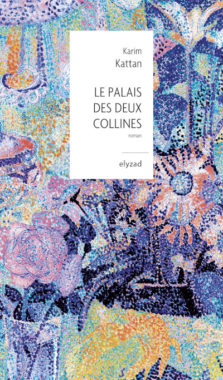 Editions Elyzad
Editions Elyzad
2021
293 pages
Lou.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire