Chaque année à l’automne, des oiseaux migrateurs venus du Canada affluent par milliards dans la ville de New York. Chaque année, des milliers d’entre eux meurent de collision avec les façades de gratte-ciels. C’est sur la chute de quarante-huit bruants à gorge blanche que s’ouvre Les Trente Noms de la nuit de l’auteur américano-syrien Zeyn Joukhadar : une scène qui paraît apocalyptique, hallucinée, pourtant réelle et tout droit tirée des actualités.
Nous, lecteur·ice·s, sommes introduit·e·s avec cet incipit à une autre dimension de la mégalopole : celle qu’on habite en oiseau, en travailleur·se immigré·e, arabe, musulman·e, en personne transgenre… Vivant géographiquement en son sein, mais toujours plus à la marge à mesure que la gentrification expulse et invisibilise celles et ceux qui ne font pas partie de l’histoire que l’Amérique aime à se raconter d’elle-même.
Le narrateur du roman n’est, pendant une grande partie de celui-ci, jamais nommé : son prénom est barré en en-tête des chapitres. Son genre reste également flottant jusqu’au dénouement. Pour rendre la lecture plus commode sans trop en dévoiler pour autant, nous l’appellerons ici par une initiale : « N. », et utiliserons le masculin.
Jeune artiste new-yorkais d’origine syrienne, il a appris de sa mère, ornithologue, à identifier les espèces d’oiseaux les plus rares. Cinq ans après la mort de celle-ci dans des circonstances suspectes, il vit tiraillé entre un deuil impossible et la nécessité de soutenir sa grand-mère, Teta, d’assurer financièrement les soins dont elle a besoin. C’est un personnage en plein désarroi que nous découvrons dans les premières pages du roman : affecté par la perte de sa mère, à qui la narration est adressée et qui lui apparaît comme un fantôme, peinant à retrouver ses repères, entravé par un corps dans lequel il ne se reconnaît pas.
« Depuis ta mort, la ville attire les oiseaux comme une plaie ouverte attire les mouches. Les derniers en date sont les chardonnerets, qui surgissent le jour de l’excavation de la parcelle vide à côté du dernier immeuble de Little Syria. Ca commence par un étincelant nuage jaune d’or qui attire les badauds et les caméras du journal du soir. Puis la tornade d’oiseaux bloque le pub irlandais au rez-de-chaussée de l’église Saint George presque tout l’après-midi. Rien ne passe outre l’essaim de becs. »
Il erre dans la ville à la recherche de souvenirs, peint anonymement de grandes fresques d’oiseaux, essaie de retrouver les traces et les témoignages des générations qui l’ont précédé. Dans un vieil immeuble du Lower Manhattan voué à la destruction, il découvre le journal intime de Laila Z., peintre syrienne ayant également vécu à New-York dans les années 30 avant de disparaître mystérieusement, comme volatilisée. Au point de vue du narrateur s’ajoute ainsi celui de Laila Z., le premier lisant le journal de la seconde.
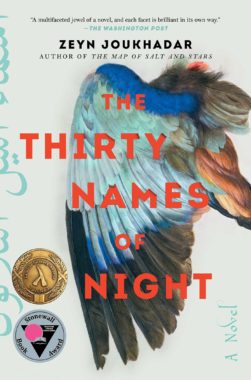
S’il y a bien des manières d’entrer dans l’écriture de Zeyn Joukhadar, la voie la plus évidente pour un certain nombre de lecteurs sera sans doute celle du roman intergénérationnel. Deux narrateurs, l’un vivant de nos jours, et l’autre dans les années 30, qui évoquent deux époques de la ville, deux générations d’immigrés syriens à New-York.
Laila Z. raconte son enfance en Syrie, la révolte à laquelle participe son père, les attaques menées par la France après la Première Guerre Mondiale, et enfin l’exil. A travers son journal, nous découvrons le quartier de Little Syria, à Manhattan, où se concentraient les communautés d’immigrés du Levant, originaires de l’actuelle Syrie, du Liban, de Jordanie et de Palestine, des années 1880 aux années 1940. Il n’en reste plus aujourd’hui que trois bâtiments.
Laila est le témoin direct de plusieurs pans de l’histoire de cette diaspora. A commencer par le racisme pris de plein fouet par ces populations pourtant chrétiennes, dont la peau est décrite comme plus « blanche » que celle de N. et de sa famille, musulmans. La réalité de l’immigration n’est pas homogène, le livre nous le fait bien comprendre, mais les effets de la violence symbolique, l’impuissance à voir dévalorisé dans le regard de l’autre tout ce à quoi l’on tient, sont une expérience que le journal de Laila retranscrit à vif. Il évoque aussi la grande grève de l’Usine rouge, à Dearborn, dans le Michigan. L’union des travailleurs de l’industrie automobile, la brutale répression du mouvement par les forces de l’ordre, est un épisode marquant de l’histoire sociale américaine, durant lequel les ouvriers arabes et noirs américains firent front commun.
A plus d’un titre, Les Trente noms de la nuit s’inscrit dans le sillage de ces jeunes voix de la littérature d’Amérique du Nord qui, qu’elles soient issues de l’immigration, descendantes d’esclaves ou des communautés amérindiennes, détricotent les mythes de l’Amérique blanche tout en questionnant leur propre identité, leur filiation, le rapport de leur génération avec les traditions de leurs ancêtres et ce qu’elles en ont hérité.
On pense par exemple ici à Tommy Orange, l’auteur de Ici n’est plus ici, mémorable roman choral sur la communauté amérindienne d’Oakland, près de San Francisco.
Le besoin d’appartenance, de comprendre d’où l’on vient, est également prégnant dans le périple intérieur de N. : le journal de Laila Z. agit comme un puissant révélateur, qui le guide dans la compréhension de son histoire comme de lui-même, comble les silences de l’Histoire officielle et pallie au mutisme des anciens – à commencer par celui de Teta, la grand-mère.
« Je suis à bout. Je saigne à nouveau et je sens mon corps lourd et ballonné, et ma poitrine est si irritée que je voudrais déchirer mon binder pour sentir l’air de la nuit sur ma peau. Je m’allonge sur la marche devant la porte barricadée. L’éclat métallique d’un chantier résonne dans la nuit. A un pâté de maison d’ici, un camion balayeur fait sa tournée. J’effleure sa pellicule fraiche qui recouvre le trottoir et j’entends les voix des ouvriers qui ont posé les pavés en dessous ; plus bas encore, j’entends les murmures des personnes mises en esclavage qu’on force à défricher la terre pour y construire les murs qui ont donné leur nom à Wall Street. Je pensais que se souvenir pouvait constituer une forme de résistance, mais je ne sais pas si ça suffit. »
Oscillant d’une époque à l’autre et du point de vue de Laila à celui de N. l’intrigue lève progressivement le voile sur les secrets entourant leurs destins à tous les deux. Elle nous lance à la recherche d’un tableau perdu, celui que Laila aurait peint d’une espèce rare, voire inconnue, dont la mère du narrateur était convaincue de l’existence : l’ibis simurghus, oiseau mythique du poème persan de Farid Al-Din Attar, La conférence des oiseaux, écrit au XIIé siècle.

Il faut souligner ici que les oiseaux, qu’ils soient de chair et de sang ou d’encre et papier, sont omniprésents dans les Trente noms de la nuit. Ils sont toujours, quelque part, dans le champ sensitif des personnages, réagissent aux fluctuations de la ville, au rythme des jours et des saisons. Ils évoquent bien sûr l’exil et la migration, mais aussi la quête du divin.
Fil conducteur de l’intrigue, la recherche du simurgh et de l’oeuvre perdue de Laila Z. est aussi une exploration de la peinture naturaliste ornithologique, dont Zeyn Joukhadar traduit, par ses mots, toute la beauté et la précision. Marqué par les oeuvres de Jean-Jacques Audubon, le parcours artistique de Laila est le fruit de ces influences académiques, qui la fascinent, autant que d’une nécessité personnelle qui semble la relier symboliquement aux créatures ailées.
« J’ai posé la main sur le verre et j’ai scruté l’aquarelle chatoyante, où chaque plume était gravée individuellement. J’ai tracé chacune d’elle sur le verre du bout du doigt et pour la première fois, j’ai senti la possibilité de la beauté se déployer devant moi comme un champ de feu. Quelles lignes pourraient créer mes propres mains, ai-je pensé alors, et quelles couleurs ; et c’était comme si le monde entier m’était offert pour que j’en garde la tracer, avant qu’il s’estompe et ne s’enfonce dans le passé, et j’avais déjà perdu beaucoup de temps, car il n’y avait pas assez de temps dans cette vie pour tout ce que je voulais créer. »
D’une manière générale et plus diffuse, les oiseaux sont au cœur de l’écriture des Trente noms de la nuit, comme le dénominateur allégorique d’un cohérent réseau d’images et de métaphores puissamment évocatrices.
En effet, le style de Zeyn Joukhadar s’ancre dans les corps, et en particulier les corps souffrants, opprimés. Qu’il s’agisse d’évoquer les douleurs des parturientes dont s’occupe la mère de Laila, sage-femme, les violences gynécologiques subies par N., le labeur des ouvriers immigrés, des accidents de ces corps fragiles que sont ceux des oiseaux se brisant contre les vitres des immeubles trop éclairés de New York, il sait se rendre prosaïque, au plus proche de la réalité. Mais la grâce de son écriture tient à ce qu’elle parvient à s’affranchir de cette matérialité, par la puissance de sa poésie et ses images, par l’espoir qu’elle instille en elles et à travers ses personnages.
« Je pense à l’ibis chauve au moment où je glisse les pieds dans les étriers, dans le cabinet de la gynéco, au moment où je voudrais me débarrasser de mon corps pour ne pas y revenir, au moment où ses gants sur ma peau me donnent envie de ramper hors de moi-même.
Mon corps, comme mon sang, constitue un fait, dans une conversation où je n’aurai pas toujours mon mot à dire. Mais je m’accroche à mon nom et tourne le visage vers la fenêtre où, coincée contre la vitre, se trouve une plume couleur rubis tombée de la poitrine d’un colibri à gorge rouge. »
“Pour qui choisit son nom”
L’envolée des mots coïncide avec aussi avec le parcours intime du narrateur. N. est né dans un corps de femme, mais il n’a jamais pu se sentir lui-même, dans cette enveloppe qui l’embarrasse et le fait souffrir ; ne s’identifiant pas aux normes de genre qu’elle implique socialement, il vit au quotidien cette assignation comme une aliénation mortifère.
La dysphorie de genre est racontée par Zeyn Joukhadar avec une grande justesse, tout en pudeur et en subtilité, à travers des images susceptibles de parler à celles et ceux qui vivent au quotidien cette réalité, mais aussi de la faire entrevoir à quiconque. Le roman nous fait épouser la trajectoire de N., de la force délétère qui l’entrave jusqu’à la constellation d’éléments qui lui permettront de s’en libérer. Le soutien, l’amitié des proches en font partie, et la solidarité dont font preuve les protagonistes des Trente noms de la nuit en sont l’un des aspects les plus émouvants.
Dans le Journal de Laila Z, il y a aussi de nombreux personnages gay ou trans, mais sans que cette réalité soit jamais réellement nommée. La nécessité de se cacher, de se fondre dans les normes imposées, la peur du déshonneur et de la violence y sont prégnantes. Il met au jour combien les personnes LGBT, si elles semblent absentes des récits et de l’Histoire officielle, ont toujours été là.
Leur mémoire restituée sera également un précieux guide pour N., reconstituant une forme de filiation. Zeyn Joukhadar témoigne de la somme d’oppressions et de contradictions avec lesquelles on doit composer lorsqu’on est Arabe et queer, tout en offrant à son personnage le cadeau d’un dénouement lumineux.

Les Trente Noms de la nuit est un roman plein de strates et de richesses, qui parle de mémoire et de filiation, d’amour et de quête de soi. Poétique et subtile, l’écriture de Zeyn Joukhadar requiert d’un lecteur auquel les univers du roman ne seraient pas familiers (les expressions en arabe qui parsèment les dialogues entre les personnages, par exemple) qu’il accepte de lâcher prise et de lui faire confiance.
Si l’on prend la peine de faire ce pas de côté, le roman est d’une incroyable générosité. Nous travaillant de l’intérieur, par la suggestion et la résonance de ses images, en empathie profonde avec ses protagonistes, il laisse éclater l’émotion lors de scènes absolument inoubliables. Ses images finissent par résonner également en notre for intérieur, nous rendant sensible un vécu qui n’est pas le nôtre.
Il revendique enfin, pour celles et ceux à qui l’on voudrait refuser d’être ce qu’ils et elles sont, le droit d’exister dans l’Histoire et la mémoire, dans l’art et la littérature, à exister pleinement et librement dans la société, et, quelque soit le sens qu’on lui donne, à participer au Divin.
« Nous nous sommes écartées. Je me suis essuyé le visage du dos de la main.
« Dis-moi quelque chose de beau », tu as dit.
J’ai ouvert la bouche et il en est sorti la seule histoire que je connaisse aussi belle qu’elle était vraie : j’avais un jour rencontré une femme qui savait voler.
Tu as capturé ma main froide dans les tiennes et tu as baissé les yeux vers nos doigts. J’ai espéré avoir eu les mots justes. Ma mère me disait toujours que les gens en deuil préfèrent ne pas parler de la terre.
« Comme c’est merveilleux », as-tu dit « d’être un bref instant si proche de Dieu. »
La brise a poussé tes cheveux sur tes lèvres. Quand mon père avait été blessé lors du soulèvement, j’avais rêvé qu’une nuée d’étourneaux survolait notre village et que leurs larmes se changeaient en graines de grenades. Les graines tombent sur le sol mais la terre était épuisée et les graines ne prenaient pas. Les étourneaux tournaient en rond, incitant la terre à la fertilité. En passant, les oiseaux chantaient un psaume que ma mère m’a souvent cité, un vers du Cantique des cantiques. J’y ai pensé alors, debout sur la corniche, si près de toi que je te sentais respirer.
Tu es absolument belle, mon aimée, et sans aucun défaut. »
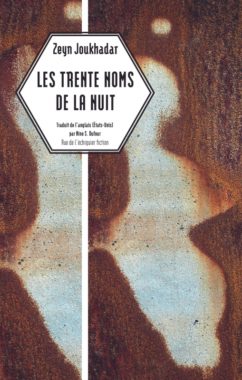
Zeyn Joukhadar, Les Trente noms de la nuit
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nino S. Dufour
Editions Rue de l’Echiquier, 2022
350 p.
Anne.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

