Ben Marcus dit de lui : « Existe-t-il un romancier américain plus férocement brillant et au ton aussi cinglant et hilarant que celui de Paul Beatty ? »
…Avant ce roman, j’aurais répondu oui ! Un énorme oui, car pour moi Percival Everett et son « Effacement » le surpassait. Même si « American Prophet » avait déjà mis à mal le genre – la littérature américaine satirique contemporaine – avec ses personnages aussi complexes et hauts en couleur qu’un Rubik’s Cube et une introduction digne d’un roman de Thomas Pynchon, le lecteur en avait pour son argent. Mais il manquait un je ne sais quoi de démesure ou de folie qu’offrait les romans de Percival Everett. Précisons toutefois que je ne compare pas les deux auteurs car ils sont afro-américains, je parle vraiment de qualité, de style et de l’idée générale qu’offre le texte. Mais voilà, Paul Beatty avec son quatrième roman vient très certainement de franchir un palier, d’atteindre un sommet littéraire que l’on pensait inaccessible et de faire voler en éclats les limites du convenu et du bon sens.
« Moi contre les Etats-Unis d’Amérique » c’est quoi ? Du moins c’est qui ?
Il s’agit d’un homme, fils d’un psychologue aussi tordu que passionné par son monde. Un homme ayant grandi dans le quartier agricole le plus afro-américain de tout Los Angeles, le bien nommé « Dickens ». Un endroit côtoyé par la star de cinéma local « Hominy Jenkins », qui se trouve être le plus important acteur afro-américain de sa génération. Cet enfant élevé selon les préceptes de son père pour en faire un parfait noir américain, n’aimant que les noirs, et ayant le culte de la culture afro-américaine. Un homme dont le père sera finalement le créateur du mouvement intellectuel « Dum Dum Donuts Intellectual » et qui sera abattu par la police. Alors comment casser l’image du père et s’imposer, quand on est le fils d’une icône ? Rien de plus logique que d’avoir un esclave et tenter de rétablir la ségrégation dans la jeune ville renaissante et jumelée entre autre avec la « Cité perdue des privilèges de l’Homme blanc », la grande, la resplendissante DICKENS.
« On dit qu’ « être maquereau, ce n’est pas une sinécure ». Eh bien, être propriétaire d’esclave non plus. Comme les enfants, les chiens, les dés, les bonimenteurs de la politique, et visiblement les prostituées, les esclaves n’en font toujours qu’à leur tête. Et quand ton serf noir est un nonagénaire qui n’a qu’une quinzaine de minute de travail de qualité à t’offrir chaque jour et prend son pied sous le fouet, tu ne profites pas vraiment non plus de tous les petits privilèges du riche planteur que tu vois dans les films…j’étais juste le proprio d’un vieux noir ratatiné qui ne connaissait qu’une chose : sa place. »
Donc un roman satirique et surtout férocement drôle qui pulvérise les tabous de notre bien pensant monde contemporain. Un auteur afro-américain qui interroge le lecteur sur les valeurs de l’esclavage et de la ségrégation, du « trop plein » de mexicains en Californie ou encore du développement de grandes villes en absorbant les petites villes alentours, Paul Beatty percute autant qu’amuse avec ses propos. Son Style swing et son phrasé, remarquablement traduit par Nathalie Bru, joue une partition que l’on a rarement l’occasion d’entendre. Ce qui était remarquable dans ses précédents romans, et explose ici, c’est le groove de son style. Cette sorte de groove qui émane de la lecture et du choix des mots. Il y a de la musicalité dans son texte et un rythme propre qui balade le lecteur durant les quelques 330 pages.
Paul Beatty est assurément un auteur majeur, un auteur qui exige que l’on prenne le temps de le lire et surtout de le comprendre. Un auteur passionnant, intelligent et drôle. “Moi contre les Etats-Unis d’Amérique” marque un cap dans sa carrière et assurément, il s’agit là d’un roman dont on ne finira pas d’entendre parler dans les mois voire les années à venir.
 Cambourakis,
Cambourakis,
350 pages,
Trad. Nathalie Bru.
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

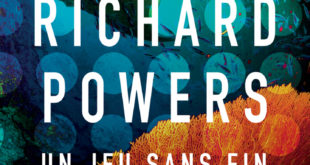
Merci pour cette chronique ! Je note ces écrivains !!