« Le personnage principal de Vulnérables, Billy Pike, est de ceux qui sont tombés avant de découvrir qu’il n’y avait personne pour les relever. »
Extrait de la préface de Vulnérables, de Richard Krawiec
A vrai dire, je n’ai jamais compris l’intérêt des préfaces. Généralement, un professeur plus ou moins érudit décrit par le menu tout ce qui va se passer dans le livre qu’on tient entre les mains, piétinant alors le mystère de l’œuvre à venir, anticipant les rebondissements et allumant la lumière dans chacune des pièces obscures du texte. Ce serait comme un magicien qui commencerait par montrer le double fond de la boite dans laquelle son assistante s’apprête à prendre place. Ainsi, rares sont les préfaces qui ne viennent pas saccager le plaisir du lecteur.
Mais il y a d’autres types de préfaces, et celle de Richard Krawiec est essentielle. C’est une porte d’entrée dans son roman autant qu’une mise en garde. Attention où vous mettez les pieds, ce livre n’est pas à mettre entre toutes les mains. Les adorateurs des histoires qui se finissent bien, où la rédemption et l’amour sont au bout du chemin, ne sont pas les bienvenus ici. Dans Vulnérables, on prend le lecteur par la peau du cou, on le balance sans ménagement dans le tambour d’une machine à laver lancée à pleine puissance et on ramasse les morceaux à la fin du programme.
Il y a quelques années, les magnifiques éditions 13ème Note s’étaient données pour ambition de publier les auteurs les plus marginaux, les plus défoncés et les plus paumés de la littérature américaine. Sous le patronage spirituel de John Fante et de son disciple Charles Bukowski, les auteurs 13ème Note racontaient leurs déboires, leurs bitures et leurs expériences du fin fond du caniveau. C’était de la littérature noire, mais pas au sens polar et détective. C’était noir comme la nuit, noir comme la crasse, noir comme le désespoir. C’étaient des récits d’hommes qui chutent et qui n’ont rien à quoi se raccrocher. C’étaient des histoires d’hommes qui étaient tombés avant de découvrir qu’il n’y avait personne pour les relever.
Malheureusement, l’aventure 13ème Note n’a duré que cinq ans. Les (anti) héros des livres qu’ils éditaient n’avaient pas une espérance de vie plus longue une fois qu’ils avaient plongé dans le sordide.
C’est l’idée qui m’a habité au fil de ma lecture. Vulnérables aurait tout à fait eu sa place dans le catalogue 13ème Note. C’est un compliment. C’est même une déclaration d’amour. Les romans où des personnages luttent de bout en bout pour sauver leur peau mais qui ne se rendent pas compte qu’ils creusent chaque jour un peu plus leur propre tombe me fascinent. N’est-ce pas là la définition du romantisme ? La synthèse entre l’ardent et le triste ? L’homme qui se débat alors que tout espoir est déjà envolé ?
Vulnérables raconte l’histoire d’une déchéance, et son acceptation. Billy retourne vivre chez ses parents qu’un récent cambriolage a traumatisé. Sa vie de petit délinquant minable a déçu sa famille. En retournant dans la maison de son enfance pour protéger ses parents, Billy essaye de racheter ses fautes, et combattre l’homme qu’il est. Mais il est déjà arrivé au bout de la route. En pourchassant une espèce de doppelgänger dans les rues tristes et sans avenir de cette banlieue pavillonnaire, il tente de s’approcher d’une improbable rédemption. Pour cela, il s’accroche aux rares branches qui ne sont pas encore mortes, comme son neveu obèse et touchant Stevie ou cette femme, Sharon, qui lui a tapé dans l’œil malgré la polio qui lui a ravagé la jambe.
Personne ne trouve grâce aux yeux de Billy. Son père est aussi lâche que sa mère est neurasthénique. Son petit frère est un abruti violent et alcoolique. Sharon est un monstre de foire, ce que ne se prive pas de souligner sa famille lors d’un déjeuner où domine le malaise (un des meilleurs chapitres du livre, où le rire jaune et la consternation se disputent chaque ligne). C’est le portrait implacable et sans concession de ces Américains white trash que l’on pourrait croire sortis d’une télé réalité, des beaufs qui s’enfilent des bières au petit déjeuner avant d’aller gaiement voter pour Donald Trump.
Longtemps je me suis interrogé sur la définition exacte de l’expression « l’Amérique des laissés pour compte ». Elle fleurit ça et là sur les quatrièmes de couverture des livres où un personnage n’a pas l’air de rentrer dans les clous tracés par son milieu ou, plus largement, par la société américaine. Je la trouve rarement pertinente car, à mes yeux, elle définit un ensemble de population trop vaste. Qui sont les laissés pour compte ? Les pauvres, les alcooliques, ceux qui ont fait un pas de côté, volontairement ou non ?
Vulnérables offre une définition : le laissé pour compte est ce type qui n’a aucune carte en main pour s’en sortir. Sa famille est dysfonctionnelle mais trop lâche pour constater les fêlures qui l’accablent. Son boulot est soit inexistant soit bien en dessous de ses capacités. Surtout, il n’a aucune perspective autre que sa propre mort. Rien ni personne ne viendra lui tendre la main. Le rare argent qu’il possède est aussitôt dilapidé. Les plus sauvages le dépensent en alcool, les plus mesurés s’en servent pour rembourser le prêt de leur maison qui tombe en ruine. Et tous observent le mirage de cette Amérique aux pieds d’argile, avec suffisamment d’acuité pour comprendre que le modèle va droit dans le mur.
Alors, ils sont les seuls à voir que le pays – et le rêve qu’il croit incarner – est déjà tombé, sans se rendre compte qu’il n’y aura personne pour le relever.
Alexandre
 Vulnérables
Vulnérables
de Richard Krawiec
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé
éditions Tusitala
221 pages
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

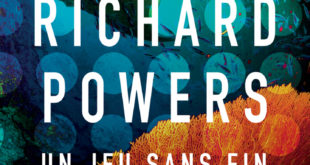
Excellent billet, tout est dit !