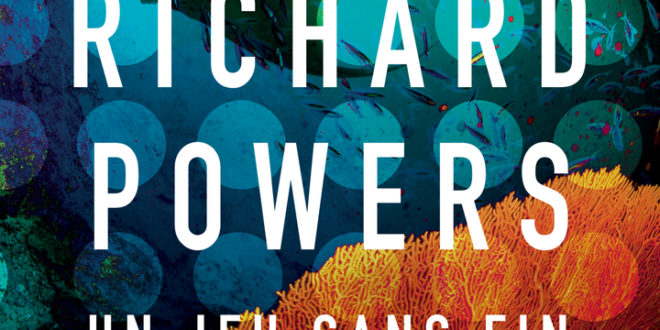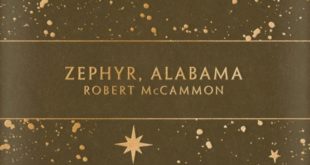« Un jeu sans fin » marque le retour de Richard Powers. Quatre ans après le plutôt convenu « Sidérations », il était à craindre que depuis « L’arbre monde », l’auteur originaire d’Evanston dans l’Illinois ai fait le tour de son style et ne parvienne plus à se renouveler.
« Un jeu sans fin » est un roman, en apparence, de trajectoire. La trajectoire d’une île de la Polynésie française et de ses habitants, celle de deux amis d’enfance – l’un d’une famille dysfonctionnelle, mais d’un milieu aisé ; l’autre également d’une famille dysfonctionnelle, mais dans un milieu prolétaire – et enfin la trajectoire d’une océanographe quasi-centenaire.
En alternant les chapitres et les époques, nous découvrons chaque vie ainsi que leurs trajectoires qui vont finir par les amener à une île, Makatea, centre de l’attention de tous, suite à un projet d’un consortium, mené par le milliardaire Todd Keanes (un des deux amis d’enfance). Sur Makatea vit Rafi (l’autre ami d’enfance) avec son amour de fac.
Mais revenons sur Todd, ce dernier, dans ses chapitres, nous apprenons rapidement que ce dernier est atteint d’une maladie neuro-dégénérative, et que malgré tout son succès et sa fortune, il se retrouve impuissant face à ce combat. Ce qui petit à petit fait apparaître ce projet comme étant son œuvre testamentaire, une sorte de don à l’humanité (une humanité toute libertarienne, il ne faut pas déconner non plus).
Puis il y a l’océanographe, Evie Beaulieu, une Canadienne, fils d’un inventeur de bathyscaphes qui a passé sa vie à parcourir les fonds marins. Nous suivons sa jeunesse, ses années d’études, ses explorations et nous plongeons avec elle dans un monde incroyable.
Il est important de rester volontairement, à mon sens, le plus vague possible quant au fil narratif de l’histoire, tant l’auteur se joue, avec bienveillance et petites touches, de notre crédulité face à la narration. Ainsi peut-être qu’à la lecture de ce “jeu sans fin”, vous risquez, lors de quelques chapitres, de tirer des conclusions hâtives, de créer des liens, des déductions, que le final viendra vous balayer d’un revers de la main, en vous offrant un retournement de situation assez grandiose.
Ce qui pose invariablement la fameuse question : qu’est-il le plus important, le voyage ou la destination ?
Richard Powers, avec « Un jeu sans fin » renoue avec le grandiose, et ce dernier roman en date est à classer au côté de « L’arbre monde », « Orfeo » ou encore le monumental « Le temps où nous chantions » .
Enfin, il paraît important de parler des parties sur Evie Beaulieu. Les passages descriptifs de la vie marine sont d’une beauté, d’une poésie et d’une analyse tellement vertigineuses que vous risquez de vous surprendre à relire ses parties tant la connexion se fait entre le lecteur et les mots imprimés sur les pages. C’est d’une beauté infinie et il faut bien admettre que rien que pour ça ce roman vaut le coup d’être lu.
D’une apparente simplicité dans le style, tout en renouant avec cette empathie à fleur de peau, que l’on retrouvait déjà dans « Le temps où nous chantions », Richard Powers propose un livre brillant, intelligent et touchant. Une déclaration d’amour aux océans, mais également aux humains dans toutes leurs complexités.
« La terre n’a-t-elle pas le triste privilège de ne faire que comprendre le mal dans toute sa force, mais sans l’éradiquer, et n’est-ce pas là la raison pour laquelle le mal atteint sur terre son plus haut degré ? La terre est une île isolée. »
Nikolaï Fiodorov
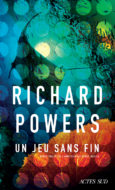 Editions Actes Sud,
Editions Actes Sud,
Trad. Serge Chauvin
416 pages,
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire