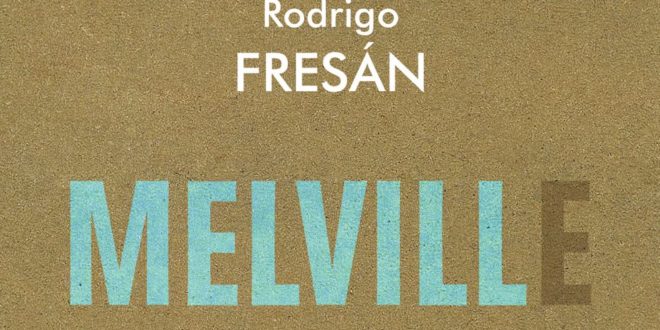Entrer dans la psyché et le parcours d’un enfant accompagnant son père durant ses derniers instants, voici la proposition plutôt singulière du dernier roman de Rodrigo Fresán. Après « La part inventée » et « La part rêvée », et en attendant le troisième volet de sa trilogie (La parte Recordada), l’auteur de « Mantra » nous plonge dans l’univers d’Herman Melville, et nous propose comme dans un complément à sa trilogie, une ultime expérience.
Ainsi dans sa construction, brillante, l’auteur nous projette dans les méandres et la psyché d’un Herman Melville pétri d’un héritage névrosé ( celle de son père, Allan) et qui par jeu de glose se retransmet également au travers des siennes. Plus qu’un exercice de style, Rodrigo Fresán arrive à dépasser le formalisme metafictionnel pour proposer une plongée, acide, dans ce qui façonne la glaise et construit une grande œuvre comme Moby Dick ou Bartelby.
Ce qui en soi pourrait sembler périlleux, mais le talent narratif et l’écriture sublime (et magnifiquement traduit par Isabelle Gugnon), évite tous fossés qui pourraient égarer le lecteur et apportent une construction solide tout en nuances et en profondeur. Nous sommes face à une œuvre monde, mais du point de vue du démiurge façonnant un univers qui marquera notablement la littérature américaine et mondiale.
Car ”Melvill(e)” répond pleinement à ses ambitions de départ, nous sommes au côté d’Herman et nous prenons de plein fouet toute la roublardise et le gigantisme d’un père qui s’inscrit avant tout et surtout dans un narratif totalement fictionnel, transformant ses mésaventures en épopée homérique ou en mythologie quasi biblique. Son « Grand Tour » devenant lieu de rencontre avec le merveilleux et l’étrange, sa traversée du fleuve gelé un périple digne d’une expédition dans le grand Nord, etc…
Ainsi, se pose, en filigrane, la question de la fiction, comment naît-elle, ce qui la façonne et comment cette dernière finie par s’affranchir de ses références de départ pour devenir autonome. Car tout comme dans ses précédents romans, Rodrigo Fresán semble invariablement se questionner sur ce qu’est et fait la fiction.
Sans jamais être opaque pour les néophytes des œuvres de H.M, ”Melvill(e)” peut se lire indépendamment des livres de l’auteur de Moby Dick, car ici ne compte pas tellement les références mais plus la psyché et cette sorte d’ébriété provoqué par des moments de bravoure littéraire, empruntant même par moment, dans sa narration la figure du labyrinthe, pour nous faire ressentir encore plus fortement cette sensation de vertige.
En bref, et pour éviter de trop en révéler, “Melvill(e)” s’aborde autant par le prisme de l’expérience littéraire que par celui de l’implication du lecteur face à l’ingéniosité du roman proposé dans sa narration. Il y a autant à savourer dans un sens que dans l’autre. Bien plus qu’un hommage, l’auteur a su s’emparer de la vie des Melville pour en proposer un roman un par entière et proposer, in fine, une piste de ce qui peut conditionner une personne à devenir auteur.
Melvill(e) fonctionne autant indépendamment des autres œuvres de Rodrigo Fresán, que comme un complément, et en attendant le dernier volet de sa trilogie, l’auteur nous prouve une nouvelle fois son talent et sa finesse d’écriture, offrant au lecteur des pages de littérature magnifiques et une histoire passionnante.
 Éditions du Seuil,
Éditions du Seuil,
Trad. Isabelle Gugnon,
350 pages,
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire