La peur est une émotion puissante. Elle conditionne nos choix, y compris nos choix collectifs. Dans le récit de Rui Zink, on installe la peur comme on installerait le câble. Quelques discussions en plus…
Une femme est seule avec son enfant dans son appartement. Deux hommes se présentent à sa porte. Ils sont mandatés par le gouvernement pour appliquer la directive n°359/13. Cette directive a été créée dans un « objectif patriotique », pour que la société fonctionne mieux, pour que les gens votent correctement et pour que chacun connaisse sa place. Elle impose à tous les citoyens l’Installation de la peur.
Aussi, les deux hommes, un technicien et un agent aux allures de commercial, pénètrent donc dans l’appartement sous l’œil résigné de la femme. Elle sait et ils savent qu’elle ne peut y échapper. Elle est même fermement priée d’y participer :
Il ne revient pas qu’à nous d’installer la peur, il faut qu’il y ait de la part de nos concitoyens un état de disponibilité mentale (je dirais même « morale ») afin d’accepter la peur.
Mais ce qu’ils ignorent, c’est qu’elle est uniquement préoccupée par la nécessité de leur cacher l’existence de son enfant, pour une raison inconnue, mais qui laisse présager le pire quant à ce gouvernement. Les deux hommes commencent donc leur besogne et installent un appareillage visiblement aussi complexe qu’obscur pour le lecteur comme pour la femme. Hologrammes, jeux de lumières, peut-être même de température, la machine est prête à l’emploi. Cependant, le protocole exige une démonstration. Dès lors, le lecteur assiste, et ce durant tout le récit, à un huis-clos à la fois drôle et anxiogène. Mais surtout terriblement grinçant.
Sous les yeux angoissés de la femme (obnubilée par la peur de voir son enfant découvert), Carlos le beau parleur au physique de commercial, et Sousa, le technicien à l’allure de brute épaisse, vont dérouler, dans un numéro bien rôdé, une série de tableaux tous plus inquiétants les uns que les autres.
Peur de la pandémie, xénophobie, peurs enfantines, peur des animaux, peur du marché, peur du terrorisme. Peur des autres, peur pour soi-même. Peur des vieux, peur des jeunes, peur des pauvres, peur des chômeurs, les deux hommes cherchent à provoquer une peur « pédagogique » qui monte l’un contre l’autre. Toujours l’un contre l’autre. Pour que chacun connaisse sa place.
Le roman fonctionne comme une fabuleuse caisse de résonnance de notre époque. Avec un esprit résolument insoumis, perturbateur et désobéissant, il pointe intelligemment les travers d’une société ankylosée dans ses peurs, et s’attaque avec un humour caustique aux sujets les plus délicats :
– Le terrorisme, c’est ce qui marche en ce moment.
– C’est un peu passé de mode.
– Mais ça marche encore.
– Ca marche toujours. Il suffit de congeler l’imagination.
– D’où l’importance de l’éclairage.
– Du contre-jour.
– Du jeu d’ombres.
– Ce qui est merveilleux avec les terroristes, c’est qu’eux, personne ne les voit, seulement leurs résultats.
– Ils pondent des œufs, et ceux-ci explosent, mais où sont les poules ?
Le cynisme dont font preuve les deux agents gouvernementaux est à couper le souffle. Uniquement préoccupés par la mise en place de leur fameuse « réforme structurelle », ils se laissent aller dans un numéro qui a tout du numéro de cirque.
Carlos et Sousa jouent avec les mots, ils convoquent le lexique de l’économie, incompréhensible, déconstruit, truffé d’anglicismes au point qu’il en perd tout sens. Et cette perte de sens est nécessaire pour nourrir une des peurs les plus importantes de l’époque et qui revient régulièrement dans le récit : la peur du marché.
Il est une plante dans la cave d’un vieil hôtel construit sur les vestiges d’un temps ancien. Une plante intelligente, humide, obscure, féroce, qui émergea d’un long sommeil et qui désormais, chaque nuit, exige sa ration de chair humaine. […] Cette plante répond au nom de Cthulhu, Baphomet, Azagoth. Et dernièrement, Marché.
Au fur et à mesure de la démonstration, les dialogues s’enchaînent, les deux hommes se répondent, se complètent, s’associent pour marteler, détailler, débiter, et leur phrases s’ajoutent les unes aux autres dans un trop-plein qui devient terriblement anxiogène.
C’est là un des coups de génie du romancier. Dans une écriture à la fois brute, élémentaire, sans le moindre artifice, mais extrêmement subtile et intelligente, il parvient à mettre en récit ce verbiage incessant, ce bruit de fond (médiatique, politique) qui nous entoure en permanence et qui nous laisse difficilement le répit nécessaire, le temps d’y penser. Le protocole de l’installation de la peur paraît drôlement familier.
La tension monte petit à petit dans la pièce et l’on en oublierait presque la femme, celle à qui est faite cette démonstration. Cette femme qui pour eux ne représente rien, si ce n’est la citoyenne ordinaire, sans surprise, sans profondeur :
La femme ne veut pas parler – de quoi parlerait-elle ? Du temps, du coût de la vie, du mauvais temps, de ce que la vie est difficile dernièrement, du beau temps, de ce que la vie est difficile dernièrement, de ce que les jeunes n’ont pas leur avenir assuré, de la difficulté à trouver du travail, de ce que les jeunes d’aujourd’hui ne connaissent rien à rien et les jeunes d’hier ont mal vieilli, du temps, du coût de la vie, du chômage, de la série télé, du temps, du temps, du temps ?
Pourtant la simplicité, comme dans tout le roman, n’est qu’apparence. Et la peur est mouvante. Elle loge dans les recoins les plus obscurs. Quand on croit la maîtriser on s’aperçoit, trop tard, qu’elle a déjà changé de forme.
La subtilité de l’écriture de Rui Zink, qui convoque, dans une forte intertextualité de grands noms de la littérature, parmi lesquels Pessoa, Cortázar, Orwell ou Lovecraft, permet de dresser, avec une ironie sans fard, un portrait au vitriol de notre société. En brandissant un miroir grossissant sur les mécanismes de la peur, il alerte sur les possibles conséquences et interroge élégamment notre propre capacité à résister.
Quand on a une âme, facile de dire ce qui la tourmente. Et quand on n’en a plus ? Des temps sans âmes exigent des gens sans âmes. Le désert désertifie. La soif assèche. La solitude résonne. Que d’évidences, le train des choses et ses dommages collatéraux…
L’installation de la peur est un livre surprenant et brillant. Habile, drôle et grinçant. On en ressort ragaillardi, peut-être un peu plus courageux, en tout cas plus lucide. Une très belle réussite.
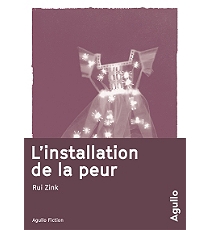
Agullo, coll. Agullo Fiction
Traduit du portugais par Maïra Muchnik
224 pages.
Hédia
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire


Très très prometteur et tellement vrai malheureusement !