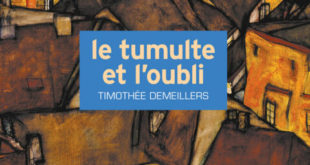Pour la Meute, il est Falco. Avec elle il n’y a plus de “Je”, il n’y a qu’un “Nous”.
Crânes rasés, corps secs tatoués, ceux qui appartiennent à la Meute se nourrissent de la haine. Celle des autres, des plus faibles, des étrangers, comme pour mieux camoufler celle qu’ils ont d’eux-même et de la classe ouvrière dans laquelle ils grandissent.
Falco raconte le choix de la violence plutôt que de l’amour. Il raconte ce besoin “d’incendier sa vie” pour se sentir exister. Et c’est ce qu’il va faire, brûler les étapes, se jeter à corps perdu dans le brasero de la haine, parce que c’est ce qui entretient le mieux les flammes de la colère qui brûle en lui, de la rage qui l’habite.
Les pourquoi et les comment viennent plus tard – trop tard ? – alors qu’il s’est “retiré du monde, il se souvient, et se fait face”. Pas de repenti larmoyant mais une prise de conscience, une tentative pour comprendre cette jeunesse vécue les nerfs à vifs, pour retrouver ce qui reste de bon en lui. Il revit cette vie fragmentée, ces vides à combler, le manque de reconnaissance, cette course folle vers un précipice qu’il ne veut pas voir.
“Nous ignorons ce qui nous rattache à l’humanité, nous retient. Un lien, un nerf. Cela ne vient pas de l’esprit. C’est viscéral. Un instinct contre l’instinct. Nous n’étions pas des fauves ni des sauvages. Nous allions devenir des barbares. Je suis devenu meurtrier.
Nous sommes encore des hommes. Avons nous échoués ?”
Il y a eu un avant et un après mais aujourd’hui Falco est à la fois son passé, son présent et son futur. On a la sensation que ces trois temporalités l’habitent, qu’il est le passé qu’il tait, le présent qu’il vit et l’avenir qu’il espère. Il a laissé derrière lui le paysage urbain, gris, dur, agressif et froid, comme les murs de la prison, et s’est exilé dans les montagnes où les espaces y sont plus vastes, l’air vivifiant et l’atmosphère apaisante. C’est dans ce cadre qu’il tente de se reconstruire et d’évacuer ce qu’il reste du passé car si l’incendie s’est éteint les braises se ravivent parfois dans ses tripes.
“Qu’y a t-il au fond de moi, de sauvage, de mauvais ? Quel est ce mal ? Une force profonde qui me précédait je crois. Qui me la transmise ? Une maladie présente depuis l’origine, qui surgit soudain et se déploie. Certains savent la juguler, d’autres cèdent et se laissent emporter. Ceux là dévastent tout sur leur passage. Quel est ce mal qui refuse de quitter nos existences ? Comme si notre source même était polluée. Suffit-il d’avoir été blessé pour qu’il se déclenche et que nous le transmettions à notre tour ? C’est une lésion du sens. La vie infectée.”
Stéphane Guibourgé nous livre un texte profond, direct mais beau dans sa dureté.
À travers son personnage il s’interroge sur la haine qui s’immisce dans le cœur des Hommes, qui bouillonne et explose chez certains telle la lave d’un volcan en éruption, qui reste en sourdine chez d’autres tels des volcans endormis.
Il nous parle de cette rage que l’humiliation et l’indifférence peuvent produire, que le contexte social peut cultiver. Il nous interroge sur nos failles, sur les ombres du passé et les traces qu’elles laissent par la suite. Comment vivre avec ? Comment maîtriser ou au moins apaiser la colère qui gronde, la violence sur le point de jaillir, les coups à portée de poing.
Il pose plus de questions qu’il ne donne de réponses, peut-être parce qu’elles sont en chacun de nous.
“J’ai envie de faire mal, de blesser. C’est en moi, je n’y peux rien, c’est hors de contrôle. Je voudrais être capable d’aimer. Je ne sais pas. Cela vient du cœur. J’existe à l’écart de qui je suis.”

Fayard, 2014
208 pages
Pauline
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire