La mort d’une mère peut provoquer une éruption pareille à celle d’un volcan. Elle fait jaillir une ardente vérité et son enfant brûlé prend douloureusement conscience du vide d’abord, de la solitude, puis de la bassesse des hommes et enfin de sa propre compromission.
Alma est partie à trois heures. Assise chez le boucher, malade, elle s’est brusquement effondrée. Raide morte. L’histoire commence le jour de son enterrement. Elle n’est pas vraiment regrettée par son mari Knut, qui la trouvait laide, ni par ses proches pour qui elle était juste désagréable. D’Alma on ne sait rien, si ce n’est l’antipathie qu’elle provoquait chez les autres. Pourtant elle n’était pas qu’une épouse, une voisine ou une lointaine parente :
C’est aussi une mère que l’on enterre et son fils a vingt-ans, et c’est tout ce qu’il a.
Son fils c’est Bengt et c’est le seul qui la pleure sincèrement. Il est cet enfant brûlé. Physiquement et moralement brûlé par une chandelle qui symbolise l’absente lors du repas de funérailles. Il est consumé par son chagrin. Mais à travers ses larmes Bengt voit, observe, comprend. Malgré sa douleur il voit la beauté solennelle :
Il a devant les yeux un spectacle qu’il n’oubliera jamais, tant il est beau et terrible. Car les quinze, vêtus de noir, se sont arrêtés au milieu de l’escalier. La grappe de leurs corps masque toute la fenêtre. C’est donc pour cela qu’il fait si sombre […] Ils restent un instant immobiles comme s’ils posaient pour un photographe invisible. Puis, lentement, ils continuent la descente. Ils s’avancent vers lui comme une seule grande ombre. L’escalier de douleur est terminé.
Mais il voit aussi les yeux secs de son père qui n’a pas pleuré. Et peu à peu il saisit l’insupportable vérité. Bengt est de nouveau brûlé. Brûlé par la haine qu’il voue à son père et à Gun, sa maîtresse. Une haine fièrement érigée en l’honneur de sa propre pureté et en la mémoire de sa mère, qu’il veut défendre avec courage. Du moins c’est ce qu’il se force à penser. C’est de cette façon qu’il justifie cette brûlure qui grandit à l’intérieur de lui. Car c’est un personnage qui aime par-dessus tout l’analyse. Plusieurs de ses lettres montrent son goût pour le raisonnement, sa vocation pour la lucidité. Cependant le narrateur prévient :
Nous agissons quelques fois sans savoir pourquoi. Ensuite nous sommes étonnés de ce que nous avons fait. Nous pouvons aussi être effrayés. Mais de l’étonnement ou de la peur se dégage une explication de cet acte. Il doit en être ainsi, car l’inexpliqué nous rempli d’une angoisse que nous n’avons pas la force de supporter longtemps. Mais quand l’explication est pensée ou exprimée, nous avons déjà oublié qu’elle est venue après coup, que l’acte est premier. Si nous l’oublions définitivement, parce que l’explication est en accord avec l’acte c’est parfait. Il arrive pourtant que ce ne soit pas parfait. Il en est ainsi lorsque soudain nous découvrons que l’explication qui nous était donnée est mensongère, que celle-ci, quand les conséquences de l’acte se sont éclaircies à la lumière de tout ce qui est arrivé par la suite, se trouve être un faux selon ce que nous visions au fond de nous-mêmes en agissant ainsi. C’est alors que nous éprouvons une véritable angoisse. Car celle-ci c’est de ne pouvoir se fier à ses propres pensées quand elles sont seules, c’est de savoir que nos pensées mentent, bien que nous soyons nous-mêmes sincère.
Car finalement, la mémoire de la mère est un paravent derrière lequel le fils se cache à lui-même les sentiments de désir et de jalousie qui l’animent quand il pense à Gun, ou quand il est forcé d’être en sa présence. Ce feu va jusqu’à lui rendre insupportable le caractère de la trop fragile Bérit, sa propre fiancée.
La mort de la mère est donc le déclencheur de relations troubles entre le père et le fils, faites de suspicions, de jalousies et de non-dits. Elle est également le centre de formes géométriques qui s’enchevêtrent et composent l’ensemble du roman : le triangle œdipien où Gun finit par prendre la place de la figure maternelle et l’impossible carré, formé par les deux couples : Gun et Knut d’un côté, Bérit et Bengt de l’autre. Cet apaisement, ce carré impossible donne son titre à l’un des chapitres « thé pour quatre ou cinq » car au centre se trouve toujours la chandelle, l’absente, leitmotiv du roman, qui continue de brûler symboliquement le fils.
La mort d’une mère c’est également la nécessité de grandir. Bengt voit son père comme un traître, un ennemi et un lâche. Mais l’image de la mère se ternit également peu à peu quand les souvenirs ressurgissent. Les désillusions sont profondes. L’expérience des aînés est vécue comme une tare par l’enfant et devient le contraire de ce qu’il appelle la pureté :
Lorsqu’ils sont irrités, ils passent leur irritation sur les enfants ; car, qu’est-ce que l’éducation sinon un effort de parents irrités pour étouffer ce qu’ils reconnaissent chez leurs enfants comme étant ce qu’ils ont étouffé de meilleur en eux-mêmes ?
La pureté prend d’ailleurs différentes formes selon l’évolution de Bendt. Elle est la vérité, puis la bonté, ensuite l’inexpérience. Elle devient l’amour. Puis s’ancre en lui l’évidence : la pureté n’existe pas. Les hommes se mentent, s’accommodent de leurs propres sentiments et perdent toute grandeur, aveuglés par leurs propres mensonges. Cette pensée saisit les personnages, l’alcool aidant, dans des éclairs de lucidités aussi violents que fugaces. Ainsi le père l’entraperçoit :
Pour la première fois l’être lucide, celui qui est là assis sur une chaise, s’empare de l’ivresse du fils et explique au fils ce qui arrive dans le monde lucide ; il explique comme la vérité y est terrible. Alors soudain son ivresse se déchire et, pendant une seconde, saisi d’effroi, il a conscience de la profondeur de la fissure. Mais l’ivresse se déchire ainsi que le brouillard. Tout de suite elle redevient dense et le père n’a rien remarqué.
Mais Bengt est le seul à le comprendre pleinement et il ne sait pas quoi faire de cette vérité encombrante, implacable, féroce. On peut mentir aux autres pour différentes raisons qui sont même parfois des excuses, mais finalement, et beaucoup plus gravement, on se ment à soi-même. On se résigne, on se conforme et finalement on se soumet. Comment vivre une fois que l’on sait ça ?
L’écriture de Dagerman, faite de descriptions factuelles, concises, est une écriture sèche et précise, parfois rugueuse, dans laquelle se lit chaque sous-entendu, dans laquelle on comprend le monde et nos propres ombres avec une acuité ahurissante. Les âpretés y côtoient des fulgurances éclatantes, et de ce mélange particulier nait une beauté terriblement sombre.
Avec sa lucidité impitoyable et sa prose acérée Dagerman réduit à néant les distances temporelles et spatiales entre le roman et son lecteur. L’enfant brûlé, comme beaucoup d’autres textes de l’écrivain, est de ces œuvres majeures qui parlent directement aux âmes humaines. Parce qu’il les a sondées. Parce qu’il y a vu quelque chose d’universel et d’inquiétant. Une animalité qu’il déverse dans le roman avec l’allégorie de la jalousie comme tigre qui dépèce la raison incarnée en gazelle. Mais surtout avec la présence du chien de Gun. Animal méprisé, maltraité parce qu’il est le témoin silencieux de toute l’histoire. Le miroir de la conscience des hommes :
Dans le monde des petits chiens nous sommes tous des tricheurs. Dans le monde des petits chiens nous faisons tout pour rire. Pour rire, nous donnons à manger des petits morceaux de nos sentiments. Pour rire nous disons que nous aimons tout les petits chiens que nous rencontrons […] Dans le monde des petits chiens la confiance est inutile ; aussi n’en a-t-on pas. Si par hasard quelqu’un en a, c’est pour rire. Car dans le monde des petits chiens tout ce qui arrive, arrive pour rire.
Pourtant, aussi sombre et désabusée soit elle, l’écriture de Dagerman est toujours porteuse d’une étrange et triste beauté, de l’espoir d’un soulagement. Et c’est bien en partie cet apaisement qui donne son titre au roman :
Nous savons que le désert est grand. Mais nous savons aussi que c’est dans les plus grands déserts que les oasis sont les plus nombreuses. Nous devons payer cher pour savoir cela. Une éruption de volcan en est le prix […] C’est pourquoi nous devons bénir les volcans, les remercier de nous avoir aveuglé pour acquérir une vie parfaite. Les remercier encore de nous brûler, car seuls les enfants brûlés peuvent réchauffer les autres.
Les commentateurs de Dagerman disent qu’il est lui-même cet enfant brûlé. Car, abandonné par sa propre mère, témoin d’une époque sombre et violente, désabusé, il n’aura de cesse durant sa courte vie de témoigner de la vacuité d’une époque, de l’impossibilité d’en guérir et de ce douloureux constat, titre de son dernier écrit : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Il est cet enfant brûlé du roman car savoir qu’on partage, avec un être aussi lointain soit-il qu’un écrivain suédois mort au siècle dernier, une angoisse, un besoin d’être rassuré, savoir que dans nos peurs et nos désillusions nous ne sommes pas seuls, et le savoir grâce à la beauté de son écriture, effectivement, cela nous réchauffe.
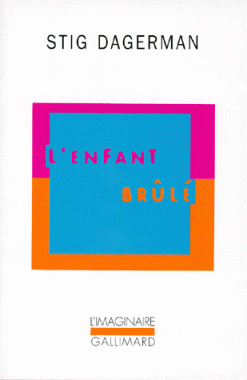 Éditions Gallimard collection l’Imaginaire
Éditions Gallimard collection l’Imaginaire
Traduit du suédois par F. Backlund
Préface d’Hector Bianciotti
350 pages.
Hédia
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

