
C’est une histoire de poisons, de femmes-poisons. Des femmes voient le jour à différentes époques, sur des sols de marbre, et au revers de leur noblesse s’initient aux plantes. “Cigüe” en anglais se dit hemlock. On voit vite que le marbre est maculé de boue. C’est pas épais, une fine pellicule sur laquelle on se met à glisser, à se salir, de plus en plus — si bien qu’au bout d’un moment c’est fou comme on se souille. Ces femmes se souillent, avec dégout d’abord, puis de leur propre chef. Le corps de chacune est livré au mauvais temps. Leurs vies sont traversées d’intempéries masculines. Mais peu importe le corps ici, puisqu’elles s’en extraient comme un insecte s’extrait d’une coque de noix.
Il ne reste que la tête, que le chef. Un psychisme tout en lames, tout en armure, coupant, s’est levé sur la chair mobile qui continue de les représenter dans le monde. Franchement c’est comme un cœur qui bat : chacune de ces femmes fait naitre en moi cet effroi-là quand après quelques dizaines de pages son caractère s’affirme : elle avance, armée, volonté au clair ; elle m’apparait comme un cœur qui bat hors de son corps. Volonté tirée au clair, existence hors du fourreau.
Leur corps est le fourreau. Loin du chef, il continue de se mouvoir au fil des rues, des collines et des domaines. Fourreau, il l’est nécessairement (du latin vagina). Mais de ce fourreau rompu à sa tâche, une volonté se dégaine.
La soumission ne passe pas. Elles en sortent vivantes. Je veux dire : au milieu de leur vie (comme d’une forêt obscure) elles s’extirpent de tout ça. Elles laissent leur corps perpétuer les mouvements habituels, attendus, réclamés. Mais elles, de leur chef, s’en sortent. Un sourire vient fendre leur visage, dévoile des dents préservées, un tour amène. Elles passent par un alambic. Une distillation, une chimie a transformé leur douleur, leur souffrance, physique, psychique, tous ces arrachements répétés de nerfs jetés en tas, une chimie a transformé tout ça en un sourire éclatant.
Leur sourire éclate à plusieurs reprises.
Il fait un bruit de corps qui tombe, ou de drap trempé qu’on tire jusqu’aux tempes.
Il perfore. C’est une morsure. Leurs dents, préservées donc, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails qui nous soient dissimulés quant aux pratiques de l’époque, y compris médicales, ne sont pas des dents comme les autres.
Sont symboliquement des crochets. Crochets dans la bouche de Beatrice Cenci, crochets dans celle de Marie-Madeleine Dreux d’Aubray, crochets chez Augusta Fulham. Le serpent n’est ni le diable ni la femme. C’est un être sur lequel on marche, qu’on surprend nu, et qui se sent défié.
Décidément, l’opulence de la langue, l’assiette de la phrase et l’extravagance de l’érudition ne sont pas seules à rappeler Salammbô. La femme, le palais, le serpent. La différence tient peut-être dans la sacralité de la princesse carthaginoise, son statut d’idole. Cenci, Brinvilliers et Fulham doivent jouer sans cette carte. On ne pose pas le pied sur Salammbô. Sur elles, si. Est-ce que Wittkop pose aussi le pied sur Flaubert ? C’est ça, cette crasse, ces caries, ce sperme qui environnent le corps des dames ?
On dirait qu’on a oublié le style de Flaubert sous le soleil d’aout. La chaleur a fait lever du moisi, des vers, le papier grisonne et grouille. Wittkop casse tout ça. Cet orientalisme. Le métronome ternaire de la phrase flaubertienne, le fantasme sous verre. Dans Hemlock (à travers les meurtrières), c’est vrai qu’il reste dans la langue quelque chose de luxuriant. Sémantiquement, Wittkop nous en fout plein la vue. Mais ces femmes ? On dirait des chiffons gluants, tordus dans un coin, qu’une mage noire anime et secoue. Elles semblent éreintées. Est-ce qu’on peut les dire encore vivantes, à l’instant de leur prise de pouvoir ?
Oui. Comme élevées au-dessus d’elles-mêmes. Au-dessus du charnier intime. Pareilles aux métropoles millénaires qui, à bien y voir, ont pour matrice un réseau d’égouts.
Pour Cenci, Brinvilliers et Fulham, le venin devient l’arme intime. On n’a le corps formé à aucune et le venin devient l’arme que l’on crée en nous et pour nous. De patience aussi on s’arme. C’est un goutte-à-goutte. Les trois femmes connaissent des expériences, toute une série, dès l’enfance, de pièce en pièce dans les manoirs glissants. Le goutte-à-goutte commence. Pour ces trois femmes-là, le processus parvient à son terme.
Je dis “trois”. Si le livre ne se résume pas à un triptyque hagiographique grinçant, c’est qu’il existe une quatrième femme, qui traine un quatrième récit. Narratrice en retrait des autres, Hemlock ranime les trois premières avec sa propre histoire. Elle se tient là, de temps en temps, en italique et à contrejour. Chaque récit lui permet d’examiner, sous un angle nouveau, le geste radical qu’elle s’apprête à faire.
Et donc, elles se mettent à mordre. Cenci, Brinvilliers, Fulham, Hemlock. Avec les doigts, dans les verres, après avoir coupé des tiges et froissé des feuilles. Elles répondent au défi avec une virtuosité déconcertante. Il faut aussi dire qu’elles sont bien nées. L’éducation dont elles ont bénéficié, la conscience de classe, si je puis dire, en font des êtres d’orgueil. L’orgueil est peut-être, dans Hemlock (à travers les meurtrières), ce qui permet le mouvement de bascule, la prise de pouvoir, l’entrée en domination. Les hommes n’ont pas su confisquer l’orgueil aux femmes. Là elles sont à égalité et voilà, ça sinue entre les doigts, le coeur des unes bat hors du corps livré, les draps des autres se trempent de fièvre.
Hemlock (à travers les meurtrières) est un livre de Gabrielle Wittkop, publié en 1988 sous le titre : Hemlock ou les poisons et réédité en octobre 2020 par Quidam, augmenté d’une préface de Karine Cnudde.
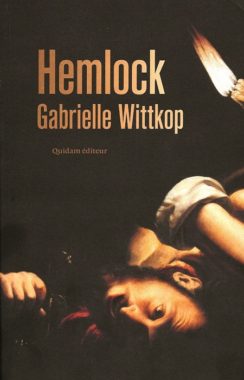
Hemlock (à travers les meurtrières),
Gabrielle Wittkop.
Quidam éditeur,
collection “Made in Europe”,
octobre 2020.
Olivier
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

